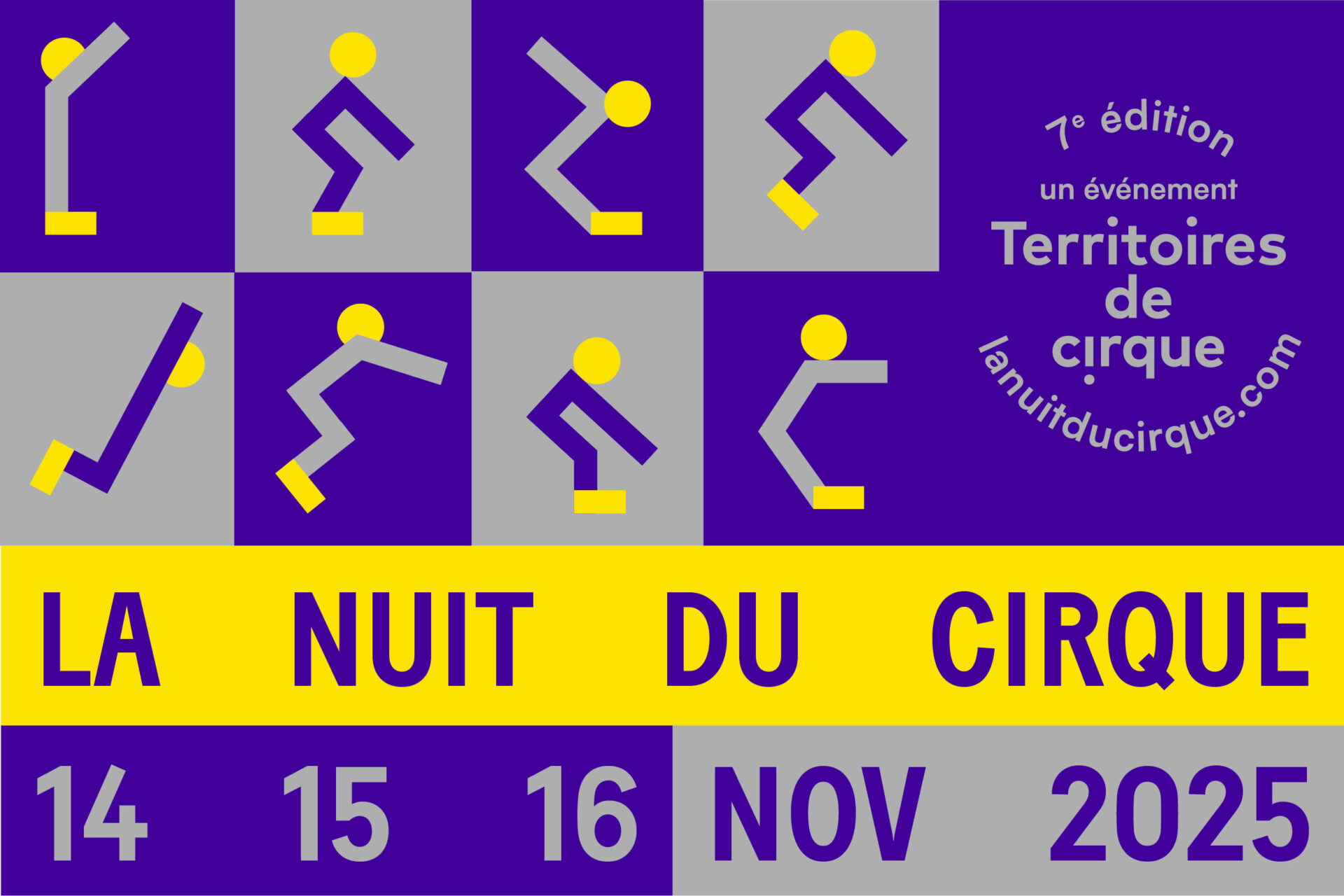Comment « faire danser les arts plastiques » ?
Par Léna Martinelli
Les Trois Coups
Danser l’œuvre d’un artiste, tel est le défi lancé par le photographe Laurent Paillier et le critique Philippe Verrièle à des chorégraphes. Un exceptionnel hymne à la création.
Laurent Paillier est un photographe de plateau réputé. Habituellement soumis à l’obligation de travailler sans flash, en haute sensibilité, avec un reflex, mais sans grande possibilité de varier la profondeur de champ, et surtout sans réelle opportunité de se déplacer, il a souhaité se libérer de ces contraintes en réalisant des créations uniques en studio. Depuis, toujours passionné par l’histoire de l’art, il a alors eu l’idée, en complicité avec le critique de danse Philippe Verrièle, de proposer à des chorégraphes la création d’une pièce courte, en hommage à l’univers d’un artiste moderne ou contemporain.

Certains ont choisi leur plasticien, d’autres se sont vus passer une commande autour d’un univers pictural qu’ils ont découvert. Aucune séance n’a fait l’objet d’un enregistrement vidéo et aucune ne sera rejouée. Un protocole très intéressant et un projet éditorial ambitieux qui a nécessité cinq années de travail. De la friction entre ces deux univers est effectivement née une danse, interprétée en huis clos, dont la trace se révèle à travers une série d’images époustouflantes, accompagnées par des textes éclairés.
Collaborations fructueuses ?
Dans ce cadre original, la relation entre danse et arts plastiques est revisitée car, une fois n’est pas coutume, c’est aux chorégraphes de donner leurs sentiments sur des artistes et de les prendre comme sujets. En effet, l’inverse est plus courant, comme nous le rappelle Philippe Verrièle dans son introduction.
En revanche, le critique relève que « l’histoire croisée des arts plastiques et chorégraphiques est plutôt celle d’un malentendu fait de mécompréhensions, de rendez-vous moitié manqués et d’exploitations réciproques ». Par exemple, Degas « s’intéresse plus aux danseuses qu’à la danse », Gauguin ou Cézanne sont « complètement indifférents », Braque, Picasso ou Matisse « n’envisagent la danse que comme instrumentalisation, comme sujet ou comme écrin, et non comme préoccupation ».

Sujet, la danse peut aussi être une influence. L’apport de Diaghilev et des Ballets Russes constitue un virage notable. Le rapprochement génère alors de nouveaux enjeux, avec deux arts qui se nourrissent l’un l’autre, notamment dans la danse moderne (Isamu Noguchi et Marta Graham). Mais les exemples sont rares, la collaboration se limitant trop souvent à l’illustration d’un spectacle par un plasticien-décorateur qui élabore surtout la scénographie et les costumes.
Relations fécondes et équilibrées
Soulignons donc la réelle implication des danseurs, au service de ce concept très original, où le mouvement sublime l’art – et vice versa – où la photo illumine le geste avec talent. C’est ce qui ressort de cet ouvrage, qui comporte onze chapitres. Onze artistes majeurs, donc, de Kandinsky à Turrell, en passant par Klein ou Pollock. Chaque séance dansée et photographiée est représentée par une dizaine d’images accompagnées d’un texte sur le plasticien, ainsi que d’un entretien du chorégraphe (la plupart, de jeunes créateurs).

Comment se frotter à certaines figures ? La plus grande fusion des univers dansés et picturaux est sans doute dûe à Kaori Ito, qui fait d’ailleurs la couverture. Son hommage à Vladimir Velickovic interroge les limites de ce qui se danse en scène. L’effroi aussi.
Pour la petite histoire, Philippe Verrièle raconte que ce peintre, non retenu au départ, « s’imposa dans l’affaire par effraction ». Guère étonnant ! Témoin, dans son enfance, des atrocités commises par les Nazis en Yougoslavie, ce peintre s’est voué à la représentation de l’homme, pour lui un champ d’investigation inépuisable. Mais Philippe Verrièle le qualifie de « peintre anti-chorégraphique », entre autres, à cause de ses corps empêchés. Hommes gisants ou suspendus, visions de carnage, paysages désolés forment un univers macabre et agressif, que Kaori Ito a pourtant parfaitement su restituer. La jeune japonaise se lance dans un rituel, une transe spirituelle avec de la peinture noire, dont les traits expriment l’énergie du désespoir. Un exorcisme car, ici-bas, s’entretiennent de singulières relations avec le Mal.
Corps à corps
Également sur fond blanc, les battles hip-hop d’Anne Nguyen revisitent les œuvres de Jean Degottex. Inspirées de la figure du Yin et du Yang, elles structurent ainsi le geste qui se dédouble. Si Malika Djardi explore le débordement du cadre cher à Jackson Pollock dans de remarquables compositions où les corps saturent l’espace, Maria Jesus Sevari interprète merveilleusement la dilatation du temps et les blessures à même la peau, que Lucio Fontana donne à voir sur ses toiles.

Maniaque de la structure, Perrine Valli s’est penchée, elle, sur Vassily Kandinsky, dans de savants points de vue. Avec ses collages de maillots, ses bouts de chair tout en ombres dynamisées par des rubans colorés, la chorégraphe nous plonge d’emblée dans l’univers du fondateur de l’art abstrait : « la création de cette pièce ” sens dessus dessous “ m’a permis de casser mes propres habitudes et repères artistiques ». Arthur Perole, lui, fait « cohabiter la ligne et la courbe » de Constantin Brancusi, dans une mise en scène très étudiée. Les danseurs deviennent des statues affranchies de leur socle.
Mélanie Perrier, quant à elle, fait disparaître son corps fantomatique dans le high-key d’un fond blanc, merveilleuse référence au baigné de lumière de Turrell. Pour invoquer l’expressionniste allemand Kirchner, Tatiana Julien, de son côté, explore l’« engagement outre mesure » du peintre par un jeu d’ombres projetées, avec « une danse qui voudrait empoigner, saisir outrageusement une forme de gouffre et d’urgence… » Dos courbé, silhouette noire d’une infinie sensualité : quelle troublante incarnation révélatrice de l’individu confronté à sa perte !
Enfin, avec cette poudre d’or qui fait ressortir, de façon presque magique, le motif du corps dansé sur fond noir, Éric Arnal Burtschy a, lui aussi, été très inspiré. Après avoir travaillé sur la monochromie, Yves Klein s’est lancé dans les Anthropométries de l’époque bleue, réalisant une série d’œuvres dans lesquelles il a développé sa technique de pinceaux vivants.

Dans sa chrysalide de tulle, Leïla Gaudin sonde autrement les pulsions de vie et de mort. Ses enveloppes textiles, qui évoquent les poupées célébrées par Louise Bourgeois, questionnent la maternité et fouille l’inconscient d’une histoire personnelle hantée par la sexualité. Jean Rustin, lui, traite de « l’obscénité au risque du corps conforme », soulevant ainsi un autre sujet intéressant.
L’écriture du geste
Qu’ils pénètrent ou pas les béances du monde, tous ces chorégraphes ont abordé ces plasticiens à bras le corps. Transposition de formes ou de mouvements, empreinte à même la peau, incarnation… l’écriture du geste a été le moteur de ce projet. « Le corps du danseur véhicule une pensée, comme le pinceau et la main véhiculent celle du peintre », résume bien Perrine Valli. Le mouvement dessine des lignes graphiques qui sculptent l’espace. Blanc intense, giclures d’encre, calligraphie chinoise, bleu Klein et paillettes d’or… les couleurs éclatent sur les pages. Et en saisissant ces instants de grâce – éphémères par nature – chaque photographie laisse des traces indélébiles.
Sérieuse, cette contribution à l’histoire de l’art est d’autant plus précieuse qu’elle est créative. Ce magnifique ouvrage explore, décidément sous un nouveau jour, les liens passionnants entre arts plastiques et chorégraphie. D’ailleurs, l’Association professionnelle de la critique de théâtre, musique et danse l’a élu « Meilleur livre de danse de l’année (2016) ». ¶
Danser la peinture, pour une contre-histoire dansée de l’art, de Laurent Paillier et Philippe Verrièle, nouvelles éditions Scala, 2015 / 170 pages / 24×30 cm / 35 €
Présentation de l’ouvrage par l’éditeur