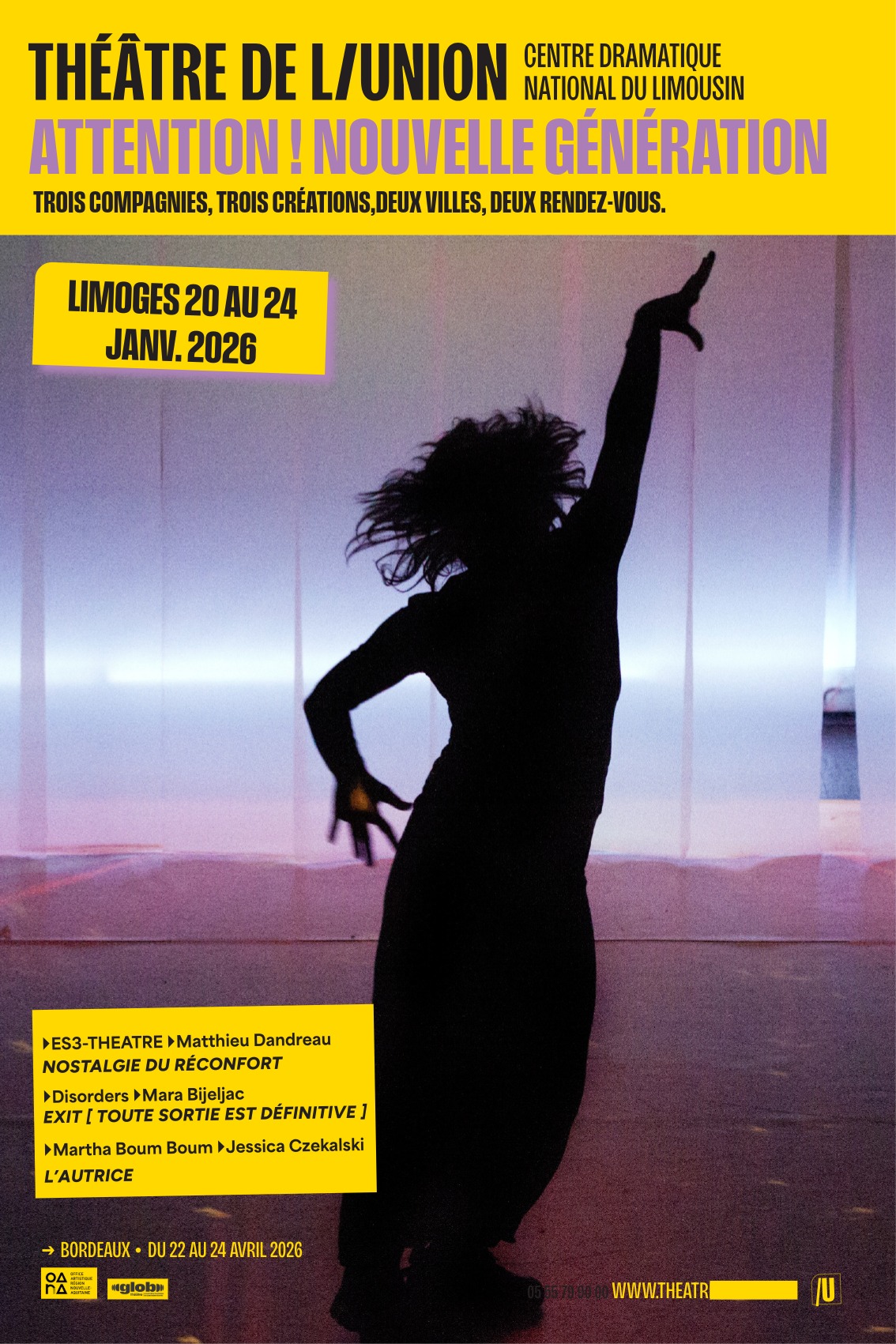Les mythes à bras le corps,
ou l’éternelle envie de fricoter
avec la tragédie grecque
Saluer Platon pour nous avoir mis le nez dedans avec ses histoires de Vérité, de Caverne et d’idéologie esthétique dans lesquelles la modernité s’est engluée m’est impossible tant, c’est un fait, Platon m’irrite jusqu’à l’eczéma. Néanmoins, il me faut bien reconnaître que ces Grecs étaient fortiches. Leur philosophie abreuve encore des torrents de pensée contemporaine, leur invention politique pour déformée qu’elle soit n’en circule pas moins sur les lèvres de tous les candidats aux mandats occidentaux et au-delà, jusqu’à s’ériger en valeur absolue du bien, du parfait, de la ligne d’arrivée de l’émancipation politique. Il y a encore l’esthétique ! Il y a l’histoire ! Il y a l’astronomie et les sciences, l’épopée, la statuaire, la poésie ! Et comme si ce n’était pas assez, les Grecs ont fait du théâtre, un théâtre fou, profond, abyssal. De cette pratique à la fois sacrée et sociale, profane et d’une spiritualité vibrante parce que collective et charnelle, les formes toujours remuées ne sont pas parvenues à épuisement.
Avons-nous jamais cessé d’interroger Œdipe, Antigone, Énée, Électre ou Oreste et ses démons de parricide ? Ne continuons-nous pas à lire, retraduire, triturer, questionner, réécrire les vers d’Euripide, d’Eschyle ou de Sophocle ? Car, du théâtre grec, ce qu’il nous reste en réalité, c’est la tragédie. Aristophane est drôle, c’est entendu, mais qui s’en empare aujourd’hui, quand la tragédie porte en elle des bribes de sublime cousues de la solitude humaine qui reçoit et dévie – ou tout du moins tente de dévier – les forces qui dépassent ses propres limites ? Le rire est fugace et fluide, quand le tragique est un arrêt, une suspension du temps, pour ne pas dire un combat pour son abolition.
Est-ce cela, cet étrange lien entre le théâtre et le temps, entre le sens réinventé et la fascination pour les pressions qui s’exercent sur les hommes, et dont ils n’ont de cesse de vouloir s’affranchir, qui continue d’enrichir les mythes portés par le théâtre grec dans une constante réécriture de leur sens ? Pour qu’un mythe vive, il faut qu’il soit pris, dévié lui-même, choisi pour être déplumé puis rempli d’un élan, d’un verbe nouveaux, sous peine de se dégonfler comme une fausse bonne idée. C’est là sa profondeur, mais aussi le défi qu’il impose.
Lise Facchin
Antigone en « home cinema »
Par Élisabeth Hennebert
Les Trois Coups
Dans « Le reste vous le connaissez par le cinéma », Martin Crimp tente de filmer l’Antiquité grecque avec une minicaméra frontale.

© Frédéric Chaume
Ce doit être la centième reprise du mythe d’Antigone regardant, impuissante, ses frères Étéocle et Polynice s’entretuer sous les murs de Thèbes. La tragédie s’ouvre sur « l’éclatante lumière » grecque et se referme sur une montagne de cadavres. Voici pour l’intrigue, tirée des Phéniciennes d’Euripide. Le style de Martin Crimp, lui, est d’emblée prometteur. Le titre accroche l’œil. La première scène, version dévoyée des devinettes du Sphinx, plaît à l’esprit. En effet, les questions sont formulées comme des problèmes d’école primaire, clin d’œil à cette activité bien scolaire qu’est l’étude des mythes et héros grecs. Et l’on sent presque aussitôt remonter les souvenirs de classe. On éprouve en même temps de l’intérêt pour cette curieuse manière de mêler la naïveté de l’enfance à la brutalité du monde, puisque les énoncés sont pervertis : « Si deux garçons chacun transpercé par une lame constituée de cuivre et d’étain mettent trois heures pour saigner à mort à une température ambiante de trente degrés Celsius… » 1. On se dit que nos violences modernes vont être décapées par cette relecture d’un mythe vieux comme le monde.
Et puis soudain tout se détraque, tout va trop vite, ou trop lentement, ou de travers. Ce qu’on avait secrètement espéré ne se produit pas. On attendait une version déringardisée du péplum, un relooking d’Euripide capable de nous donner à méditer sur le triste et bien réel monceau de cadavres que nous apporte le J. T. chaque soir. Dieu sait que le thème des frères ennemis, de la mère déchirée par le massacre de ses enfants, de la sœur défiant la mort pour procurer une sépulture à son frère soldat, est d’une cruelle actualité.
Deux tiers de migraine
Or la pièce de Martin Crimp ressemble à ces films, publicitaires ou non, professionnels ou amateurs, qui pullulent sur Internet, et qui présentent des paysages filmés par des fous de la glisse et autres sports extrêmes par une minicaméra fixée sur leur casque. Quand c’est réussi, le rythme effréné et la qualité de la lumière procurent l’extase. Quand c’est raté, les images tressautantes donnent la migraine. Voici un texte qui provoque un tiers d’extase pour deux tiers de migraine.
Je suis de ceux que l’abus de la trilogie « salope / couille / merde » fatigue. Que la répétition de la même phrase, copiée et collée plusieurs fois pour faire avant-gardiste, endort. Que les fantaisies typographiques plus ou moins gratuites déconcentrent. Il y a les trois dans Le reste vous le connaissez… La vulgarité est omniprésente, encore aggravée par les anglicismes du traducteur Philippe Djian 2. Et puis sans transition, le registre devient celui de Mlle de Scudéry ou de Jacques Derrida : « Il se crève les yeux lui-même, ce qui revient à faire un nœud dans l’histoire humaine » dit Tirésias juste après avoir proféré cette phrase à la syntaxe boiteuse : « Les dieux préviennent Laïos de ne pas avoir d’enfants. » 3. Franchement, au-delà de la deuxième scène, on ne sait plus qui parle dans quel registre de langage, ni pourquoi. La typographie, elle, est explorée avec plus ou moins de bonheur. Au diable les barres obliques, insupportables quand elles n’ont aucun sens (« J’ai dit bien sûr / que tu en es capable », dit Jocaste) 4. Au diable les phrases écrites entièrement en majuscules (sans doute pour suggérer qu’ici, le comédien devra saturer le Sonotone du spectateur). Il y a pourtant des tentatives intéressantes, comme l’utilisation du « brouillard de mots », technique de graphiste qui consiste à écrire sous forme d’une nébuleuse agréable à l’œil tous les mots d’un même champ sémantique. Dix-neuf mots du registre de la guerre, à la fin de la pièce, sont écrits sous forme de brouillard de mots disposés en calligrammes. Cette typographie originale correspond apparemment à un jeu scénique où chacune des jeunes filles du chœur marmonnant dans son coin un texte différent de la voisine. C’est joli à lire et probablement intéressant à mettre en scène. Mais cela contribue peut-être aussi à cette impression que l’on a d’être perdu pendant une bonne partie de la pièce.
Un tiers d’extase
Je finirai, par politesse, sur les quelques moments d’extase. Rimbaud l’avait remarqué dans le Dormeur du val : les charniers sont souvent logés dans des paysages qui auraient tout pour faire un paradis terrestre. Comme une insulte jetée par la terrifiante idiotie des hommes à la face de la mère Nature. « C’était le paradis », proclament les filles à l’ouverture de la scène vi. Elle est poignante, cette nostalgie du chœur, que l’on retrouve dans beaucoup de témoignages de réfugiés de guerre ou de rescapés de massacres : leur coin de terre n’était-il pas un paradis, avant ? En fin de compte, les apparitions du chœur des filles notant l’évolution du disque solaire au cours de la journée tragique, enregistrant la beauté du monde alentour qui offre un saisissant contraste avec le carnage central, forment la part la plus belle de cette œuvre. Pour le reste, on a l’impression d’avoir regardé le film en étant assis beaucoup trop près de l’écran : les images sont criardes et la bande-son hurle. ¶
Élisabeth Hennebert / illustration de Yannick Calvez
- Le reste vous le connaissez par le cinéma, de Martin Crimp, L’Arche, 2015, p. 12.
- Ibid. p. 37 « le problème avec », p. 41, « opportunité » à la place de « chance ».
- Ibid. p. 56.
- Ibid., p. 33.
Le reste vous le connaissez par le cinéma, de Martin Crimp
Traduit de l’anglais par Philippe Djian
L’Arche, collection « Scène ouverte », 2015, 95 pages, 13 euros
La pièce a été créée en allemand au Deutsches Schauspielhaus de Hambourg le 24 novembre 2013.
http://www.schauspielhaus.de/de_DE/kalender/alles_weitere_kennen_sie_aus_dem_kino.12431005
L’Apologie de Badiou
Par Vincent Morch
Les Trois Coups
On connaît Alain Badiou le philosophe, on connaît sans doute un peu moins Alain Badiou le dramaturge. France Culture et le Théâtre national populaire se sont associés pour lui commander en 2013 une nouvelle pièce dans la perspective d’une création radiophonique interprétée par les comédiens-français. Le résultat est une œuvre à l’argument fantaisiste, qui offre à l’auteur l’occasion d’un vibrant plaidoyer « pro domo ».

© Vincent Croguennec
La première chose qui se manifeste à la lecture de cette pièce est l’immense jouissance de son auteur. Cette réécriture contemporaine et décalée de l’Apologie de Socrate – le dialogue de Platon qui met en scène le procès du père de la philosophie pour impiété et pour corruption de la jeunesse – est portée par un plaisir d’écrire qui transparaît quasiment à chaque ligne. Ces retrouvailles d’Alain Badiou avec le théâtre 1 font des étincelles et engendrent une énergie joyeuse et communicative. L’auteur s’amuse, joue avec les paradoxes – et Dieu sait que son argument en génère – et parsème son texte de mises en abymes comme dans la scène i de l’acte V où le juge Paulos demande au machiniste de couper le projecteur éclairant un personnage.
Un autre motif d’agrément est l’évident plaisir avec lequel il retranscrit les personnalités et les discours de quatre contemporains de Socrate miraculeusement arrachés à l’Antiquité et jouant le rôle de procureur (Calliclès) ou bien d’avocats (Platon, Aristophane, Xénophon). Du point de vue de la construction des personnages, j’avoue préférer ce dernier, car son aspect comique est à mon sens plus en lien avec son modèle réel : Xénophon ne cesse de protester de la solidité de ses informations sur Socrate alors qu’il n’a aucune source directe… Sa fatuité, sa veulerie et son esprit terre-à-terre me l’ont rendu sympathique. Mais il ne joue – comme Aristophane d’ailleurs, dans un tout autre registre (celui du bouffon aux saillies absurdes et imprévisibles) – qu’un rôle secondaire dans le dispositif de la pièce : les deux grandes lignes argumentatives majeures dans le débat sur la culpabilité ou non de Socrate sont en effet représentées par Calliclès et Platon.
Leurs plaidoyers respectifs (à la scène iii de l’acte IV pour le premier et à la scène ii de l’acte V pour le second), inspirés pour l’un du Gorgias et pour l’autre de la République de Platon (la fameuse « allégorie de la caverne »), sont les développements les plus longs, les plus travaillés et, à mon avis, les plus tendancieux, aussi, de la pièce. C’est là, en effet, que le concept de « réécriture » de l’histoire subit un véritable glissement, puisqu’il s’agit d’attaquer ou de défendre Socrate en tant qu’inspirateur de l’égalitarisme et du communisme. Pourquoi dépouiller la jeunesse de l’attrait du pouvoir et du goût de la compétition serait-il nécessairement une figure du marxisme ? Pourquoi s’arracher au monde des illusions et tourner son regard vers la Vérité conduirait-il mécaniquement à accréditer les thèses du Capital ? À moins qu’il ne faille renverser les données du problème ? Considérer qu’il s’agit moins d’un travestissement de Socrate que d’un déguisement d’Alain Badiou ?
Ce soupçon semble vérifié par le fait que, lors de l’enregistrement radiophonique de la pièce, c’est Alain Badiou lui-même qui tenait le rôle de Socrate. Le Second Procès de Socrate n’est pas à lire comme une enquête juridico-historique sur la véritable personnalité de Socrate, mais comme une pure profession de foi d’Alain Badiou pour l’idéal communiste. Celle-ci culmine, au terme de la pièce, en une envolée lyrique réellement superbe : « Nous errons tous, aujourd’hui, entre les dieux morts et la naissance à venir d’une humanité située à la hauteur de l’idée qu’elle peut se faire d’elle-même ». Tout le problème consiste ensuite à savoir comment ces belles idées s’inscriront dans la réalité. Le mépris final exprimé envers « les sédentaires » n’est, à ce titre, pas de très bon augure. ¶
Vincent Morch / illustration de Vincent Croguennec
Le Second Procès de Socrate, d’Alain Badiou
Actes Sud, coll. « Papiers », 2015
112 pages, 15 €
- Il est également l’auteur de l’Écharpe rouge (1979), d’Ahmed le Subtil (1994), d’Ahmed philosophe (1995), d’Ahmed se fâche (1997) et des Citrouilles (1996).
La diffusion radiophonique du Second Procès de Socrate est prévue le 10 mai à 21 heures sur France Culture.
À qui profite le mythe ?
Par Lise Facchin
Les Trois Coups
Une réadaptation conduite avec talent, intelligence et finesse, mais où l’on voit qu’exhumer les mythes pose inévitablement la question du partage des références.

© Oscar Viguier
De tous les mythes grecs, où l’on n’épargne point le sang ni les situations d’impasse, il en est peu qui glacent autant que l’histoire de Médée la magicienne, amoureuse éperdue de son illustre Jason jusqu’à la folie de l’infanticide. Stabat mater dolorosa à l’envers, l’épouse abandonnée pour une autre devenue le bourreau de sa propre chair est une figure de la démesure, de la souffrance à son acmé. Delacroix l’avait bien compris, élisant pour sujet de sa toile le moment même où la reine échevelée s’enfonce dans une grotte, ses enfants pleurant dans ses bras, et tenant déjà le poignard serré dans son poing alors qu’elle se retourne vers la lumière une dernière fois. Il choisit de la représenter le torse nu et doux, pour incarner le paradoxe, voire l’aporie, de la maternité meurtrière. Vouloir mettre ce mythe troublant à la portée du jeune public était une entreprise intéressante, un défi tout à fait pertinent, néanmoins délicat, car il s’agissait aussi – et avant tout – d’y donner un sens.
Des petits, le mythe ne nous dit rien, et il est vrai que les Grecs ont fort peu porté leur attention sur les enfants que la tragédie a jetés du haut des remparts de Troie, sacrifiés aux divinités, ou assassinés sauvagement. Ce constat a conduit Suzanne Osten et Per Lysander à accorder aux enfants de Jason et Médée la place centrale dans un dispositif qui a tout du classique « Papa s’en va et Maman pleure ». Pourtant, on réchappe à l’effet « tisane réchauffée » grâce à une approche d’une grande finesse, impliquant à la fois l’espace scénique et le langage.
Langue tragique et parole d’enfants
D’emblée, les didascalies posent les valeurs dramaturgiques : un espace « classique » avec des colonnes corinthiennes, où les enfants « n’ont pas le droit d’aller seuls » 1, et un espace « réaliste », où le spectateur peut voir une chambre d’enfant tout à fait contemporaine. En surimpression, les rôles de Jason et Médée sont forgés dans le registre de la tragédie classique, avec ses rythmiques et son vocabulaire hermétiques aux enfants. Les deux auteurs dévient la dualité frontale qui semble inévitable en introduisant le rôle de la nounou, à la fois interprète et passeur. Et si la pièce réussit quelque chose, c’est la défense de la parole des enfants, notamment via ce personnage qui finit par intimer à un Jason et une Médée aveuglés par le nombril de leur histoire de couple : « Répondez aux enfants ! » 2. Très joli rôle, celui de cette nourrice qui, accaparée par une mère vieillissante et un amoureux pressant, s’attache tout de même à ramasser les morceaux des enfants pris dans la tempête. Entre un Jason obsédé par son passé d’Argonaute et une Médée qui ne cesse de geindre dans les méandres de sa neurasthénie, elle fait figure de phare, et on lui donnerait sans peine le profil doux et régulier d’une médaille antique.
Le mythe convoqué soudainement muet
De cette démarche inédite, on retiendra l’intelligence avec laquelle la cruauté, la mort, le meurtre et la douleur furieuse sont portés à la scène à travers les dialogues entre les enfants, qui, dans la solitude de leur chambre, les jouent, ou plus certainement s’en emparent par le jeu. Cette double mise en abyme – d’abord par le jeu du théâtre et ensuite par celui des enfants – donne une profondeur étonnante à la mise en exergue du ressenti des enfants. Mais peut-on parler d’une autre place que celle de notre expérience de spectateur, celle d’un adulte, avec ce que cela implique de capacité de mise à distance ? On a d’ailleurs l’impression que le thème de Médée n’est finalement qu’un prétexte, sorte de canevas permettant d’interpeller les références des accompagnateurs du petit public, et c’est là où le bât blesse. Les auteurs ne nous disent rien de plus et auraient très bien pu parvenir aux mêmes fins sans recourir au modèle antique. Si ce n’est coquetterie d’intellectuel, alors que faire de cette référence uniquement partagée par les adultes présents dans la salle ? En ne traitant l’infanticide que par le biais d’un cauchemar de la grande sœur et en nommant les deux enfants « Petit Jason » et « Petite Médée », que cherchent à dire les dramaturges ? À qui s’adressent-ils au bout du compte ? L’adulte reste interdit devant cette pièce, pourtant cousue d’intelligence et de finesse, qui le prend par les racines antiques pour ne l’emmener que sur le pas de sa porte. Une question en tout cas demeure : qu’aurait écrit ici l’enfant lisant par-dessus mon épaule ? ¶
Lise Facchin / illustration d’Oscar Viguier
- Les Enfants de Médée, de Suzanne Osten et Per Lysander, Théâtrales, 2009, p. 6.
- Ibid. p. 65.
Les Enfants de Médée, de Suzanne Osten et Per Lysander
Traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy
Éditions Théâtrales, collection « Jeunesse », 2009, 80 pages, 7 euros
La pièce a été créée en 2011 et mise en espace par Suzanne Osten à la Comédie de Reims le 9 septembre 2012.
« Le théâtre est trinité… »
Par Michael Martin-Badier
Les Trois Coups
Quelque part en Méditerranée, territoire des dieux, le soleil est pris à témoin par une femme convoquant le théâtre pour parler aux hommes.

© Gabrielle Roque
Au lever de soleil de ce dernier jour d’une période d’abstinence, de somnolence des corps et des esprits, une voix féminine s’élève. Sandra, femme savante, libre et révoltée, en invoquant la Terre, les morts et la lumière, plante là la scène d’un théâtre politique et poétique. C’est l’histoire d’une famille où les hommes sont presque des dieux, où les jeunes affrontent les vieux sous le regard bienveillant et conservateur des gardiennes du temple, les mères. Antiques problématiques !
Simon Abkarian, en fin dramaturge, indique pour les personnages leur nom, leur place dans la famille ou la cité, et leur âge. Il commence ainsi par un conflit de générations, situation très concrète au sein d’un foyer, afin d’explorer les enjeux et difficultés du vivre-ensemble.
Être fille dans une société patriarcale est le thème incandescent de cette pièce, d’où jaillissent d’autres questions qui brûlent comme des brasiers éternels dans le sommeil des hommes. L’aînée à marier veut sa liberté, tandis que la cadette, affamée d’amour absolu, rêve de mariage dans la tradition. La femme-mère conservatrice protège ses jeunes fleurs de sa sœur Sandra, célibataire progressiste et féministe. Le débat d’idées est avant tout mené par les femmes, les hommes, eux, se concentrent sur la défense de leur honneur.
Presque dieux dans la cité, incarnations mythologiques, ils sont hantés par d’antiques questions existentielles, tel le père Théos, patriarche respecté de tous, dans lequel on reconnaît la figure de Thésée, roi unificateur d’Athènes. Minas le boucher est un veuf triste confondant le corps de sa fille avec celui de sa défunte épouse, nous remémorant le mythe du Minotaure, symbole de l’homme dominé par ses pulsions. Ou encore Aris, le fils à marier de la voisine et futur gendre un peu bête, certainement inspiré du dieu Arès, est un emblème du combattant et brutal. Plus que des références littéraires, ce sont les voix du passé discutant avec le présent. Échange dans lequel chacune et chacun résiste à quelque chose, au poids de la filiation, aux traditions et conservatismes, au sacré, au réel… Ce texte nous rappelle ce que le théâtre veut dire depuis qu’il est théâtre, nous faisant témoins des idées en mouvement.
« Tu ne peux pas comprendre le mystère qui me hante » 1
C’est ainsi que Zéla répond à sa sœur aînée, celle-ci insistant pour lui imposer sa vision, l’implorant de ne plus rêver à l’amour, mais au contraire de le vivre pleinement et librement. Les deux points de vue sont discutables, là n’est pas la question. Ou plutôt, si. Car cette réplique résume une notion importante parcourue tout au long de la pièce, celle du mystère qui est en chacun de nous, de la complexité de l’être, et qui doit se faire entendre. Pour cela, le texte nous fait voyager du dedans – la maison – au-dehors – la cité –, du discours de l’intime au public, de ce qui se dit dans le privé à ce qui se raconte chez les autres. Le tragique devient comique, les registres de langage varient, les corps se dévoilent à certains ou se cachent à d’autres. Dans la chair, les mots, les aspirations ou la lumière, tout est oscillation. Les points de vue s’opposent, et les multiples s’expriment.
Nous, lecteurs-spectateurs, observons, écoutons et apprenons de ces paroles simplement libérées par le théâtre. Un poète a écrit : « Le théâtre est trinité, celui qui espère, celui qui vient et celui qui témoigne de leur rencontre » 2. Ainsi, l’auteur termine : « Regardez, du ciel tombent trois pommes, une pour ceux qui l’ont racontée, une deuxième pour ceux qui l’ont écoutée, et la troisième c’est un secret. » 3. ¶
Michael Martin-Badier / illustration de Gabrielle Roque
- Le Dernier Jour du jeûne, p. 18.
- Les Mille et Une Définitions du théâtre, Olivier Py, Actes Sud.
- Le Dernier Jour du jeûne, p. 87.
Le Dernier Jour du jeûne, de Simon Abkarian
Actes Sud-Papiers, 2014
88 pages, 13 €
Le Dernier Jour du jeûne a été créé en 2013, au Théâtre du Gymnase à Marseille, en coproduction avec le Théâtre Nanterre-Amandiers.