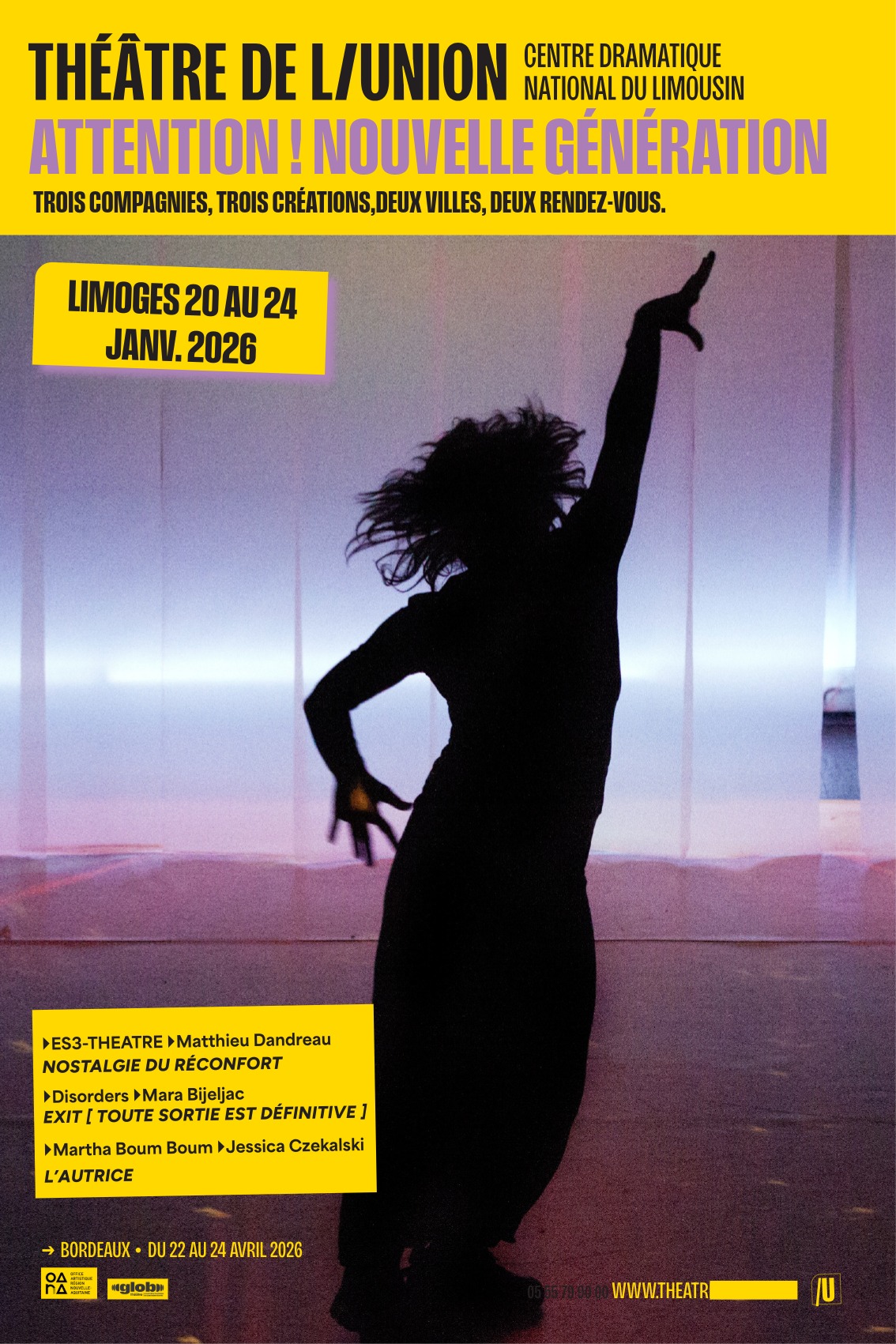Aurélie Van Den Daele : « Écouter l’ici et maintenant »
Par Laura Plas
Les Trois Coups
Comédienne, devenue metteuse en scène et membre du Deug Doen Group, Aurélie Van Den Daele, a été nommée en juillet, pour quatre années, à la tête du CDN de Limoges, suite à la démission de Jean Lambert-wild. Elle présente ces projets pour le théâtre et l’école, deux structures dont elle veut renforcer les synergies.
Vous êtes désormais à la tête de l’Union, après avoir passé de nombreuses années à arpenter les scènes de ces centres dramatiques, notamment en tant qu’artiste associée. Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de tenter cette expérience ?
Pendant cinq ans, au Théâtre de l’Aquarium, grâce à François Rancillac et à toute l’équipe, j’ai pu créer dans une vraie fabrique. Ensuite cela a été dur pour moi de me trouver dans le cadre de structures de production extrêmement balisées, sans lieu pour expérimenter des idées théoriques, ni issue, si l’expérimentation ne fonctionnait pas immédiatement.
Et puis lors d’un séminaire d’artistes associées, Carole Thibaut, la directrice du CDN de Montluçon, a souligné l’importance de la présence d’artistes, et notamment de femmes, à la tête des centres dramatiques nationaux, pour apporter d’autres visions. Aurore Évain, artiste et universitaire, présente à ce séminaire, m’a donné aussi des indicateurs pour percevoir les inégalités homme / femme, y compris dans la vie quotidienne. J’ai commencé à y être très sensible et à me dire qu’il me fallait un lieu pour défendre ces idées. La solitude du confinement, qui a rendu presque impossible l’entraide et les échanges entre compagnies, a accéléré cette réflexion. Ici, l’équipe de l’Union, animée par beaucoup d’envies, m’a réservé un très bon accueil. J’en suis très reconnaissante.
Je me revendique féministe
Votre projet bruisse de la présence d’autres artistes. Alice Laloy, Charlotte Lagrange, Elsa Granat : le choix de tant de femmes est-il délibéré ?
Oui, c’est politique et cela constitue une marque de sororité. D’autant que beaucoup de créatrices n’ont pas eu assez rapidement les moyens de production pour expérimenter une écriture vivace et vivante, avoir une vraie liberté. L’argent sert aussi à ça : à tester, à infirmer, à confirmer. Et il y a aussi un homme : Gurshad Shaheman.
Pensez-vous que la création ait un genre ?
C’est compliqué, la question du genre est difficile à relier à la création d’un point de vue organique. Je me revendique comme féministe. Pour moi, aujourd’hui, c’est un fait, la création est malheureusement genrée avec une domination masculine, que ce soit dans la production, la création, l’écriture. Avec Laurent Lalanne (directeur délégué) on souhaite la parité totale : c’est un exercice difficile en maintenant dans la programmation une diversité de propositions. Même si ça bouge, la création reste bien genrée, alors que je la rêve hybride, plurielle et queer. Ce serait super qu’on ne sache pas qui l’a faite au regard des objets !
Croyez-vous aux identités ?
On a beaucoup travaillé sur cette question pour distribuer, avoir un discours politique imbriqué avec les parcours des interprètes ou artistes avec qui je travaille. Je crois à l’identité comme à un maillage intérieur qui raconte nos histoires antérieures, transgénérationnelles et futures, mais je pense qu’elle est multiple. C’est une photographie mouvante à l’intérieur d’une vie. Elle est personnelle, ne peut venir de l’extérieur.

Pourriez-vous présenter les artistes associés que vous avez engagés dans cette nouvelle aventure ?
L’idée était de proposer des aventures à des gens qui ne sont pas des compagnons de route, mais qui appartiennent à d’autres horizons et qui sont liés au vivant. Ils et elles vont apporter un souffle singulier : toutes et tous font l’expérience d’écritures hybrides, scéniques, autofictionnelles, ce qui crée une cohésion. Ils et elles avaient envie de travailler à Limoges, avec des partenaires précis et à l’Académie.
Expérimenter une écriture vivace et vivante
Elsa, par exemple, s’interroge beaucoup sur le soin. Elle travaillera en mars avec des personnes âgées autour de son spectacle King Lear Syndrôme. Gurshad a des envies de propositions performatives dans différents lieux. Alice voudrait tester des temps de recherche sur ces créations avec l’Académie. Et Charlotte a une immense qualité d’écriture et de construction. Je voudrais, par exemple, qu’elle garde la trace de notre aventure ici, avec les publics. Il et elles présenteront des créations et nous travaillerons main dans la main pour accompagner leurs envies.
Vous appartenez au Deug Doen Group. Que représente exactement le collectif pour vous ?
C’est le fondement de la création, un essentiel un peu abîmé aujourd’hui. Au début de mon parcours, j’ai affirmé une position de metteuse en scène solitaire, mais à partir du moment où j’ai rencontré mes compagnons de route (dont trois qui fondaient le Collectif Invivo et venaient de l’ENSATT) l’idée de partage s’est imposée. C’est vraiment là que c’est né. On a trouvé un chemin commun pour raconter. J’ai besoin d’être entourée pour penser.
Mon travail est une forme d’écriture scénique
Un certain nombre de membres du Deug Doen Group écrivent. Est-ce contagieux ? La mise en scène est-elle une écriture ?
Plusieurs membres écrivent, en effet. J’ai une fascination pour l’écriture comme acte de coopération et transformation. J’aimerais pousser la collaboration plus loin que la commande d’écriture, en m’inspirant de la métaphore du vivant. Une nouvelle génération est arrivée qui a une grande maîtrise des technologies, ce qui donne des artistes très complets qui maîtrisent un discours scénique. Les écritures deviennent multiples.

Caroline Marcilhac (directrice de Théâtre Ouvert) m’a dit que l’écriture ne se réduisait pas au geste d’écrire sur une feuille ou sur un clavier. C’était bien t’entendre que mon travail était une forme d’écriture scénique : un vocabulaire dont je peux me saisir pour que les interprètes ritualisent, sanctuarisent le feu intérieur par l’écriture.
Vous trouvez du sens à travailler sur des écritures contemporaines ? Pourquoi ?
J’aime travailler sur des textes qui ne sont pas lestés par l’histoire de leur mise en scène, même si pour Angels cela n’a pas été si vrai. Des textes qui n’ont « ni mémoire, ni histoire ». Au CNSAD, on nous apprenait que monter un classique, c’était aussi monter l’histoire de ses mises en scène.
Mais je rêve de monter un classique ! D’ailleurs, les classiques sont très présents lors des répétitions. Pour L’Absence de guerre, on a beaucoup travaillé les pièces sur le pouvoir de Shakespeare. Tony Kushner, lui-même, cite les classiques : Brecht et Corneille irriguent Angels. Malgré une urgence du présent.
Vous arrivez à Limoges avec un projet de tissage entre des CDN, un maillage territorial. Quel sens politique, voire philosophique, cela a-t-il ?
Aujourd’hui, de nombreux lieux collaborent. C’est une nécessité absolue. Il faut qu’on accompagne mieux les artistes, qu’on soit plusieurs à le faire en divers endroits, en différents types de lieux. Donc c’est un geste politique, car l’absence de solidarité crée un espace confus, qui entraîne la starification et ne valorise pas assez le geste, l’essai, la tentative. On dénonce des modèles de compétition dans les récits, mais on doit le faire aussi dans les modalités d’accompagnement, de production dans la manière de gérer les théâtres.
La forêt monde comme métaphore
Vous avez conçu votre projet sur une réflexion sur le vivant et la forêt ? Quels sont vos souvenirs, vos expériences, ou encore les œuvres qui expliquent cet intérêt ?
Je suis petite-fille de grainetier. J’adorais faire des choses avec ma grand-mère belge, comme des jardins japonais. Ça a l’air anecdotique, mais c’est fondateur d’une façon, de raconter des histoires avec des matières, du volume, dans un espace. Et puis il y avait un schisme entre ma volonté écologique et ma pratique du théâtre énergivore, dans une boîte noire. J’ai vraiment eu un choc littéraire et esthétique avec l’Arbre monde de Richard Powers. Ça m’a fascinée et je me suis renseignée sur les relations entre les arbres, entre les arbres et les humains.
Je trouve une analogie avec la création car les arbres sont porteurs de l’Histoire, vecteurs d’histoires, modèles de collaboration. L’année dernière, on a travaillé à Montluçon les analogies sur les racines, les graines, l’humus, le pourrissement. C’était très stimulant pour penser le nouveau partage avec les publics et le projet pour l’Union et l’Académie.
Pouvez-vous parler de votre projet artistique autour de « l’Arbre monde » ?
Les droits du roman ne nous ont pas été donnés. Alors, toute l’année dernière, avec Charlotte Lagrange, Elsa Granat et deux interprètes Émilie Cazenave et Marie Quiquempois, on a commencé à imaginer une saga déclinée en « racines », « troncs », « cimes », « graines », selon la structure du roman. « Racines » propose des solos en milieu naturel. Ensuite, on imagine une saga en extérieur et en intérieur qui raconte l’histoire d’un groupe, dont les membres sont présents dans « Racines ». Les graines sont des actions semées autour des spectacles : des conférences, podcasts…. La « forêt-monde » est l’enveloppe. Mais le projet évolue en permanence, dans le contact avec l’ici et maintenant.
Toutefois, aujourd’hui, il m’apparaît plus pertinent de faire du théâtre-paysage, en relation évidemment aussi avec les arbres. Le projet ne saurait être transposable partout, comme un spectacle ordinaire. Être dans un lieu fait bouger la vision. L’horizon serait plutôt 2024-25. Il nous faut donc désormais arpenter les sentiers, les forêts, les lieux de lutte, pour inventer ou se rapprocher du roman.
Le goût de l’apprentissage,
de la curiosité, de l’expérimentation
Vous intégrez une équipe : celle du Théâtre de l’Union, à la tête d’une école : l’Académie, comment écoute-t-on ces groupes ? Comment créer un dialogue de qualité ?
L’Académie est une des motivations de ma candidature. Parce que depuis quelques années, je suis beaucoup intervenue en écoles nationales. Je trouvais important de travailler avec les élèves, de les professionnaliser pour les embaucher ensuite. J’estimais aussi qu’il y avait des défauts de formation systémiques. Il se trouve en plus que je me retrouve face à une promotion qui a beaucoup souffert, subi de multiples crises. J’ai choisi d’écouter ses requêtes : certaines sont liées à des questions habituelles d’insertion professionnelle. Mais on a un échange plus précis dans un contexte où la création est en train de muter avec, non seulement des problématiques conjoncturelles, mais à la facture des récits d’aujourd’hui. On a décidé d’être dans un dialogue très simple, très adressé.

Les parcours de formation des artistes que vous associez à votre projet sont très divers. Vous arrivez à la tête d’une école nationale de théâtre. Quelle serait pour vous la plus belle formation pour de jeunes acteurs ?
Je voudrais que l’Académie soit une « École monde ». Un peu comme l’Arbre monde de Richard Powers ! La plus belle formation permet aux artistes d’être autonomes, singuliers et créatifs. C’est le chemin d’une vie : savoir choisir, ne pas subir dans un métier où on attend beaucoup. L’important : le goût de l’apprentissage, de la curiosité, de l’expérimentation.
J’avais des réticences sur la promotion ultramarine, pour l’impact écologique des trajets en avion, mais cela favorise les rencontres, les croisements de regards, les singularités de récits. Cette école serait politique aussi. Je ne crois pas à l’acteur qui ne serait pas politique. Il l’est, non au sens de l’engagement – syndicaliste par exemple – mais par son corps. Donc, il faut débattre des sujets d’un point de vue théâtral. Par exemple, à l’Académie, on travaille actuellement sur la grande histoire, la petite histoire et la mémoire. Et il s’agit bien de « façons de faire du théâtre » ; non d’opinions.
Laurent Lalanne, en prise avec les écritures, est très créatif sur les dispositifs pour souder les structures, créer des synergies. En ce moment on travaille avec le Théâtre et l’Académie sur des formes liées au vivant avec deux autrices Métie Navajo et Maryline Mattei.
Conservez-vous un souvenir fort de votre propre formation ?
Je vais en évoquer deux. J’avais un prof, très « Pygmalion » ; un jour qu’il a fait une remarque très déplacée, je suis sortie du plateau. Des gradins, je me suis mise à regarder les autres. Il est important de créer une formation respectueuse, safe. Mais, finalement, ce conflit a été fondateur de mon désir d’être metteuse en scène. Au début, je pensais que c’était juste pour comprendre ce que les autres faisaient. Toutefois, c’est devenu plus fort de voir que de jouer.

J’ai aussi un très beau souvenir au CNSAD avec Sandy Ouvrier, qui travaillait alors Jon Fosse et Shakespeare. J’ai le souvenir de voir un très jeune acteur jouer Richard III avec un feu intérieur. Je me suis demandé comment une œuvre traversait le temps, comment l’incarner, comment la transmettre.
L’Académie n’exige pas deux ans de parcours en école ou en conservatoire ? Bonne chose ou pas ?
On est en grande discussion avec l’équipe de l’Académie. Il faudrait effectivement bouger les modalités du concours. Geste symbolique : j’ai demandé davantage d’autrices à travailler pour le concours. À l’ESCA, on trouve la parité ! Une école doit être ouverte. Les classes égalité des chances y participent aussi.
Quel est le sens de l’action pédagogique pour vous ?
Tous les spectacles ne sont pas visibles sans préparation, comme Angels in America qui nécessite vraiment une rencontre. L’action pédagogique est un endroit de porosité. Par exemple, il faut trouver des passerelles entre les options théâtre et l’après. Comment faire venir les aficionados hors du cadre scolaire ?
Un lieu bouillonnant de création,
un vivier, un laboratoire ouvert
Les représentations d’Angels in America en décembre ont été comme une inauguration festive de votre direction : pourquoi avoir choisi ce spectacle ? Pourquoi l’avoir associé à une table ronde avec les communautés LGBTQIA+ du Limousin ?
Les représentations avaient été interrompues par une demande d’exclusivité. On en a gardé un goût d’inachevé. Or, ce texte nous habite ; il a de multiples couleurs. De surcroit, j’aime beaucoup le répertoire : reprendre des spectacles après un long temps pour voir où ils sont arrivés. Par ailleurs, je cherchais un spectacle qui ne m’introduise pas seulement moi, mais l’équipe, même si Angels in America, c’était aussi le début d’une aventure, un moment où on m’a fait confiance. Enfin, la réflexion sur les différents impacts de la maladie sur plusieurs cercles de population permettait de parler de manière non littérale de ce qui se passe aujourd’hui. Et c’est du théâtre.

En ce qui concerne l’aspect festif, quand on présente un spectacle de cinq heures, il faut accueillir les gens avec chaleur. J’ai été très impressionnée par la manière dont Ariane Mnouchkine métamorphosait la Cartoucherie pour chaque spectacle avec toute une équipe. Je m’en suis inspirée.
Quant à la table ronde, Vincent Pavageau était étudiant sur des projets de conservatoire à l’Aquarium. On avait travaillé autour d’Angels in America et il s’est installé dans la région. Il savait que je candidatais à Limoges et on avait échangé sur les communautés LGBTQIA+ en Creuse et en Limousin. À Paris, on avait beaucoup rencontré des militants, plutôt en rapport avec la lutte contre le sida, et ils nous avaient expliqué que le théâtre qui se dit « militant » ne rencontrait jamais… les militants. De plus, on ne voulait pas faire quelque chose de trop théorique, ni d’importé de Paris. Je trouvais les pistes de Vincent Pavageau pertinentes sur les représentations, les problématiques d’affirmation et le travail des associations. J’ai rencontré des personnes ressources et c’était un moyen de dire : « Ici, ensemble on peut avancer sur ces questions ».
Le théâtre de l’Union s’est vu métamorphosé par cet évènement : costumes, couleurs, affichage ? Quelle métamorphose voudriez-vous matériellement pour le théâtre de l’Union ?
Je voulais réfléchir à la façon dont un spectacle laisse des traces. Les affiches sont importantes aussi parce que l’écriture est un motif d’Act Up. L’équipe de l’Union a donc accompagné le public jusqu’à la salle, avec un accueil haut en couleurs.
Concernant la métamorphose, je m’interroge toujours sur les fantômes dans les lieux. Chaque théâtre a une histoire –ici, notamment l’histoire de la coopérative – mais les fantômes ne doivent pas être plus grands que nous. Les spectres doivent être sur scène, comme chez Shakespeare.
Comme le dit Tony Kushner, il faut pouvoir parfois faire peau neuve. Le monde a bougé autour de nous. On a donc un projet de transformation qui passe par de petits gestes symboliques, comme la bibliothèque. Comment penser un théâtre sans livres accessibles aux spectateurs ?! Mais notre réflexion porte aussi sur les circulations, l’accessibilité, l’accueil, la façade.
Et, très important : le rapport entre l’Académie et le Théâtre de l’Union. Aujourd’hui, rien n’indique ce lien ! Il faut qu’on raconte ce que ce lieu est devenu et l’horizon souhaité : un lieu bouillonnant de création, un vivier, un laboratoire ouvert. C’est un service public, ouvert à tous et tous. On est un croisement de discussion. C’est un vrai chantier. ¶
Propos recueillis par
Laura Plas
Théâtre de l’Union, centre dramatique national • 20, rue des Coopérateurs • 87006 Limoges • Tel. 05 55 79 90 00
Académie de l’Union, École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin • Le Mazeau • 87480 Saint-Priest-Taurion
À découvrir sur Les Trois Coups :
☛ Angels in America, de Tony Kushner, au Théâtre de l’Aquarium
☛ Soldat.E Inconnu.E, de Sidney Ali Mehelleb, Théâtre Ouvert, à Paris, par Laura Plas