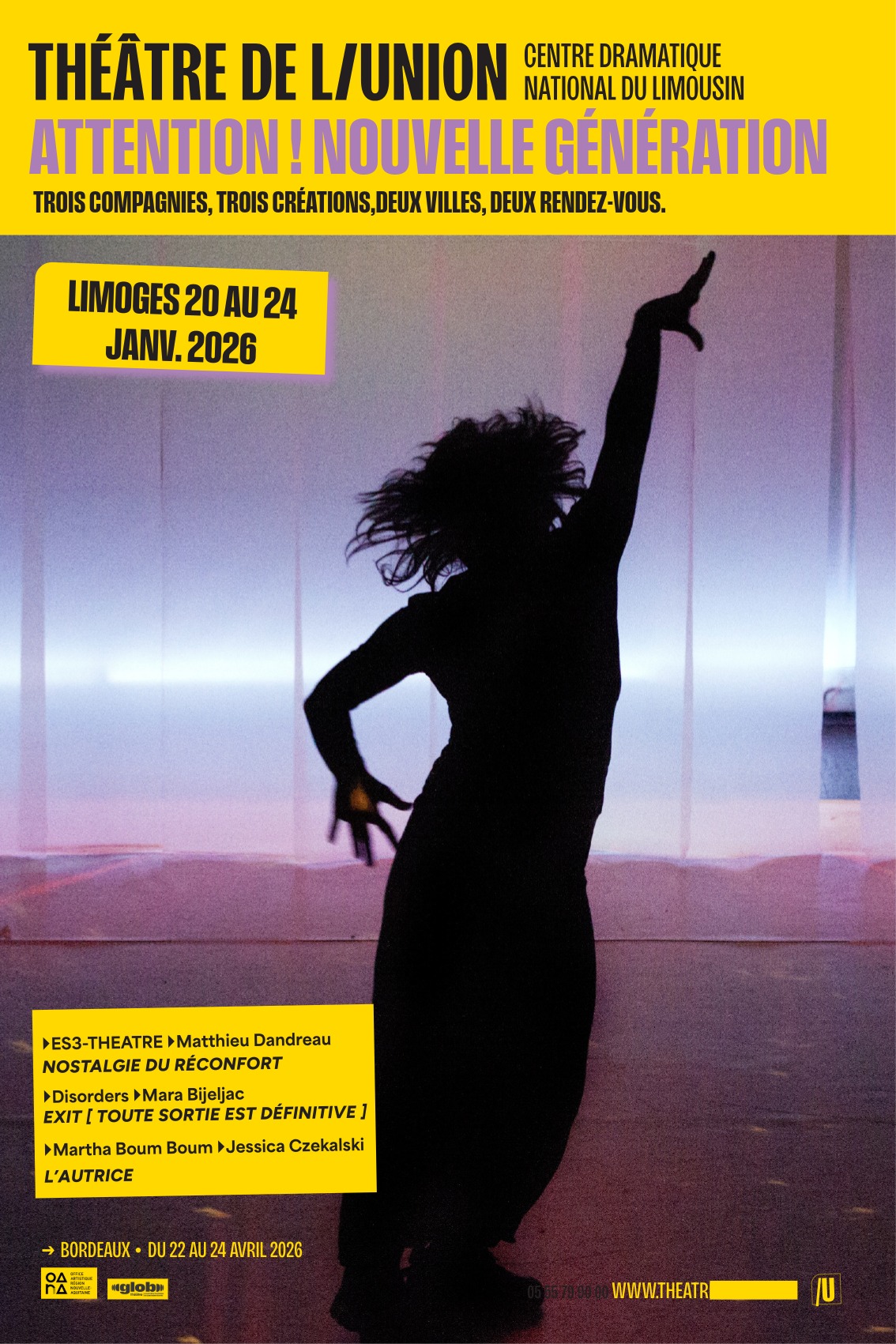Des ciments si fragiles de la réalité
La folie, qu’elle soit fureur ou douce altération du réel, est un rapport au temps, semble nous dire le théâtre. Une distorsion de ses ondes où les échos de chocs et d’images lointaines viennent se frayer des passages dans un présent qui a parfois l’impudence de la rigidité. Le fou n’est le « fêlé » que parce qu’il effrite les mille murailles du réel. Bien sûr, il y a l’hybris grecque, la folie dont les dieux frappent les mortels à l’orgueil impie. Il y a encore la mélancolie et son cortège éthéré de paradis artificiels et ce fameux refoulement, vase nauséabonde dont Freud a tartiné le xxe siècle. Bien sûr.
Seulement, à travers tout cela, restent le temps transgressé et l’espace de son abolition radicale. On en sort parfois, mais on est joué souvent, car les faiblesses sont offertes, béantes, aux jeux de toutes les manipulations. Car la clairvoyance est puissance sur l’homme aux temps défaits, elle le dirige, le conduit. La littérature se délecte de pointer ce pouvoir aux ressorts de tragédie bouffonne, mais le théâtre sait rendre palpable ce bruit ténu du mur où résonnent les innombrables fissures dont sont faits les vivants.
Lise Facchin
Iago « hait l’Arabe »
Par Louise de Ravinel
Les Trois Coups
Cette libre adaptation d’« Othello » par Olivier Saccomano est à la fois un hommage et une contre-enquête. Un fil périlleux mais bien tenu.

Cette variation pour trois acteurs reprend la trame de l’œuvre initiale. Le général Othello, Maure au service de la république de Venise, vient d’épouser la noble Desdémone. Son sous-lieutenant, Iago, insinue qu’elle le trompe avec le jeune Roderigo. Mordu par la jalousie, Othello finit par en être convaincu et la tue. De l’œuvre de Shakespeare, Olivier Saccomano reprend également la construction rhapsodique ainsi que certains détails dramaturgiques, comme les stratagèmes mis en place par Iago pour parvenir à ses fins. Comme nous l’indique le sous-titre, la modalité condensée – trois actes au lieu de cinq, les personnages secondaires effacés ou bien tout à fait éliminés – a pour effet de rendre l’œuvre « jouable » pour trois acteurs. Un exercice risqué, certes, mais dont l’auteur a su déjouer l’écueil avec une grande maîtrise. Cela étant, cette accélération va au-delà de la forme, puisqu’elle vient en effet interroger le mobile d’Iago, et par écho celui d’Othello. Comme si l’on décidait enfin de tirer au clair toute cette histoire.
Shakespeare nous laissait entendre que les motivations du sous-lieutenant étaient nourries de sa certitude que son épouse avait un faible pour Othello. Pour Saccomano, ce qui pousse Iago à la manipulation, à la destruction d’un homme et d’une femme, ce n’est pourtant pas la jalousie. Ce n’est pas non plus, comme nous le suggérait le texte original, pour le plaisir de saccager la beauté d’un amour simple et sincère. Non. Dans la variation d’Olivier Saccomano, si Iago méprise visiblement l’amour – « Ce que vous appelez l’amour n’est qu’une petite bouture, une malheureuse pousse » 1 –, ce n’est pas là que réside son caractère diabolique : il « hai[t] l’Arabe » 2. Sa haine ici n’est pas vaste, mystique, ancestrale, mais précise, construite en système racial. Et là où l’auteur frappe fort, c’est que le moteur d’Iago sera également l’outil dont il se servira pour convaincre Othello de l’impureté de Desdémone : « […] Avoir repoussé tant de prétendants / De son pays, de sa culture, de son milieu… / Naturellement, c’est vers eux qu’elle aurait dû aller… / Il faut croire que le désir s’éloigne parfois de sa pente naturelle / Et ouvre la porte à toutes sortes de fantasmes, d’étranges perversions. » 3. C’est donc à cet endroit, pour Saccomano, que se situe la réelle perversion : la force d’un discours raciste ingéré, devenu autodétestation.
Qu’on se comprenne bien, cet élément n’était pas absent chez Shakespeare, qui avait tout de même décidé de sous-titrer son œuvre « le Maure de Venise ». La couleur de la peau était ainsi largement mise en lumière, mais la pièce de Shakespeare explorait avant tout la passion : l’envie, la jalousie et la colère se matérialisant en un acte de démence. En cela, c’était une tragédie intime. Dans cette nouvelle variation, il n’en est que peu question. Ni l’installation du doute ni la montée de la folie n’intéressent véritablement Saccomano chez qui la volonté de rationnaliser, de politiser l’intrigue est claire, assumée, et il faut le dire, réussie.
Un nouveau mal
La place centrale est laissée ici au capitalisme. La scène ii de l’acte I, l’expose très clairement : Iago conseille son ami Roderigo, amoureux de la belle Vénitienne et désespéré à la suite de son mariage avec Othello. S’il ne cache pas son mépris pour le sentiment amoureux, cela ne l’empêche pas d’utiliser la tristesse de Roderigo pour servir au mieux son plan. Le discours qu’il lui soumet afin de le convaincre que tout n’est pas perdu est alors fondé sur une seule chose : sa fortune. Sans oublier de réclamer sa commission, Iago argumente que l’argent saura séduire Desdémone, car la femme, et plus particulièrement la femme vénitienne, est avide et vénale. Elle n’aime pas l’homme : elle le consomme ; et bien vite, elle « l’échangera » contre plus riche.
Iago, déjà porte-parole de la haine raciale, devient également celui de la haine de la femme et d’un capitalisme qui laisse le cœur de l’homme vide et capable du pire. Il ne s’agit pas d’une critique glissée en sourdine, la mécanique de la tragédie et la logique capitaliste sont clairement mises en parallèle. Dans les scènes de distanciation (prologue, entractes), les trois acteurs se préparant à jouer la pièce n’hésitent pas à en utiliser le vocabulaire : « Quand une bulle “spéculative” atteint son plein développement, il faut s’attendre à un éclatement brutal » 4. Par cela, l’auteur paraît ériger le capitalisme en nouvelle fatalité, prenant la place des forces divines et métaphysiques que l’on entend gronder dans les vers de Shakespeare.
Il semble que le défi énoncé dans la préface d’Olivier Saccomano, trouver « une entrée contemporaine dans cette ancienne histoire » 5, soit bel et bien relevé. Les moteurs de la tragédie se sont transformés, mais ils tournent toujours à plein régime. ¶
Louise de Ravinel / illustration : Vincent Croguennec
- Othello, variation pour trois acteurs, d’Olivier Saccomano, Les Solitaires intempestifs, 2014, p. 46.
- Ibidem, p. 47.
- Ibidem, p. 72-73.
- Ibidem, p. 99.
- Ibidem, p. 10.
Othello, variation pour trois acteurs, d’Olivier Saccomano
Librement traduit et adapté d’Othello, le Maure de Venise, de Shakespeare
Les Solitaires intempestifs, 2014
112 pages, 10 €
Othello, variation pour trois acteurs, mis en scène par Nathalie Garraud :
- les 26 et 27 février au Fracas à Montluçon
- du 4 au 7 mars au Théâtre du Grand‑Marché à Saint-Denis de la Réunion
- les 12 et 13 mars au Séchoir à Saint-Leu et du 17 au 19 mars au service culturel de Riom
Cherchez la voix
Par Élisabeth Hennebert
Les Trois Coups
« Sirènes » de Pauline Bureau donne à la banalité d’un drame familial tout l’éclat du chant des sirènes. Surprenant et ensorcelant.

Bien sûr, il y a l’histoire du grand-père qui est parti avec une blonde et s’est bricolé un deuxième lit, un deuxième enfant, un deuxième foyer. Bien sûr, il y a les petites et grandes névroses des héritiers à qui on cache tout et on ne dit rien, le blues des plaqués… comme dans toutes les familles et comme dans tout le théâtre, depuis Médée jusqu’à la Femme du boulanger. Voilà pour le petit habit, étriqué et moche à souhait, de l’intrigue. Oui, mais Pauline Bureau est une brodeuse de très grand talent. Elle a le sens de l’ornement, et toute l’élégance de cette pièce est dans la fioriture sur le costume.
D’emblée, puisque c’est le titre, la trame dramatique est annoncée comme une variation sur le mythe de la femme-poisson 1. On part de cette idée toute bête que le papy marin s’est fait vamper par une sirène de bar. Mais on va beaucoup, beaucoup plus loin, et mon envie de vous révéler jusqu’où… se bat contre mon respect du droit du lecteur à ne pas connaître la fin tout de suite. Disons juste qu’à partir du thème de la sirène (la Petite, mais aussi celle d’Ulysse et encore, pourquoi pas soyons fous, celle de Disney), c’est tout l’univers de la voix qui est exploré. Quel sujet plus magnifiquement théâtral que celui-ci ! À la métaphore de la voix comme image de l’inconscient familial qui file tout au long de la pièce, s’ajoute le rythme haletant d’une construction bien ficelée.
Personnages à la dérive sur un océan matérialiste
Pas un instant, le lecteur n’a l’impression de se noyer dans un traité ardu de psychanalyse ou de s’engloutir dans le marécage du nombrilisme familial. L’inconscient est omniprésent, mais délicatement représenté par cette poétique image de la voix qui tantôt s’exprime tantôt se tait et laisse alors le non-dit triompher. Voix séduisante, voix de cauchemar, voix perdue, voix retrouvée, voix cassée, voix suave : l’onde sonore baigne toute la pièce comme une basse continue sur les relations familiales qui tantôt chantent tantôt grincent.
En même temps, le principe de réalité est sans cesse rappelé par tous ces objets absurdes dans lesquels se cognent les amours nouées, dénouées, brisées, rêvées : le téléphone, les meubles de cuisine, les pilules ou encore les bouilloires qui ont le fin mot de l’histoire et constituent un fil conducteur inattendu. Le petit fourbi du capitalisme mondialisé est bien envahissant puisque, de Shanghai au rayon électroménager de chez Darty, en passant par les bancs de H.É.C., tous les personnages consacrent leur temps à vendre et à acheter des objets, et même parfois des gens. Au passage, quelques phrases mémorables émaillent le bling-bling du business, telle la magnifique : « N’oubliez jamais que tout objectif flou conduit irrémédiablement à une connerie précise » 2.
À bien y réfléchir, c’est de ce va-et-vient permanent entre trivialité du quotidien et poésie tantôt maladive tantôt salvatrice de l’inconscient que naît la puissance d’envoûtement de cette pièce. Car envoûté on est, et envoûté on demeure. Il est vrai qu’on reste un peu sur sa faim, tout de même, quand cette très courte pièce s’achève.
Peut-être Pauline Bureau aurait-elle pu broder quelques points de plus en explorant d’autres mythes d’ensorceleuses à la voix mortifère : de la Marie Morgane des Bretons à la Lorelei qui tue les mariniers du Rhin et qu’on retrouve de manière inattendue en Marilyn Monroe dans Les hommes préfèrent les blondes 3. Non, finalement, cette forme gracile et gracieuse convient très bien. Longue vie à Pauline Bureau et son invraisemblable agilité à décortiquer les névroses familiales et les mythes comme autant de pistaches. C’est de la bonne graine. ¶
Élisabeth Hennebert / illustration : Oscar Viguier
- Les sirènes sont des femmes-oiseaux dans la mythologie grecque et des femmes-poissons dans les mythologies scandinaves et germaniques. Mais ce sont toujours les navigateurs qui boivent la tasse.
- Sirènes, de Pauline Bureau, Actes-Sud, 2014, p. 28.
- Les hommes préfèrent les blondes, de Howard Hawks, XXth Century Fox, 1953. Vous croyez que c’est par hasard que la blonde qui séduit les yachtmen s’appelle Lorelei ?
Sirènes, de Pauline Bureau
Actes Sud-Papiers, novembre 2014, I.S.B.N. 978-2-330-03798-7
46 pages, 12 €
La pièce a été créée en janvier 2014 au Théâtre de Dijon-Bourgogne et reprise au Théâtre du Rond-Point à Paris.
Elle sera jouée le 17 mars
- à Cesson-Sévigné http://www.ville-cesson-sevigne.fr/saison-culturelle-2014-2015-mars.html
- le 21 mars à Saint-Quentin-en-Yvelines http://www.leprisme.agglo-sqy.fr
- le 27 mars à Chevilly-Larue http://www.theatrechevillylarue.fr
Quand Papy se fait ses films…
Par Michael Martin-Badier
Les Trois Coups
François Emmanuel s’amuse d’un vieux qui n’a plus toute sa tête ou juste assez pour faire revivre ce qu’il pense avoir été le bon vieux temps. Une ultime fois, ceux qui l’assistent vont lui rafraîchir les idées, mais pas comme il l’espérait.

Il y a un théâtre de la mémoire, et un théâtre sur la mémoire. Dans Partie de chasse se joue un théâtre de la réminiscence qui fait rejaillir les souvenirs, surgir les vérités escamotées. Comment parler de l’engloutissement de la mémoire, de la vieillesse, des vieux qui perdent la tête, et de ce qu’ils choisissent parfois d’oublier ? L’auteur met en scène, dans le huis clos lugubre d’une propriété vétuste, un veuf abandonné aux bons soins de ses serviteurs, et coupable d’un crime qu’il ne se rappelle pas avoir commis. Exigeant de faire rejouer, chaque année par ses deux domestiques, les derniers moments, les ultimes souvenirs de tendresse qu’il aurait échangés avec sa femme, Monsieur réécrit cette fois-ci le scénario en version film noir.
Intérieur nuit. Salon des Shattonborough. Pour la dix-septième année, Mitty et Arnold doivent reconstituer, façon « qui a tué le colonel Moutarde ? », ce qu’a été cette dernière soirée de Monsieur avant que sa mémoire ne vacille. Une soirée mondaine, réunissant ceux qui ont été les chers amis d’antan habitués des parties de chasse. Les deux employés les incarnent tous, selon une partition de didascalies minutieusement écrite par l’auteur, qui impose par là même une certaine idée d’interprétation de la pièce. De même, le décor, minimal mais très précisément énuméré, participe de ce ton grinçant, cette ambiance lourde et jaunâtre. Les souvenirs de ce vieux monsieur sont, aux yeux de ses deux aides, à l’image des velours élimés de leurs uniformes et des toiles d’araignée suspendues aux candélabres. Humour chez les employés moqueurs, détresse de l’homme fatigué d’oublier. On n’est pas loin des références du cinéma de Bertrand Tavernier et Claude Chabrol, tant dans leur langage que dans leur traitement de dynasties vieillissantes qui s’accrochent à leurs vieux rêves, raillées par ceux qui les servent.
C’est fini la mascarade !
« On est fatigués de jouer les utilitaires dans le théâtre de la mémoire de Monsieur » 1. Prise de position définitive des domestiques, dont la lecture se déploie de plusieurs façons. D’abord en référence au théâtre de Marivaux, dans lequel maîtres et valets s’échangent l’habit juste le temps de s’essayer au monde et de l’appréhender d’un autre point de vue social. Mitty et Arnold, eux, jouent le travestissement par la parole – et non pas par le costume – et n’ont pas d’alternative que d’interpréter, de répéter chaque année les simulacres d’une aristocratie maintenant disparue. Seul le maître y prend encore plaisir. Les valets, eux, n’en retirent plus que leur salaire, avec une certaine forme de sadisme. Fatigués de devoir toujours camper les mêmes rôles, ils nous disent que l’habit ne fait plus le moine, en tout cas pas la noblesse. Ils signent ici la fin de l’entretien rituel des souvenirs poussiéreux d’une aristocratie de province avilissante, élite de faux jetons et de pique-assiette aux mœurs immorales. Quand Monsieur veut se rappeler les heureuses scènes de sa vie, les serviteurs sont les mieux placés pour lui rafraîchir tout le théâtre de sa mémoire, et lui livrer jusqu’aux secrets échangés dans les coulisses.
Y a-t-il prescription ?
L’homme est veuf, sans famille, au milieu des ruines d’un domaine, à l’image de son esprit qui se délite, rongé par les dettes. Il n’a même plus ses souvenirs pour égayer les quelques années qu’il lui reste à vivre. Bref, la solitude. Celle que l’on ne souhaite à personne. Pourtant cela n’empêche pas Mitty et Arnold d’emmener ce fossile un peu plus près du désespoir, comédie sur fond de cruauté. Ce vieillard en fin de vie, c’est tragique, et ils en rient. À travers ce jeu de pouvoir menant à l’inversion des rôles de maître et valets, le chasseur criminel devient la proie. À terre, dépouillé de ses illusions et confronté à ses crimes, ne demeure que l’espoir ou ses réminiscences d’amour. Au-delà de sa lecture, la pièce nous interroge : doit-on les lui laisser ou doit-on l’achever ? Faut-il abattre du gibier pour bien finir une partie de chasse ?
De façon générale, les vieux qui perdent la tête perdent à la fois leur histoire, mais aussi leur autorité et leur puissance face au monde. Partie de chasse complexifie ce problème en mettant dans la balance la responsabilité de l’homme devant ses crimes passés. Mais c’est bien cette question du pouvoir que l’on s’octroie sur ceux qui faiblissent qui est le sujet de cette apparente comédie, scénarisée avec humour et style. Sa dernière scène, d’ailleurs, résonne comme le coup de fusil que l’on entend parfois au loin dans la forêt, toujours suivi de ce silence qui nous interroge : une bête est-elle morte ? ¶
Michael Martin-Badier / illustration : Frédéric Chaume
- Partie de chasse, de François Emmanuel, Actes Sud-Papiers, Arles, 2007, p. 29.
Partie de chasse, de François Emmanuel
Actes-Sud Papiers, 2007
49 pages, 9,70 €