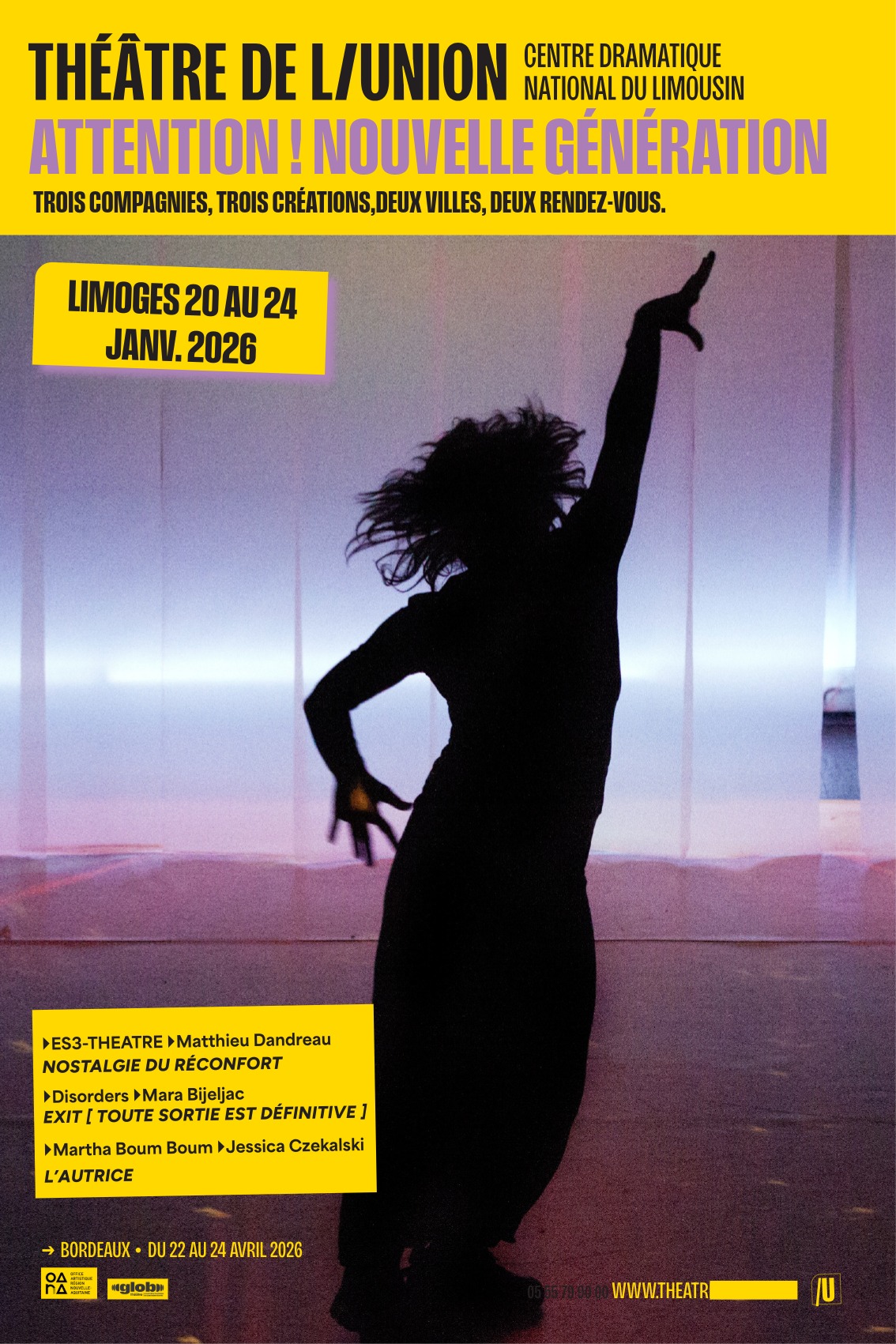Des pépites et des ratés
Par Trina Mounier
Les Trois Coups
Pourtant soumis aux mêmes contraintes d’un théâtre de tréteaux, pauvre, immédiat, réduit à un texte et des comédiens, les spectacles présentés par ce jeune festival ne se ressemblent pas. C’est ce qui en fait la richesse. Les risques aussi.
Louise Vignaud a reçu en partage aléatoire, Vadim à la dérive, d’Adrien Cornaggia. Texte et mise en scène sont dédiés aux jeunes spectateurs. Ce choix constitue une première pour En acte(s). Il s’explique sans doute par la nomination à la tête des Clochards célestes, qui œuvre depuis des années en direction du jeune public, de Louise Vignaud, un des piliers du festival.
Copie à revoir pour le jeune public
Force est de constater que le résultat est extrêmement décevant. Nous voici propulsés au sein d’une famille d’aujourd’hui où chacun hurle pour être écouté dans une cacophonie parfois joyeuse, mais où personne ne prête attention à personne, notamment pas le petit Vadim. Voilà sûrement la trouvaille la plus intéressante du spectacle : ce Vadim que nous n’entendrons pas est perdu dans le noir, sans doute quelque part au milieu des spectateurs. Quand ses frères et sœurs veulent lui parler, ils le cherchent des yeux sans succès : Vadim est introuvable. C’est à peine s’il existe. Cela aurait pu être un sujet en soi. Malheureusement, il reste lui aussi, comme Vadim, souterrain. Il y a fort à parier qu’un enfant d’une dizaine d’années n’y sera guère sensible, par ailleurs, on l’appâte avec des scènes burlesques, hautes en couleur, des mimiques de clown, des acrobaties avec vols planés, un vocabulaire caca-prout envahissant (revisité xxie siècle merde-vomi-pisse) et porté à plein gosier par des personnages forts en gueule.
Certes, voici l’occasion pour les comédiens de numéros d’acteur qui ont au moins le mérite de prouver leur savoir-faire. Ils campent des types immédiatement reconnaissables comme la mère en fin de grossesse qui traîne son épuisement la main sur le ventre, le tonton ivrogne, le père dépassé ou les ados caractériels.
Mais on reste sur sa faim. Qu’a donc Adrien Cornaggia à dire ? Comment espérer le faire entendre quand tout concourt à le rendre inaudible ? Bien peu convaincant tout cela.
Émouvant et convaincant
Autrement troussé est « Rien que la nuit » d’Alison Cosson, une fable que n’aurait pas reniée Ionesco. Un couple vit tranquille dans sa maisonnette avec petit jardin jusqu’à l’arrivée de bétonnières chargées d’élever un mur en lieu et place du carré de verdure. Bien entendu, ils ont été prévenus, on est (toujours) en démocratie. Mais on comprend vite qu’ils n’ont guère eu la possibilité de poser des questions, encore moins de s’opposer. Dans ce couple que les années n’ont pas usé, l’amour circule, donnant matière à quelques scènes touchantes et magnifiques. Mais quelque chose s’immisce, de l’ordre de la peur, d’une de ces peurs dont on ne peut parler. De ce monde oppressant, on ne verra que le marionnettiste, un sale type entre bonimenteur de foire et promoteur. Trump et son mur ne sont pas loin. Ils sont même là, tout près, pleins de fausses promesses et de menaces à peine voilées : après tout, ce mur est fait pour protéger les citoyens. Et pour tenir à l’extérieur ces étrangers si prompts à se faufiler là où on ne les veut pas.
Menée par un Thomas Poulard incisif comme à son habitude, cette pièce est passionnante, ouvrant une multitude de pistes, mais surtout faisant la part belle à l’humanité des personnages. Thomas Poulard dirige ici quatre comédiens très engagés dont le naturel dans l’interprétation est en tout point remarquable, notamment en ce qui concerne Éloïse Hallauer, Stéphane Kordylas et Valérie Marinèse. Le rôle incarné par Maxime Mansion, mi-ogre mi-Monsieur Loyal (qui n’a rien de loyal), joue sur un registre d’un tout autre style. Surgissant tel un diable d’une boîte quand on l’attend le moins, tout sourire carnassier dehors, genre séducteur de foire, il est inquiétant à souhait. Un très beau moment de théâtre.
Intelligent et dynamique
Dans le même registre qui consiste à jeter un regard empathique sur les damnés de notre époque, Part-Dieu suit le parcours (si l’on peut appeler parcours le fait de tourner en rond) d’un jeune exilé du Congo, Théodore. Quand le récit commence, au terme d’un voyage où il est ballotté sans jamais rien comprendre à ce qu’on fait de lui, celui qui n’est encore qu’un enfant débarque à la Part-Dieu. C’est là qu’il reviendra sans cesse, dans cette plaque tournante et gigantesque salle des pas perdus. Julie Rossello-Rochet va le montrer aux prises avec cette monstrueuse machine à broyer qu’est l’administration. Pourtant, le texte n’est jamais misérabiliste. Au contraire, Théodore a de la chance dans son malheur. Il tombe toujours sur des hommes de bonne volonté. Mais la bureaucratie est tatillonne et stupide, elle dépense des fortunes d’examens pour déterminer avec ce qu’elle croit être l’exactitude l’âge réel du jeune homme, lequel sera évalué finalement, ô ironie cruelle entre 21 ans et 37 ans ½ ! Âge dont dépendront la prise en charge, les droits, etc.
Mi-oratorio (sans musique), mi-récit, Part‑Dieu alterne séquences descriptives, souvent très poétiques, didascalies qui seront la seule concession à l’émotion (« il pleure »), elle-même subtilement adoucie par des métaphores – les larmes de Théodore finissent par tremper le banc puis le sol –, et enfin courtes scènes dialoguées illustrant des situations types : Théodore en garde à vue, Théodore chez le conseiller d’orientation, Théodore et le radiologue, etc. Ces ruptures créent une succession d’émotions qui vont du rire à la colère ou à l’écœurement. L’écriture, très dynamique, est encore renforcée par la mise en scène de Julie Guichard qui utilise les quatre comédiens comme un chœur, dont ils se détachent pour jouer un rôle qu’ils ne conserveront pas dans la séquence suivante. Théodore passe donc de l’un à l’autre, il est plusieurs, il est nombreux. Face à lui, les petites mains de la grande machine sont multiples, plurielles elles aussi. Un dernier mot des comédiens, sobres, justes et précis qui composent une espèce de chorégraphie comme dans ce début où la journaliste marche à contre-courant d’une manifestation. Ils sont quatre, on les dirait quatre cents. Ou bien cette scène où Maxime Mansion mime un scanner avec ses seules mains, une feuille de papier et des bruitages sortis de sa gorge. Part‑Dieu est à la fois une belle histoire, utile, indispensable même, et un spectacle intelligemment mené, subtilement interprété.
Au final, un festival plein de vie, engagé, offensif. À l’année prochaine… et d’ici là, bon vent ! ¶
Trina Mounier
Vadim à la dérive, d’Adrien Cornaggia
Mise en scène : Louise Vignaud
Avec : Charlotte Fermand, Thomas Guéné, Amine Kidia, Sven Narbonne et Marion Petit‑Pauby
Les 14 et 15 mars 2017 à 14 heures et 19 heures
Théâtre des Clochards-Célestes • 51 rue des Tables‑Claudiennes • 69001 Lyon
04 78 28 34 43
Rien que la nuit, d’Alison Cosson
Cie du Bonhomme
Mise en scène : Thomas Poulard
Avec : Éloïse Hallauer, Stéphane Kordylas, Maxime Mansion et Valérie Marinèse
Illustrations : Thomas Beauvais
Les 15, 17 et 18 mars 2017
L’Élysée • 14, rue Basse‑Combalot • 69007 Lyon
04 78 58 88 25
Part-Dieu, de Julie Rossello‑Rochet
Cie Le Grand Nulle Part
Mise en scène : Julie Guichard
Avec : Ewen Crovella, Maxime Mansion, Benoît Martin et Nelly Pulicani
Illustrations : Irène Vignaud
Les 14, 16 et 18 mars 2017
L’Élysée • 14, rue Basse‑Combalot • 69007 Lyon
04 78 58 88 25
Festival En acte(s) du 7 au 11, puis du 14 au 18 mars 2017 à l’Élysée et au Théâtre des Clochards-Célestes
Le festival En acte(s) est soutenu par la S.A.C.D., la Spedidam et la ville de Lyon
Pendant le festival, les illustrations en lien avec chacun des spectacles sont exposées dans le hall du théâtre.