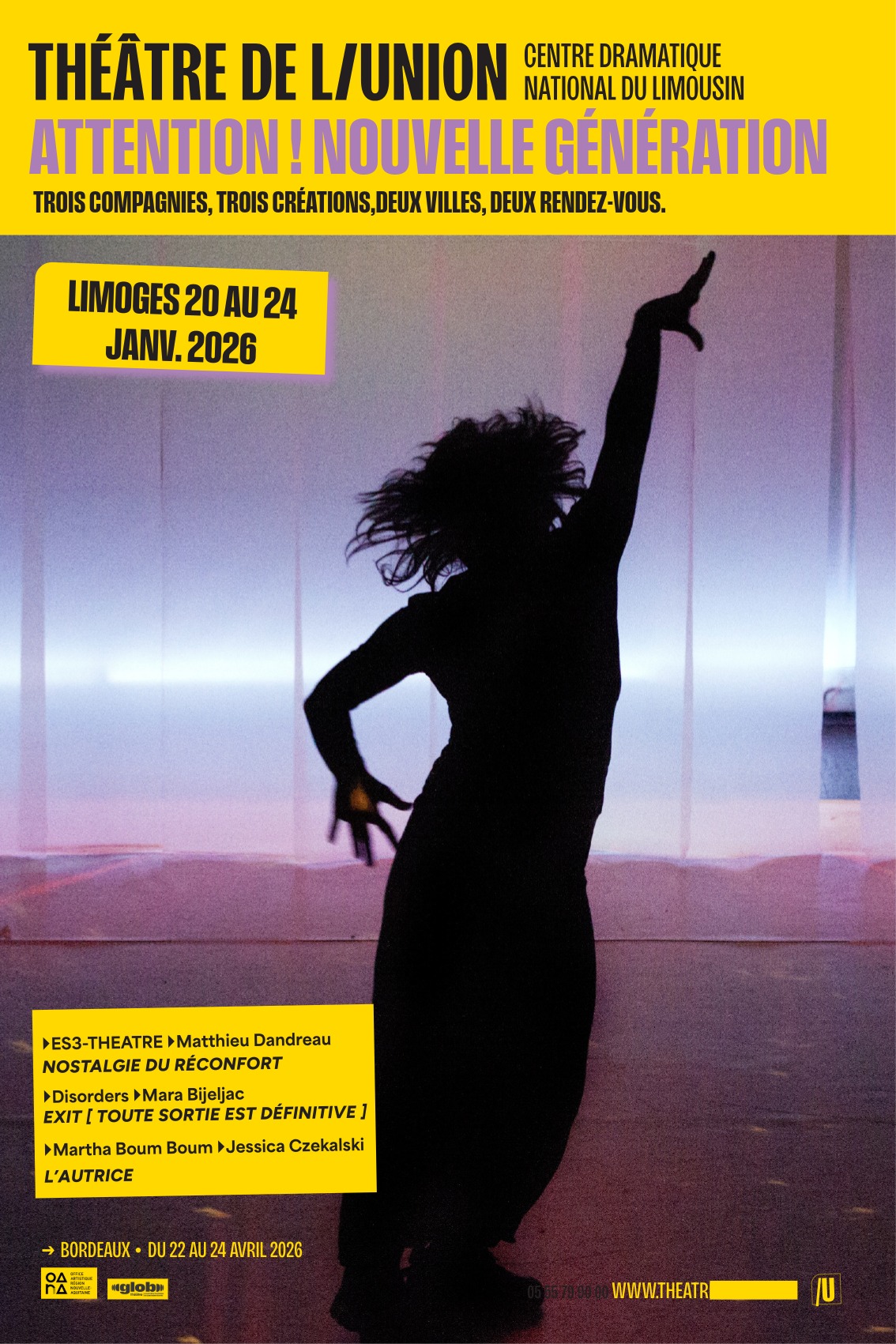De tout son soûl
Par Léna Martinelli
Les Trois Coups
Après Robert Wilson, Peter Stein et Luc Bondy, c’est au tour de Jean Bellorini de travailler avec la troupe du Berliner Ensemble. Après sa création en Allemagne, « le Suicidé », est présenté au Théâtre Gérard‑Philipe, où il remporte un triomphe bien mérité.
Nous sommes dans l’Union soviétique à la fin des années 1920. Poussé par une soudaine envie de saucisson, Semione, chômeur, réveille sa femme en pleine nuit : « On ne peut pas continuer à vivre comme ça ! ». Furieux, il disparaît. Craignant qu’il ne mette fin à ses jours, Macha court chercher de l’aide. Retrouvé dans la cuisine où il tente simplement de satisfaire sa faim, Semione apprend qu’on lui prête l’intention de se suicider. Il accepte alors cette idée qui lui « facilite la vie », car en se tuant, il peut enfin devenir quelqu’un.
En effet, toute une galerie de personnages pittoresques cherche à récupérer sa mort pour servir leur propre cause. Un héros qui révèle la conscience de tout un peuple… La gloire posthume : quelle revanche ! Voilà sa révolution. Mais rebondissement quand les hommages officiels honorent la dépouille. Ivre, Semione l’est surtout de la vie.
Politique et métaphysique
Le Suicidé est une pièce sur le sens de l’existence. Une métaphore de la vie dans un régime où l’on survit, envers et contre tout. Une comédie féroce sur l’importance des idéaux, même si cette « grande gueule » apprend à la fermer. Comme son personnage, le russe Nicolaï Erdman n’a‑t‑il pas fini par accepter de chuchoter ? Car, contraint à l’exil, l’auteur a finalement consenti à fournir des écrits politiquement corrects. « Mourir pour vivre ! ».
Une masse immense de masses sans homme.
Victime de la censure (il faudra attendre 1987 pour que le Suicidé, interdit en 1932, soit enfin publié), Nicolaï Erdman livre une virulente critique du communisme. Mais au‑delà des enjeux sociaux et politiques, c’est la dimension humaine et métaphysique qui importe. À ce titre, la scène du banquet est une grande réussite. Tous réunis, les personnages chantent, boivent. Ils fêtent l’entrée d’Hermione dans l’histoire. On passe de l’allégresse au désespoir le plus profond. Ce sont alors plusieurs décennies de dictatures qui défilent : « Ce qu’un vivant peut penser, seul un mort peut le dire », clame un des personnages. C’est la grande roue de l’histoire russe qui tourne à vide : « Une masse immense de masses sans homme », déplore un autre. Et le héros, qui doit en finir, s’interroge sur le sens de la mort. Pourtant, l’absurdité de la situation fait rire.
On pense à Labiche, pour la veine tragi-comique. Les scènes de ménage, les grivoiseries et les quiproquos auraient aussi plu à Feydeau. Les portes claquent, comme les langues. De malentendus en rebondissements, la pièce s’emballe de façon permanente. Comme la folie du monde qu’elle dépeint. Une humanité dépourvue de sens.
Un chœur soudé
Jean Bellorini exploite ces tensions, jusqu’à l’os. Il pointe les contradictions, y compris grâce au choix des musiques. Ressources populaires, mais aussi classiques, surviennent en contrepoint. Toujours attentif à restituer la musicalité du texte, Bellorini mène de main de maître les comédiens du Berliner Ensemble, biberonnés à Brecht. Comme eux, le metteur en scène aime jouer sur les contrastes et s’amuser avec les conventions théâtrales. En vrai chef d’orchestre, il impose un rythme soutenu, aidé aussi par la présence de musiciens sur le plateau.
En véritables athlètes, les interprètes de cette impressionnante troupe incarnent ces « fous » avec un talent hors norme, entonnant même des chants traditionnels russes ou tsiganes avec une facilité déconcertante. Au cœur de ce tourbillon funèbre, Giorgios Tsivanoglou campe magistralement le rôle principal du bouffon.
Que ce soit sur les passerelles métalliques ou autour de la table, tous évoluent dans une scénographie remarquable qui illustre bien cet engrenage infernal. De marches inaccessibles à un petit escalier en colimaçon, ils gravissent les plus hauts sommets du jeu. Un décor bien inspiré, éclairé par des loupiotes de fortune, pour l’ambiance foraine, et des néons qui soulignent la cruauté du système. Comme toujours, les lumières de Jean Bellorini sont divines. D’un expressionnisme qui résume la beauté de la vie malgré la noirceur du monde.
Ces artistes font résonner fort la belle langue de Nicolaï Erdman. Une langue qui porte loin. Et c’est tant mieux, car on peut enfin entendre cet auteur trop longtemps réduit au silence. ¶
Léna Martinelli
le Suicidé, de Nicolaï Erdman
Traduction du russe : Thomas Reschke
Mise en scène : Jean Bellorini
Avec la troupe du Berliner Ensemble : Carmen‑Maja Antoni, Annemarie Brüntjen, Anke Engelsmann, Ursula Höpfner‑Tabori, Hanna Jürgens, Michael Kinkel, Matthias Mosbach, Joachim Nimtz, Luca Schaub, Martin Schneider, Veit Schubert, Marina Senckel, Felix Tittel, Georgios Tsivanoglou
Et avec : Timofey Sattarov (accordéon), Philipp Kullen (batterie)
Assistanat à la mise en scène et costumes : Camille de la Guillonnière
Assistanat aux costumes : Wicke Naujoks
Dramaturgie : Dietmar Böck, Miriam Lüttgemann
Lumière : Jean Bellorini, Ulrich Eh
Photos : © Guillaume Chapeleau
Théâtre Gérard‑Philipe • salle Roger‑Blin • 859, boulevard Jules‑Guesde • 93200 Saint‑Denis
Réservations : 01 48 13 70 00
Site du théâtre : www.theatregerardphilipe.com
Du 12 au 16 octobre 2016, du mercredi au samedi à 20 heures, dimanche à 15 h 30
Durée : 2 heures
Spectacle en allemand, surtitré en français
28 € | 17 €
Autour du spectacle : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du 16 octobre