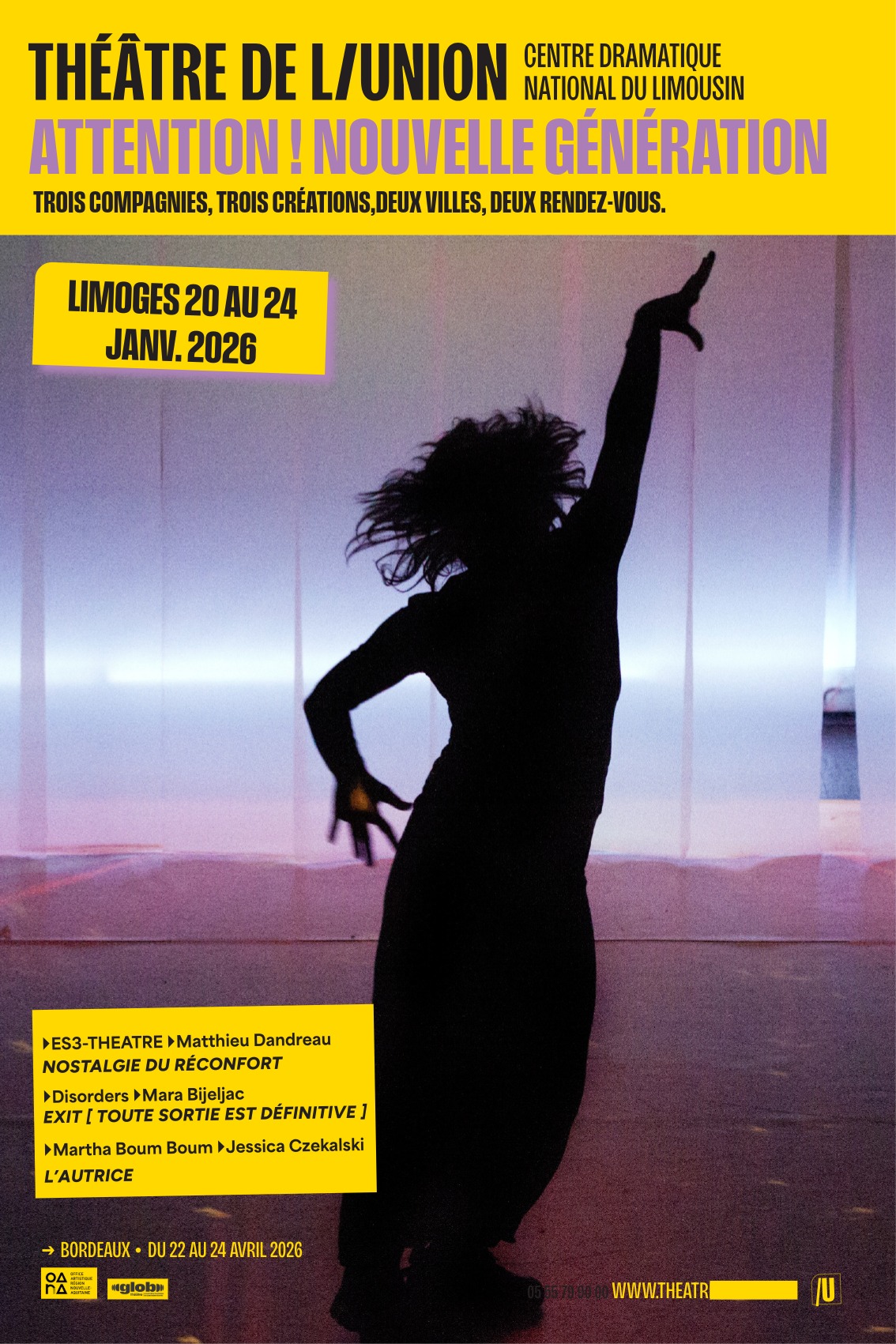« Je vis ainsi avec des fantômes »
Par Rodolphe Fouano
Les Trois Coups
Acteur populaire, metteur en scène, réalisateur, Francis Huster rayonne depuis quarante ans sur la scène française. Avec toujours la même fougue et mille projets qu’il nous confie.
Vous jouez actuellement Avanti de Samuel Taylor avec Ingrid Chauvin tout en assurant la promotion de la biographie de Stefan Zweig que vous venez de publier. C’est un peu le grand écart, non ?
Ce sont d’abord deux auteurs juifs. Samuel Albert Tanenbaum, sous le nom de Samuel Taylor, triomphe aux États-Unis dans les années 1950. Il est à l’origine de Sabrina tourné par Billy Wilder avec Audrey Hepburn, Humphrey Bogart et William Holden, qui a concouru pour 6 Oscars, d’Avanti avec Jack Lemmon et Juliet Mills… Il représente la comédie brillantissime à l’américaine, à la fois pièce de théâtre et film.
Mais il est aussi, par exemple, le scénariste de Vertigo d’Alfred Hitchcock avec James Stewart et Kim Novak.
D’un côté donc, l’auteur juif américain parfaitement intégré, de l’autre Zweig, qui d’ailleurs aurait pu travailler avec Taylor. Ils ont en commun un côté touche-à-tout.
Car Zweig, ce n’est pas seulement les nouvelles à la Maupassant, à la Pirandello ou à la Tchekhov ! Ce sont aussi les romans biographiques, les pièces adaptées de Ben Johnson, le soldat de 14-18 qui se retrouve dans les tranchées, curieusement à Auschwitz, ou encore le militant du pacifisme…
Je ne crois pas l’écart si grand : ce sont deux routes qui partent du même compas. Sauf que Taylor trace des lignes dans un embourgeoisement et un confort qui lui permettent d’avoir une longue vie couverte de récompenses, alors que Zweig, du côté de la plume, de la griffe et du sang, ne s’en sort pas et va jusqu’au suicide.
Vous parlez toujours de tout avec passion, voire avec excès. Est-ce là votre trait de caractère le plus évident ?
Je le tiens de Jean‑Louis Barrault, mon maître, qui était aussi dans cette espèce de folie, de passion, d’excès. Barrault, Jouvet, moi-même à mon niveau, nous sommes des voyageurs, plus proches de la marine ou de l’aviation que de l’infanterie comme l’était en revanche Dullin…
J’ai le sentiment de parler tous les jours avec eux. Je dois beaucoup aussi à Pierre Dux, qui lui-même admirait et Barrault et Jouvet. Il a été mon père artistique. C’est lui qui m’a mis le pied à l’étrier.
Tous les trois m’ont appris que le métier de comédien impose de regarder toujours en avant. Tel un alpiniste, le comédien se doit de trouver toujours un nouvel auteur à escalader.
Si l’on ne prend pas de risque, on n’est pas comédien, mais fonctionnaire artistique. Ce n’est pas péjoratif, cela veut dire que l’on travaille pour les autres. C’est le rôle du fonctionnaire. En revanche, le comédien doit travailler pour lui-même. Ce n’est pas une marionnette que dirige un metteur en scène. Il faut couper les fils ! Jouer une représentation, c’est ne plus être dirigé, voire être indirigeable !
En fait, c’est le public qui nous dirige, ce que ne veulent pas comprendre certains acteurs d’aujourd’hui qui pensent que toutes les représentations doivent se ressembler, et qui reproduisent ainsi la même chose chaque soir, comme des somnambules. C’est absurde !
Au contraire, chaque soir, un acteur doit se conduire comme devant une caméra où chaque prise est différente, où il faut toujours réinventer, se réinventer, sans sortir des rails. Ce qui compte, c’est d’avoir le courage de tout redécouvrir.
J’ai consacré ma vie à une poignée d’auteurs, même si j’ai joué environ 200 rôles. J’ai une admiration sans bornes pour Albert Camus, Stefan Zweig, Shakespeare, Corneille, Racine, Beaumarchais, Musset… Quant à Gustav Malher et à Arturo Toscanini, et quelques autres encore, ils sont pour moi des exemples permanents. Je vis ainsi avec des fantômes. C’est incroyable…
Vous ne vous arrêtez jamais. À quel besoin obéissez-vous ? Que cherchez-vous donc encore à prouver ?
Ce n’est pas un besoin : c’est une drogue ! Tous les jours, je dois prouver aux gens du métier d’abord, au public ensuite et à moi-même enfin que je ne trahis pas les valeurs que l’on m’a inculquées. C’est une religion de scène, en fait.
Quel regard portez-vous sur votre carrière ?
Le même regard que portait Barrault sur moi. Il disait : « Huster, mon frère. Francis, mon fils ». Je l’entends encore : « Le théâtre, c’est une huître. Il n’y a pas de perle à chaque fois, mais quand ça arrive, c’est incomparable… Quatre ou cinq compteront dans ta vie, et le public t’associera, même après ta mort, à celles-là ».
Il a ajouté : « Le cinéma, c’est tout à fait autre chose, c’est un diamant ». Il parlait bien sûr de sa propre carrière. Il a poursuivi : « Il y a deux ou trois diamants, pas plus. Si tu en as un, c’est déjà formidable, si tu en as trois, c’est merveilleux, tu es alors dans la légende du cinéma. Ça brille de mille facettes ad vitam æternam. Reste à sentir par instinct les moments où ces diamants se présentent à toi ».
Et il a conclu : « Sacrifie tout au théâtre. Quand tu auras fini le voyage, tel Ulysse, tu reviendras au cinéma ».
N’avez-vous jamais regretté d’avoir quitté la Comédie-Française ?
Non. J’y ai eu une place merveilleuse de jeune premier romantique pendant dix ans. J’y ai accompli un parcours qui constitue une étape magnifique de ma vie d’acteur.
Mais, vous savez, la Comédie-Française, c’est comme l’armée : quand on y est allé, on ne la quitte jamais vraiment. Je suis le 463e sociétaire de son histoire. Je le resterai à vie.
Comment jugez-vous l’évolution de cette institution ?
La troupe de la Comédie-Française est la meilleure du monde. Au lieu de s’empêtrer dans le classicisme, elle a su s’ouvrir. Je m’en réjouis.
La question est maintenant de parvenir à renouveler aussi son public. À mon sens, la Comédie-Française ne doit pas rester uniquement un théâtre parisien. Il est anachronique de devoir monter à Paris pour aller au Français ! Il faudrait trois Comédie-Française, trois sociétés, dans trois villes différentes.
Cela supposerait des moyens dont la Comédie-Française ne dispose pas.
Cela suppose une volonté de l’État. Quand on sait l’argent qui est consacré dans notre pays à la musique et à l’opéra, on a honte que la même somme ne soit pas consacrée au théâtre.
À plusieurs reprises, vous avez failli diriger un théâtre. Pourquoi cela n’a-t-il jamais abouti ? Vous apparaissez comme « l’impossible directeur »…
En 2000, j’ai refusé de prendre la direction du Théâtre du Rond-Point que le ministère de la Culture me proposait dans le cadre de la succession de Marcel Maréchal, parce que je ne pouvais pas y diriger une troupe de comédiens. Cela aurait constitué à mes yeux une trahison vis-à-vis de Jean‑Louis. J’ai préféré renoncer.
Au Théâtre Marigny, il n’y avait pas non plus les moyens de diriger une troupe. Le projet a donc également échoué.
On a souvent parlé de vous comme possible administrateur général de la Comédie-Française…
Oui, par trois fois. La première fois, ça a échoué car Jean‑Louis m’a demandé de rester avec lui au Rond-Point. La seconde fois, à la mort de Jean Le Poulain, en 1988, j’ai cédé ma place à Antoine Vitez…
Et j’ai estimé depuis que je devais mettre mon énergie au service du théâtre privé. Ce que je continue de faire.
Il y eut encore l’épisode des Tréteaux de France. Frédéric Mitterrand vous avait nommé, en 2010…
J’aimais beaucoup Jean Danet, qui a fait un travail extraordinaire à la tête des Tréteaux de France qu’il avait fondés, devenus centre dramatique national itinérant.
Mais là encore, j’ai appris tardivement que je ne pourrais pas prendre une troupe de comédiens permanents et qu’il faudrait procéder au coup par coup. La solution, c’était de s’associer. Ce que fait très bien depuis Robin Renucci en travaillant par exemple avec le T.N.P. de Christian Schiaretti. Mais ce n’est pas du tout l’orientation que j’entendais donner à ma troupe. J’ai donc renoncé.
Reste la Troupe de France, la compagnie que j’ai créée depuis. Je me bats sans un rond de subvention depuis deux ans pour qu’elle ne meure pas. Nous avons connu de beaux succès pendant les festivals d’été.
Je vais continuer de me battre pour que cette troupe de jeunes acteurs perdure et trouve un lieu.
Quelle suite imaginer ? La direction d’un théâtre privé parisien ?
Probablement. Je recherche des appuis financiers. Nous avons trouvé des partenaires, mais il reste à trouver le lieu. Ce choix est essentiel.
Si Jean Vilar s’était retrouvé au Théâtre de la Porte-Saint-Martin plutôt qu’à Chaillot, lieu pourtant tellement improbable, le T.N.P. n’aurait jamais marché. Le lieu induit le style artistique. Il ne faut pas se tromper. Voyez Récamier : là, Vilar a échoué…
Je me donne deux ans. Il faut un peu de patience. Puis je tournerai la page.
De quelle page parlez-vous ? Vous ne tournerez jamais la page !
Si, pour en écrire une autre ! Dans ma vie, j’ai réalisé tous mes rêves. Reste celui lié à la Troupe de France. Ce serait un cauchemar en cas d’échec.
Les jeunes actuellement ne savent plus qui sont Barrault, Jouvet et même Vilar. Ils n’ont pas vu leurs films ni lu leurs livres. Il y a urgence. Si les acteurs de ma génération ne transmettent pas, la chaîne sera brisée. On ne peut pas se le permettre.
L’enseignement a tenu une grande place dans votre carrière. Vous avez été longtemps une référence du cours Florent, aujourd’hui devenu une marque contrôlée par des capitaux étrangers. Pourquoi ne pas avoir enseigné au Conservatoire national supérieur d’art dramatique ?
Jacques Rosner, lorsqu’il le dirigeait, me l’avait suggéré. Puis deux ministères de la Culture successifs m’ont proposé d’en assumer la direction. Mais je n’en avais pas le temps. Il y a des saisons où j’ai trois jours de relâche seulement…
Je n’ai toutefois pas le sentiment d’avoir laissé tomber la pédagogie puisque je m’occupe de la Troupe de France. Et si l’on parvient à s’installer dans un théâtre, il est évident que j’y créerai aussi un cours. C’est indispensable.
Question bateau : quelle est la différence entre le théâtre et le cinéma (ou la télévison) ?
Le cinéma et la télévision sont un miroir dans lequel les acteurs se reflètent. Quel que soit le rôle qu’ils interprètent, ils sont toujours les mêmes devant la glace. Cela ne veut pas dire qu’il s’admire, l’acteur. Il se juge aussi. Mais il laisse simplement une image.
Alors que le théâtre, lui, réalise la traversée du miroir. Il t’invite à devenir ce que personne n’imagine que tu puisses être…
J’espère que je consacrerai cinquante ans de ma vie au théâtre. Puis que je consacrerai dix ans encore au cinéma. Ce serait l’idéal.
Nous confieriez-vous un rêve ?
Je voudrais absolument retrouver Claude Lelouch. Le rêve serait que Godard et Lelouch réalisent le film ensemble, ou que chacun tourne successivement la même séquence : un Ledard ou un Godouch ferait un film extraordinaire !
Je suis sans doute le seul, mais je suis persuadé que ces deux réalisateurs géniaux ne vont pas l’un sans l’autre. ¶
Propos recueillis par
Rodolphe Fouano
Avanti !, de Samuel Taylor
Les Bouffes parisiens • 4, rue Monsigny • 75002 Paris
Réservations : 01 42 96 92 42
Du 17 septembre 2015 au 3 janvier 2016
http://www.bouffesparisiens.com/spectacle.php?spec_num=35
Photo de Francis Huster : © Christine Renaudie