« Stimuler l’imaginaire pour réinventer nos modes de vie »
Par Léna Martinelli
Les Trois Coups
Joris Mathieu dirige le Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon depuis 2015. Avec la compagnie Haut et Court, il s’engage sur la voie d’un théâtre d’anticipation et poétique qui renoue avec une tradition politique du spectacle. L’édito qu’il a signé, concernant le coronavirus, est l’occasion de revenir sur sa démarche en tant qu’auteur, metteur en scène, lui qui interroge le monde, la place de l’individu, mais aussi celle de l’art au cœur de la cité.
Quel est l’effet immédiat de la pandémie sur les activités du Théâtre Nouvelle Génération ?
Ce virus ne nous a pas laissé d’autre choix que de mettre la machine à l’arrêt. Le Théâtre Nouvelle Génération a bien évidemment fermé ses portes dès le 16 mars et annulé tous ses événements, que ce soit dans ses murs ou en tournée, au moins jusqu’au début du mois de mai. Mais nous imaginons difficilement une reprise d’activité avant la rentrée de septembre.
Bien sûr, nous sommes tristes et inquiets, car des questions se posent sur l’avenir de notre secteur. Cela soulève des enjeux de solidarité avec les travailleurs les plus directement affectés par cette crise. Il est encore difficile de mesurer l’ensemble des conséquences économiques et prématuré d’imaginer les effets à moyen terme.
Et même si la crise révèle sans doute des problématiques plus anciennes et profondes, qu’il faudra à terme aborder, nous ne pouvons aujourd’hui prendre en considération que la partie immédiatement visible, à savoir les annulations des représentations et des répétitions. À l’heure actuelle, notre priorité est de sauvegarder les emplois de l’ensemble des salariés dont l’activité est liée à la nôtre et pour laquelle nous sommes subventionnés. C’est à ce prix, en préservant au maximum les équipes artistiques, que nous pourrons garantir au public dans le futur, la diversité d’une offre culturelle.
Vous avez dû suspendre les représentations de votre dernière création dans laquelle l’un des personnages est justement au pied du mur…
En marge ! met en scène le récit de la fin d’une époque, et le besoin de l’individu de se mettre à l’écart du monde pour lutter contre le désarroi. Les derniers mots de ce personnage, resté jusque-là reclus et mutique face à la furie du monde, expriment l’idée qu’il faut en finir avec la désolation. Et le seul moyen d’y parvenir est sans aucun doute de réinventer nos modes de vie.
Lors des trois seules représentations qui ont pu se dérouler au Théâtre Nouvelle Génération avant la fermeture, le spectacle résonnait évidement fortement avec l’actualité. Ce n’est ni un hasard, ni le fruit d’une écriture visionnaire, cela traduit simplement que ce que nous vivons actuellement est bien le produit d’une histoire.
Au-delà du phénomène pandémique, nous vivons probablement la fin d’une époque. Et si la période que nous traversons génère cette impression de « fin du monde », c’est en partie parce que la crise sanitaire se combine avec cette crise de sens qui était déjà latente. Cette situation est « extra-ordinaire » car elle nous interroge en profondeur sur le monde dans lequel nous vivons et celui dans lequel nous souhaiterons vivre à l’avenir.
L’anticipation, l’imaginaire des sciences, l’innovation scénique et technologique sont au cœur de votre recherche créative. Comment la situation actuelle fait-elle écho à votre démarche, au croisement de la littérature non dramatique, des nouvelles technologies et des sciences humaines ?
Depuis de nombreuses années, le théâtre que nous produisons joue – sans fascination – avec les outils technologiques qui sont inscrits dans notre quotidien. Les évolutions techniques ont depuis la nuit des temps été intégrées à notre art et ont contribué à la transformation des esthétiques scéniques. Mais ces outils sont d’abord des vecteurs puissants de transformation sociétale et ont un effet sur la relation qu’entretiennent les individus entre eux et avec leur environnement.
Selon la manière dont nous choisissons de nous en emparer dans l’organisation de la vie sociale, ils peuvent devenir les artisans de progrès ou au contraire les agents d’une mutation très agressive du productivisme libéral. Le problème ce ne sont pas les outils, mais leurs usages et les intentions des humains qui les emploient.
Depuis plusieurs années, notre démarche théâtrale consiste à produire des dramaturgies qui intègrent ces technologies, tout en confrontant les publics à des visions anticipées du monde qu’elles contribuent à faire émerger. Notre situation actuelle ne fait que révéler l’urgence absolue de prendre du temps pour observer les multiples enjeux de ce monde émergent.
Urgence absolue de prendre du temps
Cette crise ne devrait pas nous laisser d’autres choix que de questionner le scénario dans lequel nous vivons toutes et tous. Elle devrait nous imposer une réflexion profonde sur l’issue inéluctable que cette histoire nous propose. Nous avons un gros travail collectif d’écriture à produire, à l’échelle mondiale, pour prendre en considération d’autres options. Cette crise sanitaire ne doit pas être le masque qui dissimule le véritable visage de la maladie. Nous vivons avant tout une crise de sens et sociétale.
Ce scénario était-il prévisible ?
Nombreuses sont les voix qui exprimaient déjà, bien avant cet épisode pandémique, la proximité de l’effondrement. La collapsologie est même devenue ces derniers temps un véritable sujet médiatique et un moteur de création de nombreuses œuvres artistiques. Je crois que personne n’ignorait cette perspective objective. Elle n’était pas simplement théorique. Comme ce virus, finalement, elle était tout simplement dans l’air. Elle se propageait dans tous les esprits.

Sa perception était sensible, et pas seulement une vue de l’esprit. Mais nos imaginaires, contraints par notre incapacité à penser en dehors et autrement de notre modèle économique et social, freinés par l’obligation de vivre et travailler à un rythme effréné, engoncés dans cet aller-retour permanent entre consommer et être consommé, n’étaient pas en capacité d’accepter cette réalité tangible, ni d’y opposer des alternatives convaincantes. Comme souvent, lorsqu’on ne voit pas d’autres issues, on se réfugie dans le déni ou le divertissement de la pensée. Je pense que nous savions tous, seulement nous ne savions ni quand, ni où, ni comment.
L’expérience du miroir
Ce qui se joue actuellement dépasse la question de la gestion de la pandémie. Nous vivons collectivement l’expérience du miroir. Nous sommes obligés de nous voir tels que nous sommes et de regarder le monde tel que nous l’avons fait. Le temps n’est plus à se demander quelles sont nos responsabilités passées, qui avait tort ou raison, qui l’avait prédit ou non. Il s’agit essentiellement de ne plus nous mentir à nous-mêmes sur nos perspectives d’avenir et de ne pas laisser nos imaginaires se tétaniser sous l’effet de la peur. Nous savons bel et bien quel monde nous attend et si cette vision ne nous convient pas, il faut en imaginer quelques autres.
Cette épreuve en annonce-t-elle d’autres ?
Qui peut douter que d’autres épreuves nous attendent si au sortir de cette crise nous ne faisons que le récit d’un épisode viral dramatique ? Le virus n’est évidemment qu’un « événement déclencheur » de cette intrigue dans laquelle nous vivons. Si nous reprenons le fil de notre histoire, sans laisser cet événement avoir une incidence sur notre manière de penser, alors oui, tout est probablement écrit d’avance : la catastrophe écologique, la division sociale, l’individualisation, le consumérisme outrancier. La décroissance se réalisera alors probablement, sans aucune tentative d’orientation progressiste. Elle ne sera pas un nouveau mode de vie, elle s’exercera de manière sauvage et brutale. Elle prendra sa forme la plus terrible, celle d’une décroissance démographique sélective, après avoir creusé les inégalités sociales et fait exploser les conflits géopolitiques.
Pouvoir d’action
D’une manière générale, les épreuves font partie du scénario de la vie. Mais en ce qui me concerne, j’essaie de croire que nous avons malgré tout un pouvoir d’action et que nous n’avons pas à vivre dans la résignation fataliste face à ce qui semble inexorable. Nous avons, a minima, à trouver les manières de nous comporter dignement dans ce contexte. A maxima, à nous mettre au travail pour inventer des bifurcations sur cette route qui, nous le savons, mène à une impasse. Quoi qu’il en soit, le statu quo ou la modernisation de ce que nous avons déjà expérimenté comme modèle économique et social, sont des hypothèses qui me semblent fatales. La vaccination, cette fois-là, ne s’opérera pas par l’injection de doses plus fortes de la maladie.
En quoi le coronavirus révèle-t-il les failles de notre système ?
Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais au début du XXe siècle, le mathématicien et économiste Georgescu-Roegen a publié des travaux dans lesquels il faisait le parallèle entre phénomènes thermodynamiques et économiques. Il évoquait l’irréversibilité de ces phénomènes et donc des dégâts causés par leurs processus.
À la lecture de ces théories, je me dis que nous vivons probablement dans une société qui a développé, sans le savoir, une conscience aiguë de ce schéma. Les failles nous semblent inhérentes aux choix irréversibles que nous avons faits dans le passé. Nous sommes engagés sur une voie qu’il nous semble impossible de quitter, parce que nous avons tout construit et modélisé pour la suivre jusqu’au bout, quel que soit ce bout.
Accélération du prototypage
d’un nouveau monde
Selon moi, la période de confinement planétaire nous confronte surtout à une phase d’accélération du prototypage d’un « nouveau monde » que nous étions déjà en train de construire, mais dont les intentions et les enjeux sont concrètement plus lisibles parce que nous en éprouvons tous physiquement, émotionnellement les effets. Dans cette vision du « nouveau monde », qui n’est à mon sens qu’une mise à jour de l’ancien, le digital joue un rôle fondamental. Certains nomment d’ailleurs cela l’ère du capitalisme digital et nous interpellent sur son avènement probable à l’issue de ce moment de sidération que nous traversons.
Pour moi, cela confirme essentiellement que ce modèle idéologique dans lequel nous vivons a conscience de l’impérieuse nécessité de migrer dans un autre corps, de prendre une autre forme, pour assurer sa survie et se déployer toujours plus. Je ne crois pas que cela nécessite de porter un jugement moral sur ce qui est bien ou mal, mais par contre, d’un point de vue éthique, il appartient à chacun de nous de définir si cela lui convient ou ne lui convient pas. Et nous sommes désormais en capacité de le faire parce que nous sommes en train de l’éprouver et de l’expérimenter concrètement et ostensiblement. Je dirais que c’est un peu comme si nous étions en train de passer un test généralisé sur notre capacité d’adaptation à ce « nouveau monde ». Reste à s’accorder sur l’interprétation du sens de ce test et en quoi cela consiste d’échouer ou de réussir son passage.
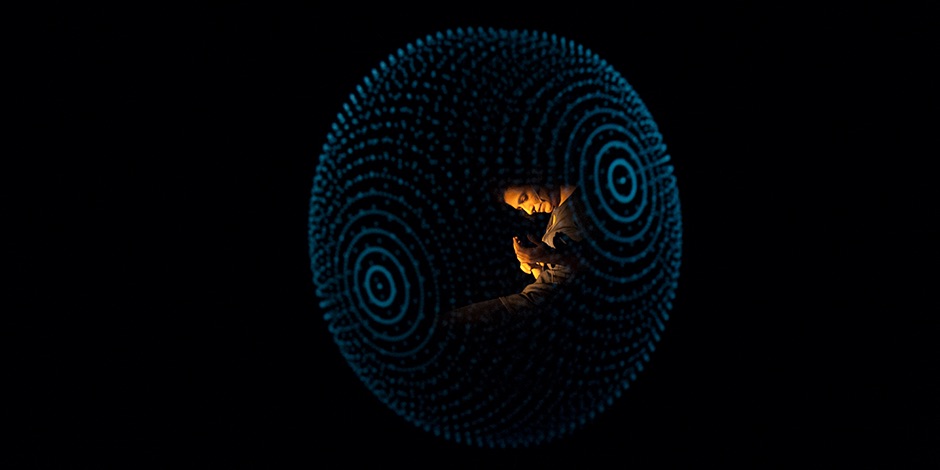
Comment faire face à la réalité, sans catastrophisme ?
Il me semble qu’il y a bien matière à être catastrophé. Je dirais même qu’il est indispensable que nous le soyons. Mais peut-être serait-il préférable de nommer lucidité ce que l’on a pris l’habitude d’appeler trop rapidement pessimisme. Bien sûr, se morfondre dans la noirceur du constat ou des prédictions n’est pas productif. Mais ce n’est pas en faisant simplement preuve d’optimisme que nous nous en sortirons. Ni non plus en nous rassurant grâce à ce qui continue à fonctionner dans ce contexte. En ce sens, je ne trouve, par exemple, pas vraiment rassurant d’observer notre précipitation collective, la mienne y compris, à vouloir assurer immédiatement la continuité de l’activité vaille que vaille alors, qu’au contraire, nous devrions prendre du recul sur nos pratiques et nos routines.
Finalement, tout dépendra certainement de notre capacité à gérer, émotionnellement, la dimension anxiogène de cette situation inédite et stupéfiante. Si en face de ce tableau inquiétant, nous cédons à la peur, nous ne serons plus vraiment maîtres de nos décisions et de nos actes. La peur est historiquement un outil de domination qui ouvre la porte à des gouvernances politiques autoritaires. C’est à mon sens principalement cela que nous avons à redouter dans les temps prochains.
Ne pas céder à la peur
Dans mon édito, je parle d’une opportunité à saisir pour prendre du recul et chercher à redéfinir profondément notre modèle. Je ne me fais pas pour autant d’illusion. Cette opportunité ne nous sera pas offerte, elle est à provoquer. Et pour être en capacité de le faire, il nous faudra en premier lieu trouver l’énergie de ne pas céder à l’état d’urgence qui ne manquera pas de pousser son cri d’alarme. Nous ne savons pas encore combien de temps cette situation va durer, mais il est tout de même prévisible que beaucoup de nos concitoyens en sortiront émotionnellement, psychologiquement, mais aussi économiquement extrêmement fragilisés.
Ce n’est pas jouer les Cassandre que de dire qu’il y aura une tentation forte de fuite en avant, de mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu, redresser l’économie, sauver les emplois et de le faire « le doigt sur la couture » dans un effort national motivé par la menace du chaos social. D’abord sauver sa peau, puis tirer au maximum profit de la situation, est malheureusement un réflexe terriblement humain. Trop humain.
C’est pourquoi établir une définition saine, de la notion de « solidarité » que l’on entend employée ici et là, sera tout à fait primordial. Cette solidarité ne peut pas s’entendre uniquement comme un enjeu d’être « tous unis face à la crise », sans contestation possible de la direction à prendre pour s’en sortir, sous prétexte de grand péril. Cette idée de solidarité devrait pouvoir retrouver son sens premier, celui qui impose aux mieux lotis de repartager et redistribuer les richesses avec les plus précaires. Celui qui permettra à l’État et aux collectivités de redécouvrir les vertus du service public et de la solidarité interprofessionnelle.
Une définition saine de la notion de solidarité
Cela suppose avant tout, qu’individuellement nous repensions notre rapport à l’autre et au monde ; que chacun d’entre nous réinterroge l’équilibre entre la production du bien commun et la recherche de profit personnel. Je ne dis pas que c’est le scénario le plus probable, mais c’est une option à laquelle j’ai envie d’accorder du crédit. Ne peut se réaliser que ce que nous avons préalablement rêvé ou visualisé. C’est d’ailleurs un rôle fondamental des artistes, des auteurs, des penseurs dans la société, de stimuler l’imaginaire individuel et collectif.
Le futur n’est donc pas inéluctable. D’autres raisons d’espérer ?
Ce que je vais dire n’est pas très gai, mais s’il y a une chose qui est inéluctable, c’est la mort. Et il est clair que nous avons un gros problème civilisationnel qui nous empêche d’accepter pleinement cette idée. Pourtant la vie des individus a une fin. Et c’est également vrai pour les organisations sociétales. La seule chose qui soit écrite d’avance dans notre futur, c’est celle-là.
La fin est inéluctable mais le chemin que nous prenons, lui, ne l’est pas. J’ai parfois le sentiment que notre obsession pour repousser la fin d’une époque, la fin d’une histoire, pour en étirer le récit, quitte à le vider de sa substance, est un projet aussi fou et dangereux que celui qui consiste à fantasmer l’immortalité. ¶
Propos recueillis par
Léna Martinelli
À découvrir sur Les Trois Coups :
☛ Portrait de Joris Mathieu, 21 juin 2014, par Michel Dieuaide








