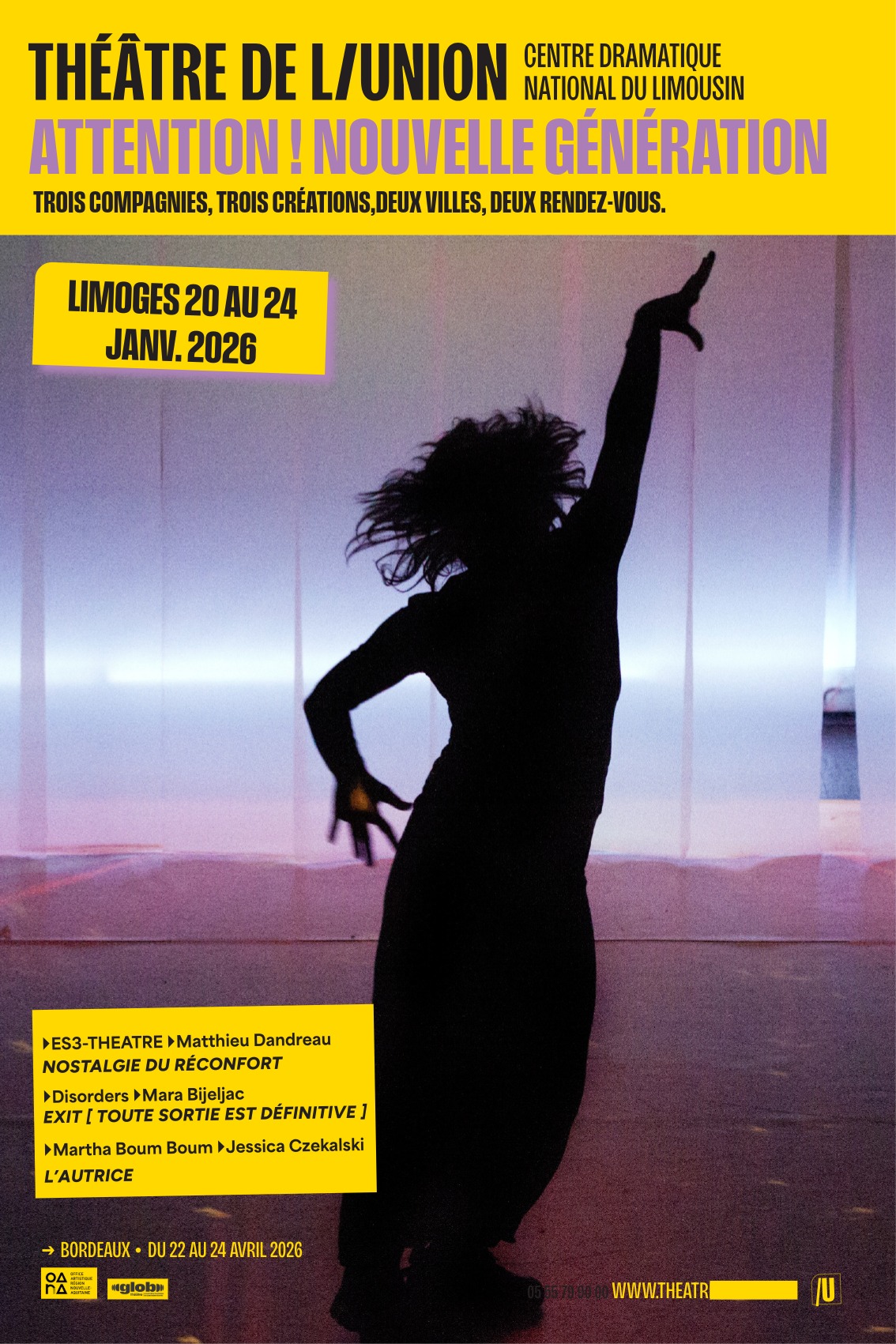Un incendie qui « fait long feu »…
Par Hélène Merlin
Les Trois Coups
La version de Stanislas Nordey n’est peut-être pas le feu de brousse tant attendu : elle passe trop lentement en n’offrant seulement que quelques étincelles et quelques frissons. Bref, pas de quoi sortir les extincteurs !
La compagnie Nordey est constituée en 1987. Stanislas Nordey a successivement mis en scène Marivaux, Pasolini, Calderon, Georges Feydeau… Il a été artiste associé au Théâtre Nanterre-Amandiers, puis a dirigé le Théâtre Gérard‑Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis, dont il quitte la direction suite à une grave crise financière. Il est aujourd’hui le directeur pédagogique de l’École supérieure du Théâtre national de Bretagne.
La pièce nous emmène dans une contrée pas si lointaine que cela. Dans un pays en guerre, où la violence et l’horreur sont monnaies courantes. Une mère laisse en testament à ses deux enfants des indices pour remonter à l’origine de leur naissance, qu’elle leur avait cachée. Quête des origines d’un peuple, d’une famille, et de chacun des individus, qui nous amène dans un pays plongé dans l’horreur : le Liban, où l’auteur Wajdi Mouawad est né en 1968.
L’écriture est bouleversante, pourtant, dans cette mise en scène, on ne le pressent qu’à peine. La diction des comédiens est telle que l’on n’en saisit ni l’essence ni le sens. Scandant chaque syllabe, ils martèlent le texte de leur phrasé artificiel et sans relief, le rendant presque inaudible. Perdant alors de sa valeur et de sa puissance, il ne nous parvient plus que par bribes. À force de vouloir absolument faire entendre le texte à vif, dans sa violence et dans ses déchirures, le metteur en scène n’a finalement réussi qu’à l’écorcher en le rendant presque ennuyeux. On ne peut pas mettre toute la misère du monde dans chaque mot ! Le silence est d’ailleurs souvent plus bouleversant. Un instant marquant : lorsque la fille enfile la veste de prisonnier, bleue, de sa défunte mère. On savoure enfin le dessin précis des gestes, une tension à son comble, sans parasitage. « Au-delà du silence, il y a le bonheur d’être ensemble. » Oui…
Mais ce n’est qu’une accalmie de très courte durée… Car la parole assourdissante reprend son flux, et la gestuelle des comédiens redevient excessive, pesante, fatigante. D’où vient cette idée qu’un corps, qu’un être, qu’une âme s’exprime avec ses bras ?! Louis Jouvet avait pourtant ouvert la voie de la réflexion à ce sujet, en suggérant à l’un de ses élèves qui ne savait que faire de ces mains qu’il les laissent au bout de ses bras ! Évidemment, Nordey n’a pas le talent de Jouvet. C’est un peu désolant de voir des comédiens qui n’incarnent pas les personnages avec leur corps, qui ne sont pas enracinés dans leur rôle, qui ont des voix mal placées… et qui fond du vent en gesticulant. La seule comédienne qui pourrait vraiment se targuer de son statut est Véronique Nordey. Une présence infaillible, et des frissons, enfin ! Dès son entrée en scène, elle impose l’écoute attentive d’un public épuisé par deux heures de spectacle. Son talent ferait même de l’ombre à l’auteur, car dans sa bouche on peut voir pointer quelques redondances inutiles. Son écriture est en effet si fine, si puissante qu’en peu de mots Mouawad sait nous transporter au-delà de ce qu’il imagine.
La mise en scène n’est ni bête ni intelligente : elle est sans grand intérêt, sans grande trouvaille. Pas de prise de risques. Idem pour la scénographie. Un espace vide, inexploité, aux murs blancs salis de noir, qui laisse la possibilité de voyager dans des espaces-temps différents tels qu’une prison, un tribunal, un bureau notarial, un orphelinat, un cimetière… Mais les comédiens ne nous emmenant pas bien loin, le décor peine à nous glacer le sang à lui tout seul. Il n’est ni beau ni laid, il est tout à fait quelconque, sans grandeur… Et la présence des extincteurs en bord de scène est tellement cliché… Le côté manichéen des costumes semble un peu puéril… Car rien n’est simple ni tranché dans un récit où l’amour et la haine sont exaltés, où le passé et le présent se mélangent, où les morts et les vivants communiquent. On sait pourtant qu’il existe toute une gamme de gris, que rien n’est tout blanc ou tout noir… On aurait apprécié un peu plus de nuances…
Néanmoins, le travail effectué par Stéphanie Daniel sur la lumière est très réussi. Elle offre une perspective, une profondeur, une architecture digne du texte de Wajdi Mouawad. L’ombre inquiète et la lumière effraie. La chaleur s’échappe et le froid protège, parfois. L’enjeu était pourtant bien là, dans les contradictions. Seule Stéphanie Daniel semble avoir réussi son pari. Car, les effets sonores, ici, laissent aussi à désirer : les « gongs » frappés tout au long de la représentation, ou les coups de feu tirés par le snipper, n’ont pour conséquence que de nous faire sursauter : pas d’effroi, mais de désagrément, voire de malaise quand le tireur s’en sert pour teinter d’un peu de barbarie sa chansonnette. Stanislas Nordey a peut-être voulu récréer la stupéfaction et la violence sonore d’une guerre, mais nous infliger des décibels par surprise ne suffit pas.
En somme, Stanislas Nordey a fait un pari de taille, l’essai est honorable, la « transformation » décevante. Le spectacle « que vous nous avez offert fut ennuyeux », comme dirait le sniper au sujet de son procès. Malheureusement. À ce niveau-là et dans ce théâtre-là, on aurait aimé être un peu plus bousculé… Dans des petites salles parisiennes, avec des petites compagnies, les frissons sont souvent plus au rendez-vous que lors de cette ballade à la Colline. ¶
Hélène Merlin
Incendies, de Wajdi Mouawad
Mise en scène : Stanislas Nordey
Avec : Claire Ingrid Cottanceau, Raoul Fernandez, Damien Gabriac, Charline Grand, Frédéric Leidgens, Julie Moreau, Véronique Nordey, Lamya Regragui, Laurent Sauvage
Photo : © Brigitte Enguérand
Théâtre national de la Colline • 15, rue Malte-Brun • 75020 Paris
Du 8 octobre au 2 novembre 2008
Réservations : 01 44 62 52 52
De 13 € à 27 €