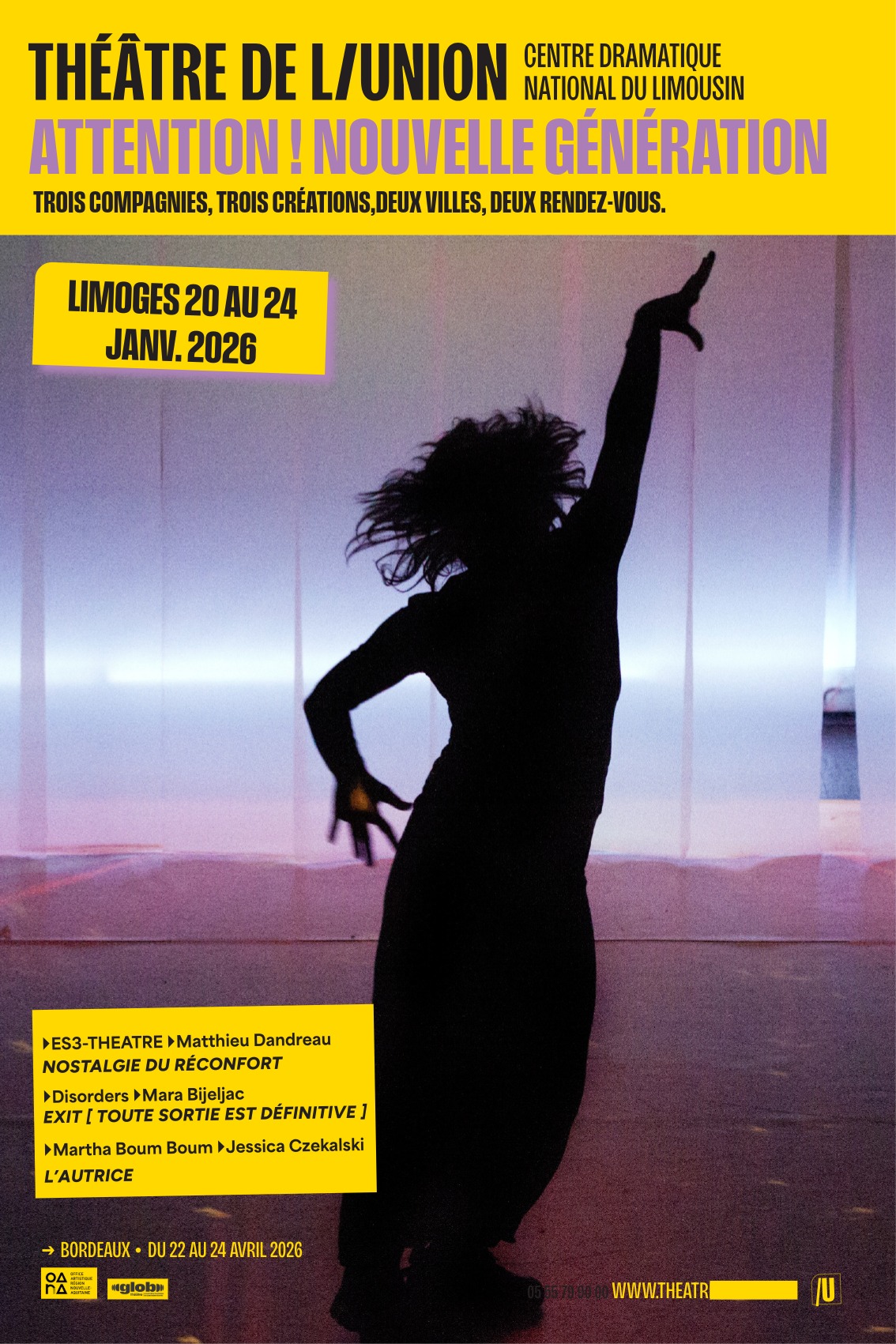Déroutant Spregelburd
Par Fatima Miloudi
Les Trois Coups
La pièce « la Paranoïa », de Rafael Spregelburd, créée au Théâtre de Chaillot en octobre 2009, a fait escale au Théâtre de Nîmes en cette fin novembre. L’imagination prolifique de l’auteur argentin est soutenue par un discours sur l’art de la narration. Sous des allures chaotiques se dessine une pensée critique qui traque les évidences de la fiction et de ses codes. Pièce difficile d’approche, sans aucun doute.
Le sujet n’est pas, de prime abord, très engageant. Ce qui déconcerte, plus que le sujet même, c’est le fait qu’il soit énoncé. Il sent son message didactique, et le spectateur sait d’entrée qu’il est venu pour penser. Soit. Le colonel Brindisi résume la situation. « Les intelligences », créatures extraterrestres, ont jusqu’à présent préservé les humains parce qu’ils leur fournissaient une denrée nécessaire : la fiction. Mais, voraces, elles ont tout englouti. Désormais, toutes les trames, tous les codes leur sont connus. C’est pourquoi, des invités sont là, en Uruguay, à l’hôtel Piriapolis, afin de sauver in extremis l’humanité. Voici Clauss, l’astronaute ; Hagen, le « mathématicien spéculatif » ; Julia Gay Morrison, l’écrivain de renom, promue au rang de chef de mission et Brenda, le désopilant et transsexuel robot G4 à la mémoire corrompue. Ils ont vingt‑quatre heures pour créer une fiction sans précédent.
Le spectateur est jeté au cœur de l’acte créatif. Il assiste à un brainstorming qui fait surgir l’ébauche d’une histoire. Beaucoup de mouvements, beaucoup d’enthousiasme, mais qui semblent accoucher d’une souris. Sur fond vénézuelien, dans un pays qui n’a plus pour ressource que la beauté féminine, Brenda, comme d’autres jeunes filles, est la victime d’une sordide entreprise de chirurgie esthétique. À mi-chemin de la perfection – une horreur ! –, elle se révolte, hante les couloirs de la clinique et tue.
L’intérêt s’émousse
Si l’on s’attache à la matière ou au rocambolesque des situations, il faut dire que durant les deux heures et quart de spectacle, l’intérêt s’émousse. Derrière le trop-plein, l’auteur se plaît en fait à perdre le spectateur. Comment ne pas tomber dans les ornières du connu ? Tel est le défi. Quelques règles sont édictées pour éviter le déjà‑vu : il ne faut pas de style ni de hiérarchie ; pas d’évènements non plus ; il faut affirmer et nier en même temps ; il ne faut plus d’histoire , etc. Par conséquent, il s’agit d’inventer un récit nouveau, qui ressemble, peut-être, à la scène de café où l’histoire s’écarte tellement qu’elle devient pure continuation du récit, à l’image de la monnaie qui circule sans que l’on sache qui a conservé le dernier bolivar – ou le sens – manquant. Le propos est dense, et la seule présence au théâtre est loin d’être suffisante pour appréhender clairement la pensée du dramaturge. Un recours à l’œuvre écrite paraît nécessaire si l’on veut en comprendre tout le propos.
Cependant, la mise à plat de la narration se donne à voir dans le rapport entre le jeu théâtral et la projection vidéo. C’est sans conteste l’une des grandes réussites de la scénographie. Côté cour et côté jardin, les personnages sont suffisamment éloignés du public pour n’être perçus que dans leur gestuelle. Au centre, une image de grande dimension double la scène vue, tout en la modifiant. Ainsi, les personnages sont‑ils de profil et « en couleurs » dans leur réalité de chair, tandis qu’ils sont de face et en noir et blanc sur l’écran, comme sur la bobine d’un bon vieux polar. Les inventions sont nombreuses et étoffent là encore le sens. On en serait presque à toucher la « substantifique moelle », mais le rythme très vif ne laisse pas de répit, sinon la toute fin qui…
Quelles que soient les longueurs de la pièce, les acteurs étaient tous de qualité. Certains ont plus emporté que d’autres l’adhésion du public, tels Pierre Maillet, dans le rôle de Béatrice, ou Clément Sibony, dans celui de John Jairo Lazaro, surtout parce qu’ils prêtaient plus facilement au rire. ¶
Fatima Miloudi
la Paranoïa, de Rafael Spregelburd
Traduction de Marcial Di Fonzo Bo et Guillermo Pisani, chez L’Arche éditeur
Mise en scène : Marcial Di Fonzo Bo et Élise Vigier
Avec : Frédérique Loliée, Élise Vigier, Pierre Maillet, Julien Villa, Marcial Di Fonzo Bo, Rodolfo de Souza, Clément Sibony
Décor et lumières : Yves Bernard
Images : Bruno Geslin, avec la collaboration de Romain Tanguy
Costumes : Anne Schotte
Son : Manu Léonard
Perruque et maquillage : Cécile Kretschmar
Dramaturgie : Guillermo Pisani
Photo : © X. / D.R.
Théâtre de Nîmes • 1, place de la Calade • B.P. 1463 • 30000 Nîmes cedex 1
Réservations : 04 66 36 65 00
Du 26 au 27 novembre 2009 à 20 heures
Durée : 2 h 15
22 € | 20 € | 13 € | 9 €