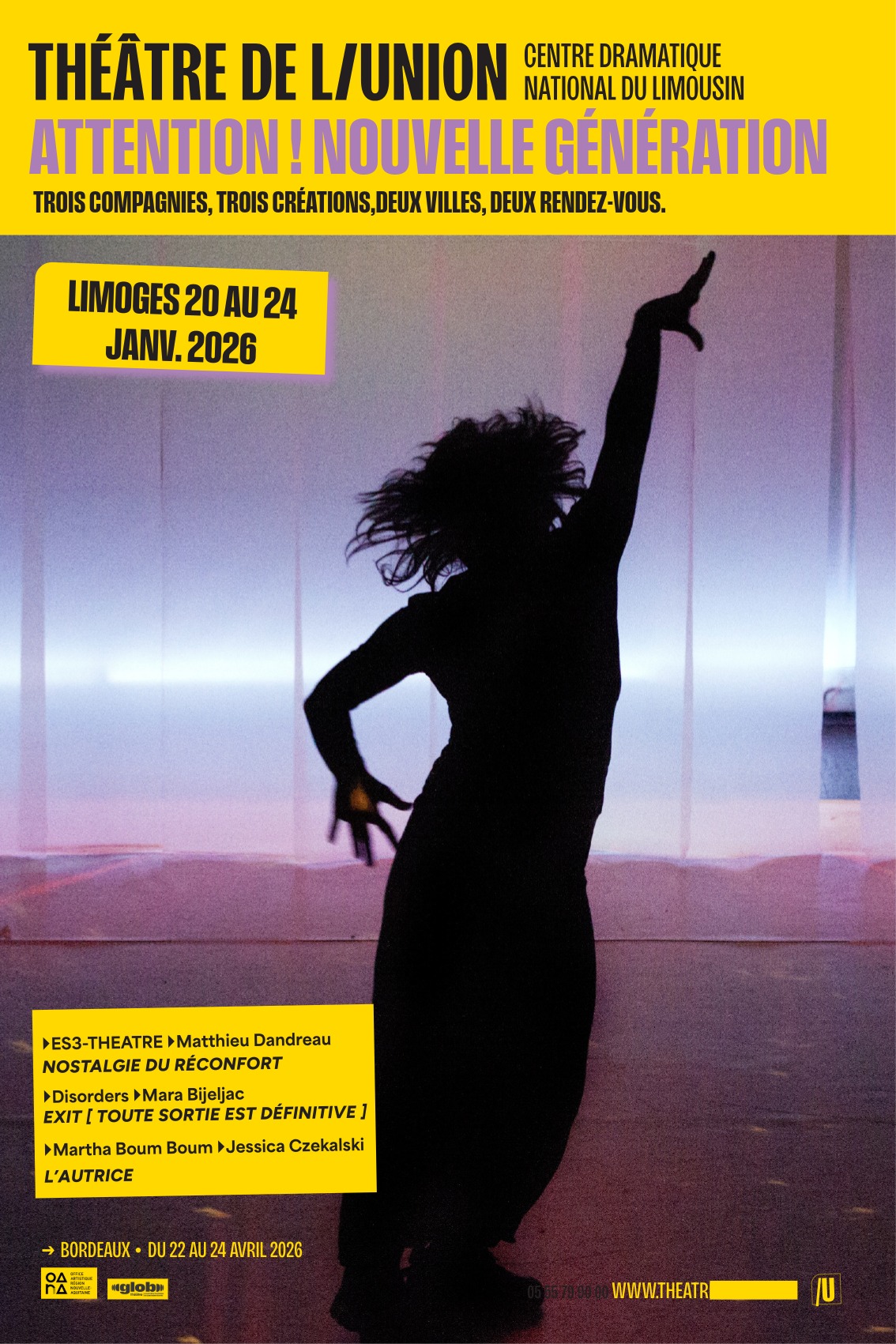Un ballet sur le seuil des adieux
Par Lise Facchin
Les Trois Coups
« Alors que j’attendais », d’Omar Abusaada, se joue au gymnase Paul‑Giéra. Un spectacle d’une intelligence et d’une simplicité étonnantes pour un sujet qui pouvait facilement verser dans le fossé.
Damas 2015 : alors que le soulèvement syrien a consommé son revirement dramatique, Taim est retrouvé couvert de sang dans sa voiture. Depuis la chambre d’hôpital où son coma se prolonge, ses proches défilent, tissant et dé‑tissant son passé politique et familial.
La situation syrienne est une blessure ouverte au flanc de la Méditerranée, ses conséquences sont incommensurables, ses échos, permanents. Un spectacle charriant cette matière vivante, immédiate et brutale, semblait voué à la pesanteur, à une gravité silencieuse recouvrant tout de son obscurité. Chassons donc le doute sur ce point : à aucun moment, il n’est question ici de mettre la violence en spectacle. La douleur, le drame ou les cris n’ont pas le premier rôle. Le public – et c’est fort appréciable –n’est pas venu au théâtre pour en repartir déchiré, quand bien même la barbarie et son impunité sont bel et bien présentes. Ainsi, point d’éclaboussure, le registre est plutôt celui d’une douce intimité, d’une humilité aux affects caressés par la magie de la langue arabe. Car, ici, c’est évident, elle fait tout ou presque. Merci à la direction du Festival d’Avignon d’accentuer les efforts depuis trois ans pour offrir à son public toujours plus d’œuvres en langue originale. L’arabe moyen-oriental porte en lui tant de douceur, de finesse et de lumière qu’on imagine mal une traduction faire émerger ce halo délicat qui nimbe le spectacle.
Une fresque des tensions damascènes sans grandiloquence ni réduction
Tout – comédiens, texte, scénographie – converge d’un même pas, d’une même énergie, vers la constitution d’une fresque des tensions damascènes sans grandiloquence ni réduction. La pièce de Mohammad al‑Attar est d’une grande contemporanéité, voire d’un réalisme assez déroutant. Ses personnages, tout en incarnant chacun l’une des frictions dialectiques de ce conflit, ne versent jamais pour autant dans l’archétype. Et sa langue est assez belle pour que parfois, sans connaître beaucoup d’arabe et prise par sa mélodie, je lâche les sous-titres préférant jouir du son plutôt que du sens.
L’intelligence du texte, filant la métaphore du coma de Taim et de la paralysie politique syrienne, est épaulée par un dispositif dramaturgique efficace et structurant. Entre les deux piliers, texte et dramaturgie, s’instaure un dialogue fondu entre Moyen-Orient et Occident. Croire qu’il est possible de conserver une telle dialectique, construite sur des entités clairement définies, dans un monde globalisé et ouvert à tous les vents alimente sans doute une des grandes erreurs politiques de notre époque. Ces espaces culturels sont extraordinairement poreux, ils l’ont toujours été – merci pour Aristote ! –, et cette porosité est un creuset pour tous.
En avant-scène, un plateau nu accueille le réel (la chambre d’hôpital, l’appartement de la sœur…), plateau bordé de penderies à costumes et des chaises servant aux comédiens. En arrière-plan, une structure en élévation permet deux espaces, dévolus à Taim et à son ami d’infortune (par ailleurs chef d’orchestre de la partition audiovisuelle du spectacle). De ces hauteurs, la génération syrienne qui s’est dressée contre le régime continue de regarder l’écartèlement de son pays avec une posture toute théâtrale. Où l’on voit que lorsque le théâtre contemple le monde il jongle d’un même geste avec des reflets de lui-même… Mais si le réel n’a pas droit de cité au royaume de Taim, lui se paie des promenades sur le plateau, mi-grave, mi-djinn farceur.
Rester ou s’exiler, le déracinement ou la guerre
Taim a voulu documenter le soulèvement, filmant des heures et des heures avec son téléphone portable, des premières révoltes aux cortèges funéraires des soldats de Bachar‑al‑Assad… Ces vidéos qui ont inondé les réseaux sociaux dès 2011, nous en savons tous quelque chose. Nous les retrouvons ici, projetés sur scène toujours à bon escient et au moment juste. L’impuissance et la passivité politiques en écho dans le corps du jeune homme provoquent l’émergence de ce qui s’avère l’interrogation centrale de la pièce : rester – c’est à dire continuer –, ou s’exiler. En fin de compte, il n’est question que de cela. Le déracinement ou la guerre, la difficulté de trouver la vie entre deux morts. Chacun des personnages conçoit une forme de réponse à cette question, pas de réponse univoque dans ce spectacle ; pas de leçon.
Les derniers mots de la pièce sont d’ailleurs des adieux, les adieux de Taim à la Syrie, à Damas dont la splendeur l’a marqué pour jamais. Taim, qui s’était résolu à émigrer avant d’avoir été victime d’un tabassage en règle par les soldats du gouvernement ; Taim, qui après avoir arpenté Damas en dernier hommage, se laisse aller à la contemplation de sa ville du haut de sa terrasse, remettant à plus tard et son travail et l’exil, dans une sorte de torpeur hypnotique et amoureuse.
Deux bémols, pourtant. Si Mohamad al‑Refai, délicat et lumineux interprète de Taim, au parlé moelleux, lent et modulé, et Amal Omran, mère grave, sèche et réfugiée dans le conservatisme, éclairent à eux seuls la scène comme une nuée de lucioles, les seconds rôles semblent moins travaillés, et un peu outrés. Même si leur sincérité reste indéniable. Un parterre unanime a d’ailleurs signifié son admiration en accueillant les interprètes sous une pluie battante d’applaudissements.
Par ailleurs, la mise en scène gagnerait sans doute à se dépouiller de quelques artifices par trop naturalistes. Mais tout cela n’est rien. Le propos est trop important. ¶
Lise Facchin
Alors que j’attendais, de Mohammad al‑Attar
Mise en scène : Omar Abusaada
Avec : Mohamad al‑Refai, Mohammed Alarashi, Fatina Laila, Nanda Mohammad, Amal Omran, Mouiad Roumieh
Dramaturgie : Mohammad al‑Attar
Scénographie : Bissane al‑Charif
Lumière : Hasan Albakhi
Vidéo : Reem al‑Ghazzi
Musique : Samer Saem Eldahr (Hello Psychaleppo)
Spectacle en arabe surtitré en français
Gymnase Paul‑Giéra • 11, rue Paul‑Achard • 84000 Avignon
Réservation : 04 90 14 14 14
Site : http://www.festival-avignon.com/fr
Du 8 au 14 juillet 2016 à 18 h 30
Durée : 1 h 40
Tarifs : 28 € │ 22 € │ 14 € │ 10 €
Tournée :
- Du 18 au 20 août 2016 au Theater Spektakel (Zürich)
- Les 26 et 27 août 2016 au Festival Noorderzon de Groningen (Pays‑Bas)
- Les 31 août et 1er septembre 2016 au Theaterfestival Basel (Suisse)
- Les 4 et 5 septembre 2016 à La Bâtie festival de Genève (Suisse)
- Du 8 au 10 septembre 2016 au Schlachthaus Theater, Bern (Suisse)
- Les 29 et 30 septembre 2016 au Vooruit de Gent (Belgique)
- Du 12 au 15 octobre 2016 au Tarmac, Festival d’automne à Paris
- Les 26 et 27 octobre 2016 au Onassis Cultural Center d’Athènes
- Les 18 et 19 novembre 2016 à Bancs publics-festival Les Rencontres à l’échelle (Marseille)
- Du 24 au 26 novembre 2016 au Théâtre du Nord-C.D.N. Lille-Tourcoing Nord – Pas‑de‑Calais