Un présent fulgurant qui dévoile les parts d’ombre du réel
Par Lorène de Bonnay
Les Trois Coups
Au Théâtre de l’Odéon, la rentrée théâtrale est marquée par la reprise de deux pièces saillantes de Joël Pommerat : « Au monde » d’abord, « les Marchands » ensuite. La première, créée en 2004, à la lisière de la fable symbolique et du drame intime, convoque un réel étrange dans une forme déjà éblouissante – révélant une dramaturgie que Pommerat ne cessera d’approfondir et d’intensifier par la suite.
« Je rêve de pouvoir garder en vie tous mes spectacles ; mon idéal serait de pouvoir jouer nos créations sur des durées de vingt, trente ans, voire plus. Qu’on voie vieillir les comédiens avec les spectacles », confiait l’auteur et metteur en scène en avril dernier. L’utopie se réalise partiellement grâce à cette reprise d’Au monde, dans la même mise en scène et avec les mêmes comédiens (à trois exceptions près) qu’il y a neuf ans. Le temps de l’écriture, dont la dernière étape est la rencontre avec le public, est ainsi prolongé, répété et renouvelé, mûri.
On retrouve donc les personnages qui composent le huis clos familial : un patriarche chef d’entreprise sur le déclin, ses deux fils, ses trois filles, son beau-fils et une domestique étrangère. La scénographie, abstraite, évoque différentes pièces d’une maison sombre qui, de nuit comme de jour, est traversée par le monde extérieur : en effet, des colonnes lumineuses verticales suggèrent les fenêtres et laissent filtrer dans la pénombre des lignes blanches géométriques ; des bruits de voitures, de pas, d’oiseaux, de radio, de télévision, envahissent l’espace fermé. Certes, la fable suit une chronologie : la famille attend le retour du fils prodigue Ori qui vient de quitter l’armée. Ce dernier veut faire quelque chose de profond de sa vie, mais finit par accepter de reprendre les rênes de l’empire industriel paternel alors qu’il est quasiment aveugle. Les membres de la famille dévoilent tour à tour leur intimité, leurs aspirations et leurs contradictions face au réel ; la domestique remet chacun en question malgré elle…
Pourtant, l’éclairage et la musique brisent la continuité. Des fondus au noir (qui ressemblent à des clignements de paupière) ainsi que divers sons et musiques assurent les transitions entre les scènes : ils introduisent une inquiétante étrangeté, un onirisme, qui font douter de la réalité représentée. De même, les musiques en fond sonore, tristes ou enlevées, produisent des ruptures de ton. Il faut enfin évoquer le positionnement souvent stylisé des corps des comédiens dans l’espace, leurs déplacements presque chorégraphiés sur des lignes invisibles, leurs gestes, leurs voix, leurs silences criants. Tous ces éléments – mots, corps, lumières et sons – forment donc le ciment de l’écriture scénique si singulière de Pommerat, laquelle atteint déjà dans Au monde un certain degré de perfection.
Une œuvre palimpseste
La pièce s’inspire des Trois Sœurs de Tchekhov : le metteur en scène, dont le rôle consiste, d’après Pommerat, à réécrire le sens d’autres pièces sans en modifier les mots, a ici « gratté le manuscrit » de l’auteur russe et réécrit sur ce parchemin. Le palimpseste Au monde fait en effet écho aux rêves de Macha, Olga et Irina, qui, bloquées dans une ville de garnison à la fin du xixe siècle, fantasment leur retour à Moscou, ville de leur enfance, sans jamais y parvenir, et dont l’horizon semble bouché. Les trois sœurs de Pommerat ainsi que d’autres personnages abordent effectivement les thèmes de l’élan vers l’avenir, de l’illusion et du désespoir. Mais de façon plus complexe (à la fois banale et intense), voilée, critique. Et dans un monde différent, actuel : consumériste et saturé par la communication.
Dans le spectacle, la deuxième fille, merveilleusement jouée par Marie Piemontese, prononce plusieurs discours éclatants sur la place de l’Homme et des objets dans le monde. Elle prédit même un avenir où l’Homme n’aura plus à travailler, sera la seule valeur. Mais pour transcender le « monde matériel », il faut continuer dans le même sens et créer de nouvelles marchandises… Non seulement, elle ne perçoit pas la contradiction de son propos, mais elle incarne, en tant que vedette de télévision qui passe ses journées dans un univers d’images et des nuits sans rêves, ce monde qu’elle voudrait voir disparaître. Malgré l’ironie dont elle fait l’objet, des bribes de son discours nous questionnent. Et sa capacité à introduire de la couleur, de l’espoir et du divertissement (grâce à ses mots, ses robes) dans cette famille en noir et blanc, nous touchent.
Les autres personnages recèlent aussi des élans très contradictoires. Le frère Ori décide d’abandonner l’armée pour un projet de vie « vrai » et « profond », mais il renonce à son idéal et sombre dans la mélancolie. La sœur cadette (adoptée) est une adolescente mystérieuse, avec la vie devant elle, mais son présent semble englué : elle s’empêtre dans des cauchemars, des non-dits, des troubles de l’identité. Le père de famille pourrait symboliser (et dénoncer ?) l’affairisme, le capitalisme, la mondialisation, puisque son entreprise d’armes fait travailler et tue des millions d’individus. Mais il se révèle plein d’humanité et d’humanisme. Sa sénilité grandissante le rend même pathétique. La sœur aînée qui s’apprête à donner la vie pourrait incarner l’espoir, mais elle arbore sans cesse une robe de deuil et semble incapable de se projeter.
Un miroir critique
Son mari possède aussi plusieurs visages : il profère des harangues convenues sur la distinction entre le beau, qui provoque l’envie et émane du progrès, et le laid, la mort, qu’il faut éradiquer. Il évoque les notions de vérité et de réalité (elles sont en nous, il suffit juste de les affronter avec courage). Enfin, il plaide en faveur d’une sexualité « pour le plaisir » en s’adressant à la domestique qu’il a embauchée et qu’il suit partout. On pourrait croire que cet homme en petit costume noir n’est qu’un bourgeois conventionnel, mais il introduit une étrangère dans la famille qui va tendre à tous (y compris à lui-même et à nous, spectateurs) un miroir critique.
Pour finir, le personnage de la domestique, interprété avec intensité par Ruth Olaizola, est le plus énigmatique et le plus subversif de la pièce : présente et absente, sensuelle et animale, bonne ou mauvaise, on lui prête sans cesse des intentions, on la scrute, on la désire, on la hait. Elle se cherche dans les miroirs de la maison, imite les chanteuses à la télévision, déverse sur le plateau ses silences, son idiome imaginaire, sa nudité, sa bêtise (?). Ses séances de karaoké introduisent dans le spectacle des pauses vibrantes, à la fois dramatiques, comiques ou fantastiques…
La pièce Au monde met donc en scène une famille à la fois singulière et dans laquelle on se reconnaît. Elle fait entendre des discours contradictoires sur le réel, qui font penser. Elle esquisse des personnages aux contours mouvants qui laissent l’imaginaire du public travailler (comme dans la littérature). Elle dévoile ainsi à chacun, et avec un esthétisme unique, des morceaux de réalité enfouis jusque-là. C’est généreux et impressionnant. ¶
Lorène de Bonnay
Au monde, de Joël Pommerat
Texte publié aux éditions Actes Sud
Cie Louis-Brouillard • 37 bis, boulevard de la Chapelle • 75010 Paris
01 46 07 33 89
Mise en scène : Joël Pommerat
Avec : Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, Lionel Codino, Angelo Dello Spedale, Roland Monod, Ruth Olaizola, Marie Piemontese, David Sighicelli
Scénographie : Éric Soyer, Marguerite Bordat
Lumière : Éric Soyer
Photo : © Élisabeth Carecchio
Collaboration artistique : Marguerite Bordat
Costumes : Marguerite Bordat, Isabelle Deffin
Son : François Leymarie
Assistante pour la création : Laure Perredon
Odéon-Théâtre de l’Europe • place de l’Odéon • 75006 Paris
Réservations : 01 44 85 40 40
Site du théâtre : http://www.theatre-odeon.eu/fr
Du 14 septembre au 19 octobre 2013, du mardi au vendredi à 20 heures, le samedi et parfois le dimanche à 14 h 30 (attention : pièce en alternance avec les Marchands)
Durée : 2 h 10
36 € | 6 €
Tournée :
– Du 18 au 21 février 2014 : Théâtre national de Marseille-La Criée






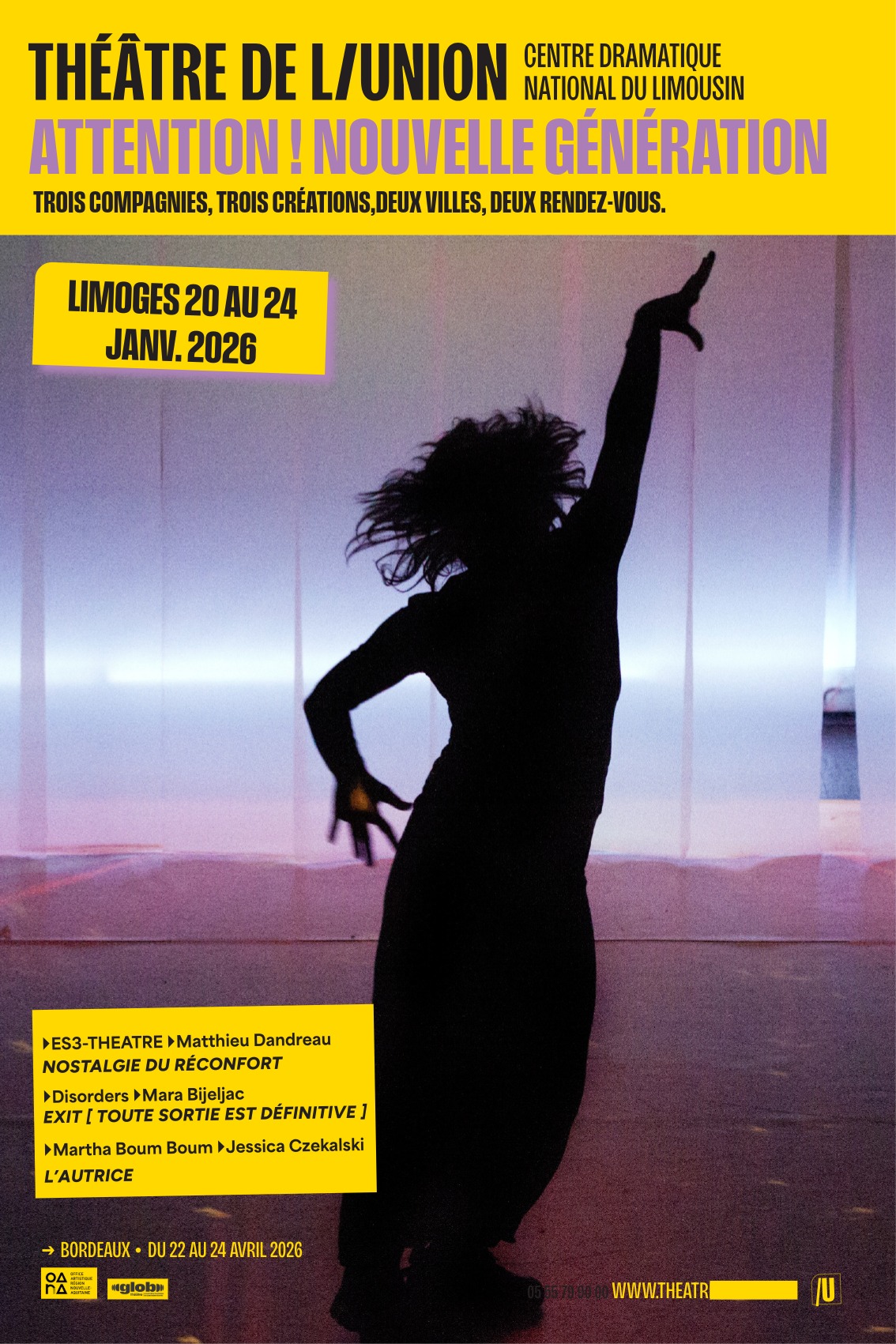

Une réponse