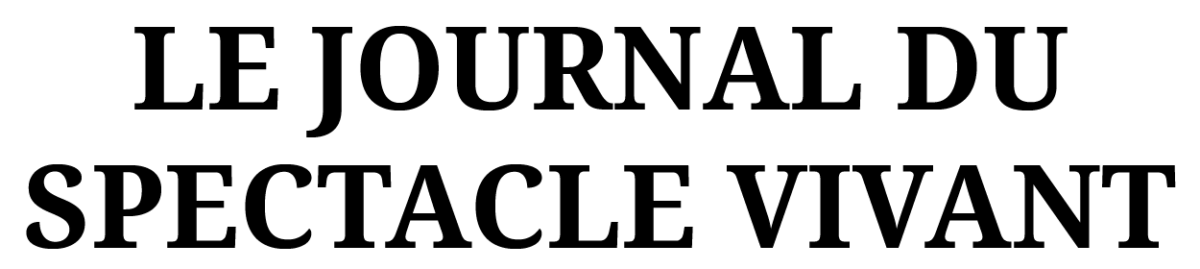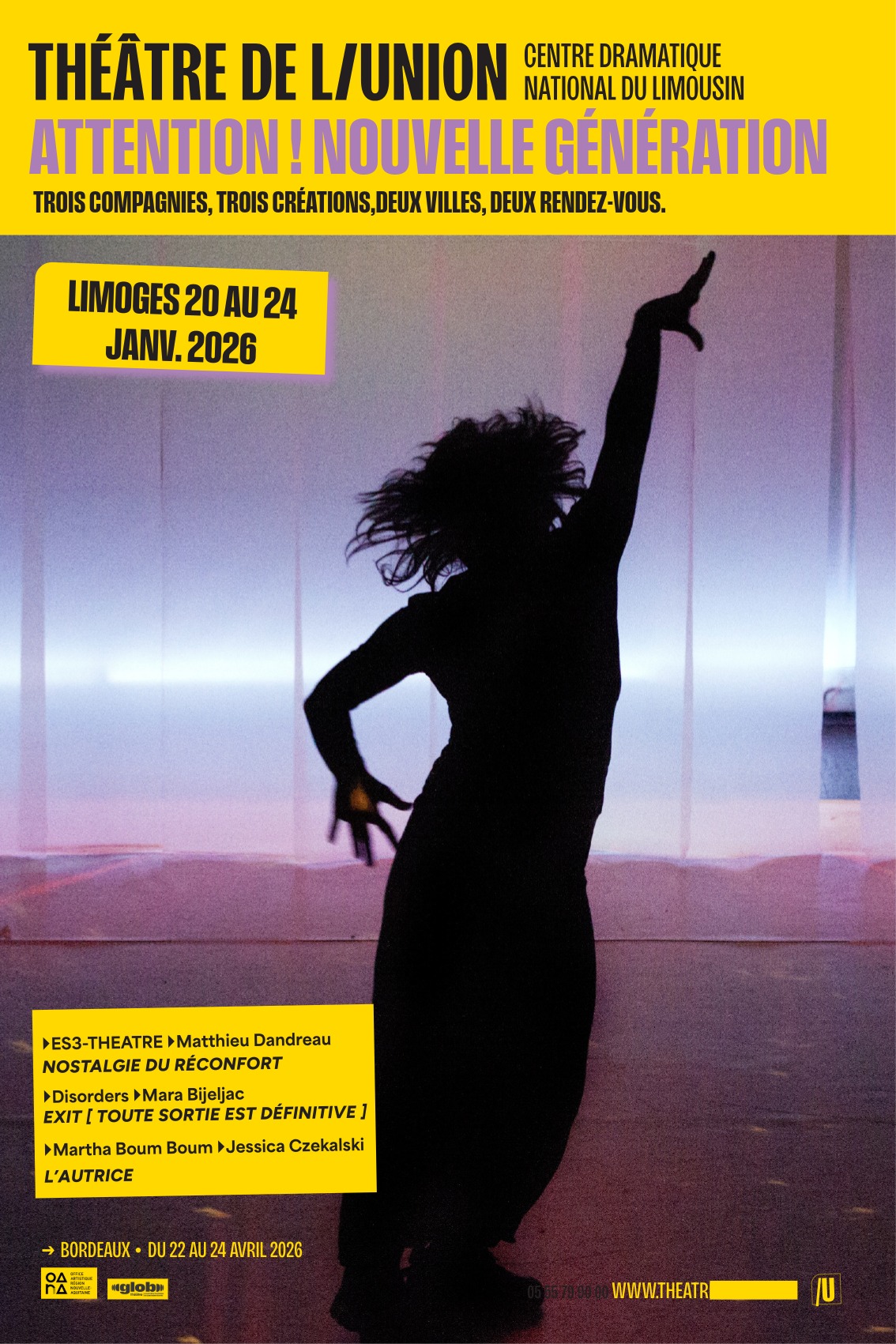De chair et de poésie
Florence Douroux
Les Trois Coups
Voilà ! Après Cap au pire, l’Image, la Première bande et Fin de partie, Jacques Osinski achève son grand cycle Beckett avec la plus emblématique des pièces de l’auteur irlandais : « En attendant Godot ». Méticuleuseusement fidèle à l’œuvre, le metteur en scène livre une version très élégante, charnelle et poétique. La langue de Beckett est porté haut par un quatuor d’excellence : Denis Lavant, Jacques Bonnaffé, Jean-François Lapalus et Aurélien Recoing.
L’œuvre est devenue tellement emblématique au fil du temps, que l’annonce d’une nouvelle adaptation suscite forcément la plus grande curiosité : comment ? Qui ? Quoi de neuf ? Comment vont apparaître ces « clochards métaphysiques » errant dans un no man’s land à peu près vide de tout ? On ne les présente d’ailleurs plus. Vladimir et Estragon, compagnons de route et de vie attendent Godot. « Je ne sais pas qui est Godot. Je ne sais même pas, surtout pas, s’il existe » écrivait Beckett à Michel Polac en 1952. La pièce ne tourne pas autour de l’identité d’un invité mystère se refusant à apparaître, on le sait bien.

Pour abréger, nous disons toujours « Godot ». Il faudrait plutôt dire « En attendant », puisque seule compte l’attente, avec son espoir d’issue et de lendemain sans ennui. Puisque seule cette attente donne encore une impression de vie. « On trouve toujours quelque chose, hein, Didi, pour nous donner l’impression d’exister ». Chaque minuscule péripétie devient donc primordiale.
Il n’y a pas de détail dans la vie de ces vagabonds célèbres au chapeau melon, pas d’anecdote. Tout y a sa place, tout compte : c’est exactement ce qui apparaît dans cette mise en scène célébrant le rien, faisant de chaque mot, chaque geste au bord du néant, un évènement à lui-seul. Sortir un radis de sa poche et l’offrir à son compère, ce n’est pas anodin. Serrer sa chaussure contre soi devient posture de vie.
« Charnellement théâtrale »
Jacques Osinski a fait le choix d’une mouture ultérieure à celle des Éditions de minuit, publiée en 1952. La version, dite de « San Quantin », est celle que le dramaturge a remaniée lors sa création, en 1984, par Walter Asmus, enrichissant de ses notes le travail de son assistant lors de sa propre mise en scène en 1975, à Berlin (The theatrical Notebooks of Samuel Beckett, édité par James Knowlson et Douglas McMillan). Beckett, qui vient participer 10 jours aux répétitions, modifie ses didascalies, attentif, notamment, aux déplacements et distances entre les corps. Il ajoute, selon le témoignage des acteurs, « de la chair aux os du texte ». C’est la version, explique Jacques Osinski, d’un homme « qui a expérimenté la pratique du théâtre », et qui paraît « la plus aboutie, la plus charnellement théâtrale ».

Nous sommes donc loin ici des priorités de Beckett à l’origine, sur le respect de « l’esprit » du texte, lorsqu’il insistait sur « les échos et les symétries de la construction » et un « formalisme appuyé ». En découle une réelle évolution : l’abstraction est tenue à petite distance, même si les comédiens évoluent dans le décor stylisé et décharné qui est l’écrin de la pièce.
Inséparables
Vladimir et Estragon ne vont pas l’un sans l’autre. Beckett les a finalement voulus ainsi, dès le départ. Osinski annonce donc d’entrée de jeu leur double présence : l’une est visuelle, l’autre est sonore. L’un, déjà, écoute l’autre. De dos, immobile et droit, Vladimir se tient au pied de son arbre efflanqué, seul élément de décor, avec cette pierre sur laquelle s’assoit Estragon, pour essayer de retirer ses chaussures. « Rien à faire », Denis Lavant-Estragon donne le ton de la pièce.

Nous connaissons bien le long compagnonnage théâtral de Denis Lavant et Jacques Osinski. Chez Beckett, le comédien est chez lui. Dans la lancée de ce travail autour de l’auteur irlandais, nous l’imaginions déjà, silhouette recroquevillée et cabossée, ronchonnant, avec sa faim et son mal au pieds, habitant de sa gouaille le paysage désertique de Godot. Nous savions qu’un jour apparaîtrait Denis Lavant en Estragon, comme une évidence. Le voilà, impeccable. Le comédien sert sa partition avec le talent qu’on lui connaît, dans une verve sacrément bien dosée : jamais trop, ni trop peu. Un Estragon claudiquant et bourru, corps de guingois, particulièrement émouvant.
Terre et lune
Face à lui, Vladimir. Ah ! La grande silhouette qui se retourne vers le compagnon qui grogne, c’est donc Jacques Bonnafé. Un bonheur. Il arpente le plateau de sa haute stature élastique, moult mimiques au coin des lèvres, regard malicieux. D’emblée est affichée la tendresse du compagnon de route vers le camarade d’infortune, qui dort dans les fossés et revient au petit matin, souvent battu. Que d’émotion, immédiate, dans cette lucidité intelligente sans détour, humour et ironie à l’horizon : « Je suis toujours content de te revoir. Je te croyais parti pour toujours (…) ; sans moi tu ne serais plus qu’un petit tas d’ossements à l’heure qu’il est ».

Le duo fonctionne à merveille. Rarement Estragon et Vladimir ont été, l’un si terrien, l’autre si lunaire. Différence de taille, différence de voix et de posture, on ne peut qu’adhérer immédiatement à ce tandem-là. Beckett notait joliment : « Estragon est sur le sol, il appartient à la pierre. Vladimir est lumière, il est orienté vers le ciel, il appartient à l’arbre ». On ne pouvait mieux faire parler cette complémentarité qu’ici, avec ces deux comédiens. Ils finiraient l’un, par ressembler à cette pierre, à jardin, qui semble son lieu de vie ; et l’autre, à cet arbre, dans sa verticalité, qu’il parera, du reste, lui-même de trois petites feuilles annonciatrices de printemps.
Bras dessus, bras dessous
Un Pozzo tonitruant (Aurélien Recoing), tirant par une laisse le silencieux Lucky (Jean-Frarnçois Lapalus) viennent rompre la monotonie du jour qui n’en finit pas. Ce second duo de la pièce, reflétant non un lien de fraternité, mais un lien de maître à esclave, arrive en tornade. Aurélien Recoing est un Pozzo rugissant, parfois emphatique. Trop ? Non. Le rôle n’est pas tendre. De plus, cette arrivée tonitruante contraste précieusement avec le caractère décalé des deux premiers, et le ronronnement en boucle de leur train-train. Face à ce fort en gueule, aspect comique garanti, Jean-Pierre Lapalus nous livre le fameux monologue de Lucky avec une indéniable présence poétique.
Sous la houlette de Jacques Osinski, cette improbable rencontre entre quatre individus dont on ne sait rien, si ce n’est qu’ils marchent deux par deux, se pare d’une vraie grâce. Nous sommes dans un univers poétique total, baigné de lumières raffinées en demi-teintes, qui n’attend que l’arrivée salvatrice de la lune annonçant enfin une nuit évacuant l’ennui. Vladimir et Estragon, mains sur la lisière, en fond de plateau, scrutent, aux aguets, un horizon vide. Quelqu’un vient-il ? L’espèrent-t-ils ? On sait bien que non. Mais pour tromper le temps, le duo aura fait, bras-dessous, quelques petits tours de piste et se seront serrés l’un contre l’autre face à l’irruption des deux autres. Il y a là un charme évident.
La dernière image des personnages Immobiles, l’un penché sur la terre, l’autre tendu vers le ciel, si évocatrice, est de toute beauté.
Florence Douroux
En attendant Godot, de Samuel Beckett
Le texte est édité aux Éditions de minuit
Site de la compagnie L’Aurore Boréale
Mise en scène : Jacques Osinski
Avec : Jacques Bonaffé, Jean-François Lapalus, Denis Lavant, Aurélien Recoing
Durée : 2 h 15
Dès 14 ans
Théâtre des Halles • Rue du Roi René • 84000 Avignon
Du 5 au 26 juillet 2025 (sauf les 9, 16 et 23), à 21 heures
De 15 € à 23 €
Réservations : en ligne ou 04 32 76 24 51
Dans le cadre du Festival Off Avignon, 59e édition du 5 au 26 juillet 2025
Plus d’infos ici
Tournée :
• Le 27 juillet, dans le cadre du Festival de Théâtre de Figeac (46)
• Les 29 juillet, dans le cadre du Festival Beckett, à Roussillon (84)
• Du 25 mars au 3 mai 2026, au Théâtre de l’Atelier (75)
À découvrir sur Les Trois Coups :
☛ En attendant Godot, mise en scène Alain Françon, par Trina Mounier
☛ Entretien avec Denis Lavant et Jacques Osinski, par Lorène de Bonnay
☛ L’Amante anglaise, Marguerite Duras, Jacques Osinski, par Florence Douroux
Photos : © Pierre Grosbois