Crier au bord de l’abîme
Par Lorène de Bonnay
Les Trois Coups
La dernière création de Julien Gosselin explore l’œuvre protéiforme et oubliée du romancier russe, avec la finesse, la minutie et la délicatesse qu’on lui connaît : « Le Passé », créée à partir du tressage de deux pièces et des nouvelles d’Andréïev, évoque des êtres au bord du gouffre, tout en questionnant de façon vertigineuse leur représentation. Un spectacle monstre inégal, complexe et intense, à décanter.
Avec Léonid Andréïev, on est loin, à priori, des écritures contemporaines de DeLillo, Bolano ou Houellebecq, adaptées par le jeune et brillant metteur en scène. La pièce Ékatérina Ivanovna, fil d’Ariane de tout le spectacle, date de 1912 et nous plonge dans un drame bourgeois : Guéorgui, député de la Douma d’État tire trois coups de fusil sur son épouse Katérina, qu’il croit infidèle. Chez lui sont présents son frère Alexeï, sa mère et l’artiste Fomine. Le Passé s’ouvre donc sur un coup d’éclat d’une intensité dramatique extrême, dans une société très tchekhovienne, sur le point de disparaître, avec des personnages en costumes d’époque.
Mais d’emblée, le dispositif met à distance cette crise du public : hors champ, les personnages fiévreux (filmés en live) profèrent leur spleen et leur hystérie, claquent les portes des couloirs, comme dans un vaudeville. Une fois encore, Julien Gosselin exploite la vidéo pour mettre en perspective ce qui est montré (ici, notamment, un type de théâtre « classique », du passé). La frustration, générée par le fait que peu d’actions sont représentées sur le plateau au décor réaliste, est compensée par l’immersion – très émotionnelle – dans l’image en gros plan projetée sur l’écran central. Et la sensation singulière que les corps des acteurs, entrevus parfois, sont là, pas loin.

L’intrigue de Katérina / Katia se déploie ensuite en étoile. On la retrouve au bout de six mois, dans une datcha, chez sa sœur Lisa, avec celui qui n’était pas son amant mais l’est devenu, après le féminicide manqué. Elle flirte de plus en plus avec la mort, comme si elle n’en était pas revenue d’avoir failli être tuée par l’homme aimé, le père de ses enfants. Tel un fantôme, perdue, vacillante, elle entretient plusieurs liaisons. Deux ans plus tard, elle s’adonne même, devant son mari, sa sœur, ses amants, à une danse d’Hérodiade dérangeante, bouleversante – s’offrant en sacrifice à une assemblée au bord du gouffre.
Cette figure de femme mélancolique, portée par une actrice inspirée, corsetée par une morale étriquée, est certes datée historiquement et socialement, cliché, excessive (les gros plans sur sa bouche ouverte et ses rictus sont insupportables). Mais Katia est aussi criante de modernité ; elle nous émeut, singulièrement. La mise en scène montre ces deux aspects de façon troublante…
Entre cohérence et chaos
Outre cette pièce, utilisée comme matériau principal et disséminée, d’autres nouvelles aux formes et registres très divers font écho à Katérina et aux thèmes que son histoire charrie : L’Abîme, Dans le Brouillard et La Résurrection des morts. Ainsi, la sœur de Katia, Lisa, relate la promenade de deux adolescents perdus dans le brouillard. Leur amour idéal est brisé par la rencontre avec un groupe d’hommes qui violentent la jeune fille. L’amant, face au corps inerte et meurtri, éprouve des pulsions sexuelles exacerbées… Dans le Brouillard évoque Pavel, qui porte le même nom que l’ami du couple Katérina-Guéorgui : cet adolescent est aussi perturbé par l’éveil de ses désirs. Amoureux de sa voisine Katia, incapable de formuler son ressenti, il prend les femmes en haine. Ici, le metteur en scène emprunte aux esthétiques du cinéma muet expressionniste, de la marionnette et du théâtre d’objets, pour représenter ce récit tragico-comique, burlesque. Les acteurs, masqués, sont en effet à peine visibles sur le plateau : le public est rivé à l’écran.
La nouvelle La Résurrection des morts (sous-titrée « Rêverie ») raconte la journée qui précède l’Apocalypse, sous la forme d’un intermède : on assiste aux changements à vue du décor et des comédiens, tandis que le récit se trouve retranscrit sur l’écran. Les signes graphiques lumineux qui se déploient se conjuguent à la poéticité de ce texte qui semble émaner d’une voix off divinement silencieuse : « annoncée par les trompettes des archanges, les morts se levèrent et la terre commença à changer de visage », « l’Homme ne regardait plus les ténèbres du passé, il aimait tout » ; « le souvenir du passé disparut », tous les êtres (fleurs, pierres, humains, etc.), égaux, « se faisaient beaux pour rendre hommage » ; ce fut la « dernière nuit bleue » avant la brume. Enfin, « la lumière devint infinie et le silence devint infini, les cieux s’ouvrirent » marquant « la fin de l’histoire humaine ».

Les motifs de la folie, de la mort qui envahit les vivants, de la sexualité, mais aussi de la voix (du corps, donc) tissent des liens profonds entre les textes divers qui composent l’œuvre russe. Julien Gosselin met autant en valeur son unité thématique que son hétérogénéité stylistique, en créant lui-même un spectacle monstrueux. Il coud ensemble des parties très hétéroclites : de longues scènes de mélodrame portant loin l’hystérie féminine, des tableaux visuels et sonores aussi époustouflants que les œuvres de Bill Viola, des vidéos puisant dans des univers esthétiques multiples – romantisme noir, fantastique, mysticisme, symbolisme, expressionnisme, nouveau théâtre… Et un objet non identifié, passionnant : l’étrange pièce Requiem.
« Tellement vivants que Dieu lui-même pourrait s’y tromper » (le Peintre)
Plongé dans le noir, le public lit les dialogues sur le grand écran et entend les voix métalliques d’un Peintre, d’un Metteur en scène, d’un Directeur de théâtre et du personnage mystérieux Sa Clarté. Il est précisé qu’un petit théâtre a été recréé avec des poupées représentant les spectateurs absents, dans la chambre à coucher d’une maison abandonnée – celle de Katérina et Guéorgui, sûrement. Moment sidérant, à la fois hermétique, méta-théâtral et métaphysique, qui semble rompre avec ce qui précède. Et pourtant, non. Les voix sonorisées font écho à la voix de l’artiste ventriloque du début, faisant parler son singe Jaïpur. À celle de Katérina, en transe, proche de l’exorcisme. Ces voix robotiques (que l’on trouve dans la musique et le cinéma depuis quelques décennies) abordent les questions du théâtre et du vide, du silence de Dieu compensé par la création artistique, même quand le public est absent. Que de résonances !
Comment saisir l’Homme et le représenter ?
Alors, certes, la dernière création de Gosselin déconcerte ; elle est inégale (à l’image des écrits russes). Sa composition peut perdre, agacer, ennuyer. Elle nécessite un effort de la part du spectateur, pris dans les rets des images et des sons, du jeu, de la scénographie, englouti dans un maelström d’émotions. Mais, en définitive, non seulement elle lui fait pénétrer une écriture et un monde à la fois datés et intemporels, mais elle l’invite à une réflexion sur l’art.

Nous faisons donc face à des personnages au bord de la crise de nerfs, qui crient leur mélancolie. Ils rêvent d’un futur dont ils se sentent privés. Ils s’efforcent de ne pas sombrer dans l’abîme (pulsion de mort ou monde en train de disparaître). Cri cosmique, jouissance trouble, prière, silence. Ces êtres sont enfermés dans un langage, une forme, sans cesse interrogés par la mise en scène (mêlant théâtre, musique et vidéo) : le corps des acteurs sur le plateau est tantôt mis à distance (caché ou dévoilé, selon l’angle de vue de la caméra), tantôt très proche de celui des spectateurs (grâce à l’écran). Ces vivants sous les feux de la rampe s’adressent donc à nous avec peine. Ils n’existent, en tout cas, dans leur boîte noire, que le temps de la représentation. Ou d’un songe. Avec eux, Julien Gosselin interroge la fin d’un monde (celui d’Andréïev, le nôtre), la littérature et le théâtre passés, la possibilité de communiquer vraiment avec un public, à travers un théâtre qui cherche à se renouveler.
Son spectacle embrasse peut-être trop d’éléments. Mais le trop plein de cette proposition est une réponse à la crise actuelle – multiforme. Comment ne pas fraterniser avec ces vivants excessifs qui préfèrent la clarté à la nuit ? ¶
Lorène de Bonnay
Le Passé, d’après Léonid Andréïev
Traduction : André Markowicz
Mise en scène : Julien Gosselin
Avec : Guillaume Bachelé, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Carine Goron, Victoria Quesnel, Achille Reggiani, Maxence Vandevelde
Durée : 4 h 20 avec entracte
Odéon Théâtre de l’Europe • Place de l’Odéon • 75006 Paris
Du 2 au 19 décembre 2021, du mardi au samedi à 19 h 30, le dimanche à 15 heures
Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris
De 6 € à 41 €
Réservations : 01 44 85 40 40
Tournée :
- les 14 et 15 janvier 2022, Espace des Arts, Chalon-sur-Saône
- les 28 et 29 janvier, Le Phénix, scène nationale Valenciennes
- les 23 et 24 février, Maison de la Culture d’Amiens
- les 31 mars et 1er avril, L’Empreinte, scène nationale Brive / Tulle
- les 14 et 15 avril, Scène nationale d’Albi
- les 11 et 12 mai, Château Rouge, scène conventionnée d’Annemasse, en coréalisation avec La Comédie de Genève
- du 20 au 25 mai, Les Célestins, Théâtre de Lyon, en coréalisation avec le TNP de Villeurbanne
À découvrir sur Les Trois Coups :
☛ Joueurs, Mao II, les Noms, d’après Don DeLillo, Julien Gosselin, la FabricA au festival d’Avignon 2018, par Lorène de Bonnay
☛ 2666, d’après Roberto Bolano, Julien Gosselin, la FabricA au festival d’Avignon 2016, par Maud Sérusclat‑Natale
☛ Les Particules élémentaires, de Michel Houellebecq, Ateliers Berthier 2014, par Aurélie Plaut







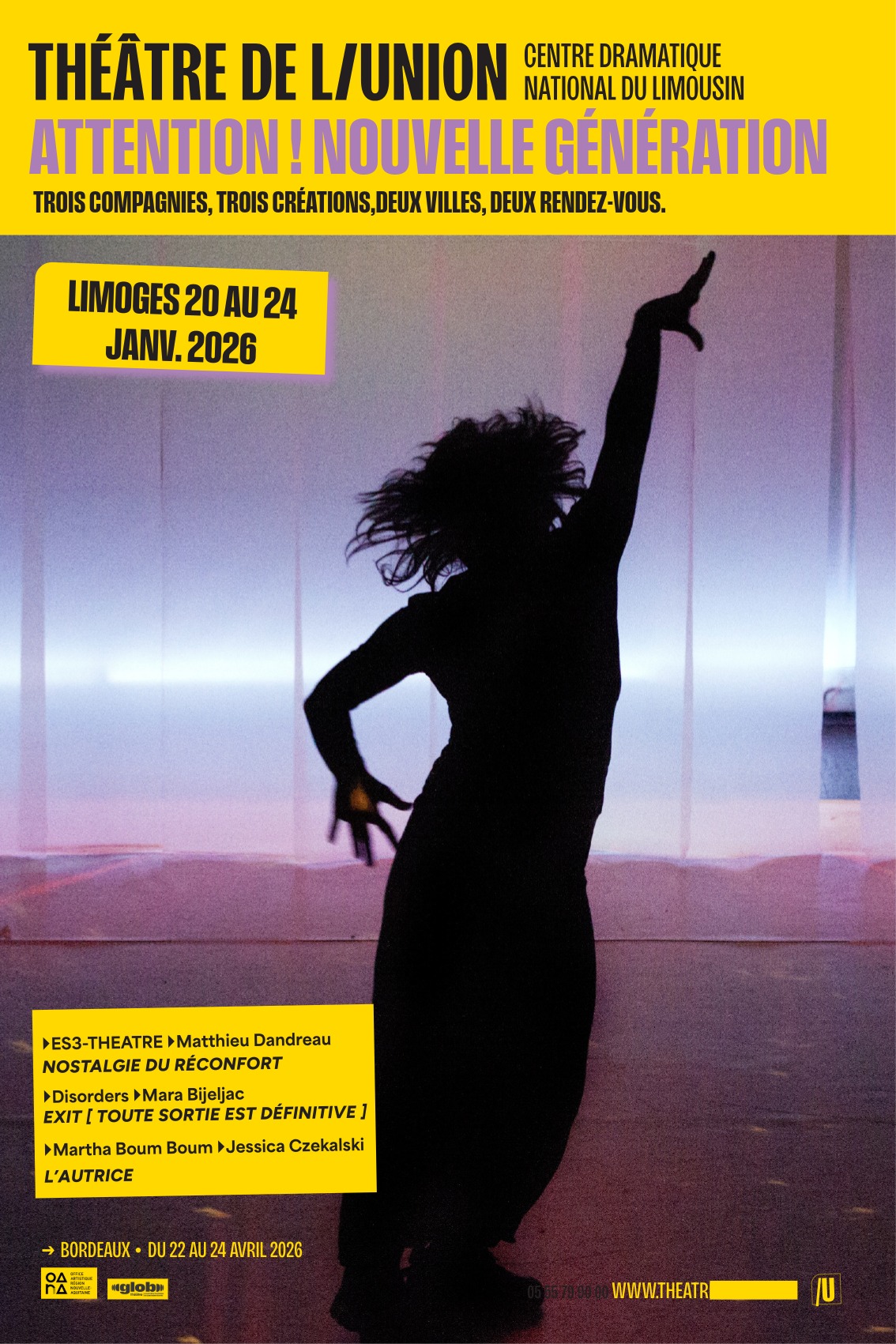

Une réponse
Bonjour,
À vous lire, la densité de la mise en scène et la saturation visuelle posent problème à la réception de ce spectacle.
N’est-ce pas tout simplement le parti pris du metteur en scène qui par effet de marathon dialogué, de recherche performative et d’effets esthétiques, s’emmêle les pieds ?
La culture théâtrale n’est pas l’exploit mais l’impression de la sensibilité dans l’espace vécu…
Il serait temps que les choses changent !