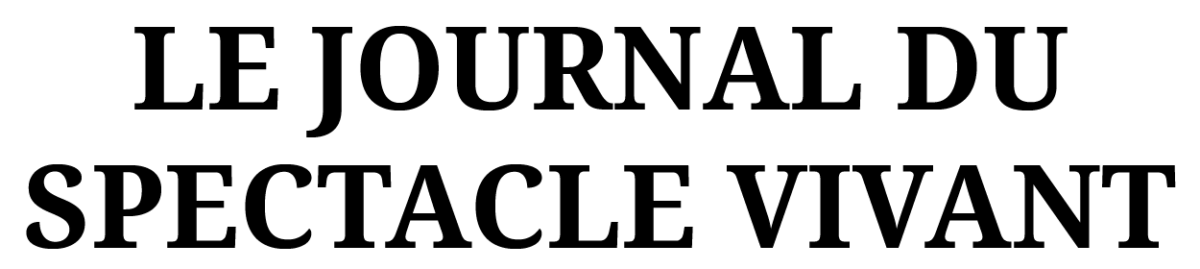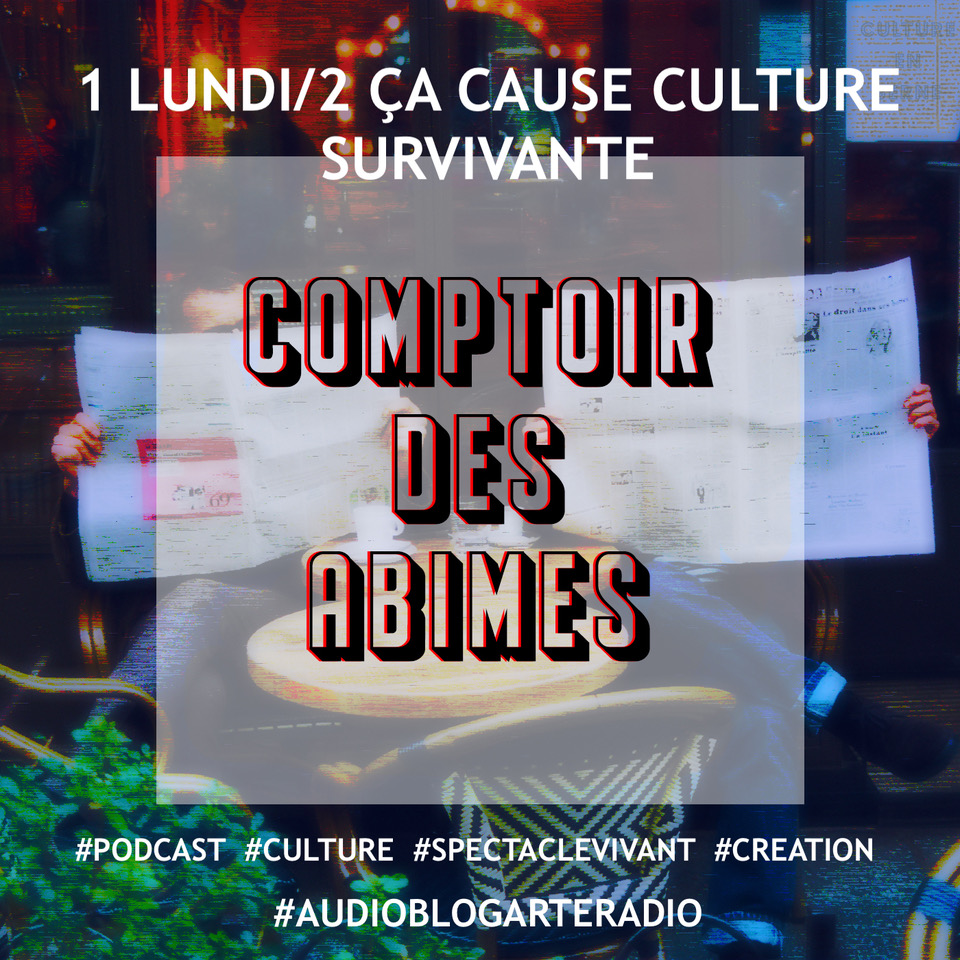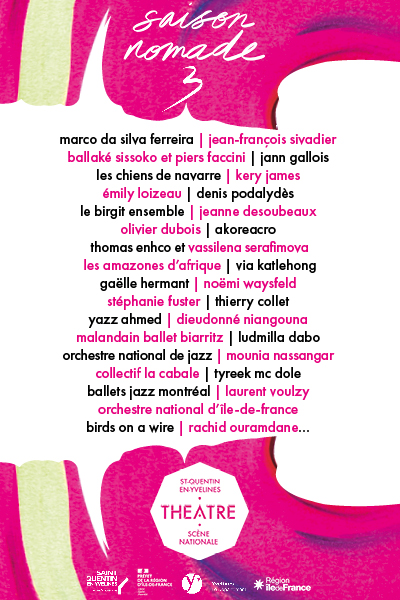Éric Ruf réalise le rêve vilardien avec son Soulier à la Cour !
Lorène de Bonnay
Les Trois Coups
L’administrateur général de La Comédie-Française achève divinement son mandat avec cette magnifique proposition scénique du Soulier de satin dans un lieu « olympien » pour tout acteur. Après Antoine Vitez, en 1987, qui réunissait Didier Sandre en Rodrigue et Ludmila Mikaël en Prouhèze, on retrouve Didier Sandre en Don Pelage, devenu l’époux de la protagoniste, jouée par Marina Hands (la fille de Ludmila). Jean-Louis Barrault était le premier à monter une version abrégée en collaboration avec Paul Claudel, en 1943, à la Comédie-Française. Ainsi, la boucle de cette pièce cosmique est bien bouclée pour Éric Ruf et sa troupe majestueuse. Ils nous offrent une nuit dilatée dans le temps et l’espace, une histoire à la fois baroque, burlesque et lyrique, aux accents divins, avec une sorte d’aisance et de joie suprêmes, propres à leur art exigeant. En variant les registres, en accentuant le comique et le rapport scène-salle de la Cour, en se souciant si savamment du public, ils métamorphosent ce « théâtre monstre » en spectacle « populaire ». Tant de destins condensés vibrent dans cet espace monumental et inouï…
La nuit du 19 juillet débute avec un tel agrément ! Les comédiens du Français accueillent le public, se mêlent à lui dans les gradins ou se préparent sur scène (prennent le plateau, respirent, s’encouragent). Ils n’ont répété là qu’une nuit, la veille. Les costumes de Lacroix sont d’emblée dévoilés et admirés. La nudité du plateau, chère à Vilar et Ruf, est sublimée par les murs du palais, la lumière et le ciel d’Avignon étoilé… Au cours du spectacle, les passerelles de la salle Richelieu sont ingénieusement remplacées par les déplacements à l’horizontale et à la verticale des personnages dans les gradins de la cour : le public est encore plus immergé. Le petit soulier offert par Prouhèze à la Vierge pour se prémunir de sa passion pour Rodrigue (elle ira vers le mal mais d’un pied boiteux) est attaché à un ballon rouge, une petite planète, qui s’élance vers d’autres cieux, d’autres scènes du festival (In et off), au-delà du palais. Tant de trouvailles se trouvent magnifiées par ce lieu en extérieur… Les entractes permettent aussi d’apercevoir Robin Renucci (qui incarnait Camille chez Vilar), Thomas Jolly ou encore notre président si chaleureux, Tiago Rodrigues : tant de spectacles joués ici, du Soulier de Vilar à By heart, en passant par Thyeste, tant de mémoire théâtrale font écho aux différentes temporalités du Soulier de satin : le temps du plateau, le passé commun à tous et le temps subjectif, propre à Rodrigue ou Prouhèze, par exemple. C’est assez vertigineux.
Ayant été marquée par la mise en scène d’Olivier Py il y a une vingtaine d’années, celle d’Éric Ruf nous paraît tout aussi shakespearienne mais moins profuse, moins lyrique. En mettant l’accent sur la puissance comique des scènes secondaires, en s’intéressant aux situations de chaque tableau (tragiques et ridicules, abstraites et concrètes), la pièce devient plus accessible. Peut-être y entend-on moins « l’appel » métaphysique claudélien… et encore. Le talent des comédiens en fait jaillir des éclats. Car outre la dimension « roman picaresque » et l’intrigue planétaire, le thème central de la passion interdite mais guidée par Dieu irrigue ce texte hors norme. Cette dimension nous avait secouée et nous étonne (au sens fort) toujours. Prouhèze, séparée longtemps de Rodrigue (après un baiser), mariée à d’autres, se refuse à celui qu’elle aime et sacrifie leur amour sur terre au nom de l’honneur (et du pouvoir). Mais ce faisant, elle explique à Rodrigue qu’elle lui donne tout : elle est « la Joie incarnée » ici-bas; son désir (charnel et spirituel) manifeste l’amour infini, total, qui nous englobe tous ! Cet amour est à la fois très réel, présent, et céleste, proche d’un rêve (Prouhèze est d’ailleurs comparée à une étoile). Quant à Rodrigue, arraché à son destin de vice-roi, ébranlé par Prouhèze, il ne la retrouve que dans l’éternité. Claudel s’est inspiré de ses sentiments pour Rosalie, une femme mariée, dans toute son œuvre. Dans Le Soulier de satin, en évoquant un amour pétri de contradictions, de doutes, fait de chair et de grâce, il « demande des comptes à dieu », constate Ruf, dans un rapport plus « horizontal ». C’est proprement fascinant.

Il est temps d’inviter les lecteurs à lire la critique complète du spectacle par Florence Douroux, ici.

Lorène de Bonnay
Le Soulier de satin, de Paul Claudel
Texte : Paul Claudel
Version scénique, mise en scène, scénographie : Éric Ruf
Avec : Alain Lenglet, Florence Viala, Coraly Zahonero, Laurent Stocker, Christian Gonon, Serge Bagdassarian, Suliane Brahim, Didier Sandre, Christophe Montenez, Marina Hands, Danièle Lebrun, Birane Ba, Sefa Yeboah, Baptiste Chabauty, Edith Proust et Fanny Barthod, Rachel Collignon, Gabriel Draper* et Vincent Leterme, Aurélia Bonaque Ferrat*, Ingrid Schoenlaub, Anna Woloszyn
Durée : 7 h 50 avec trois entractes inclus (1ère partie 1h30, 2e partie 1h35, 3e partie 1h, 4e partie 2 heures)
Cour d’honneur du palais des Papes • Place du Palais • 84000 Avignon
Du 19 au 25 juillet 2025 (sauf le dimanche), à 17 heures
De 20 € à 70 €
Réservations : en ligne • Tel. : 04 90 27 66 50
Dans cadre du Festival d’Avignon, du 5 juin au 26 juillet 2025
Plus d’infos ici
Photos : © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon