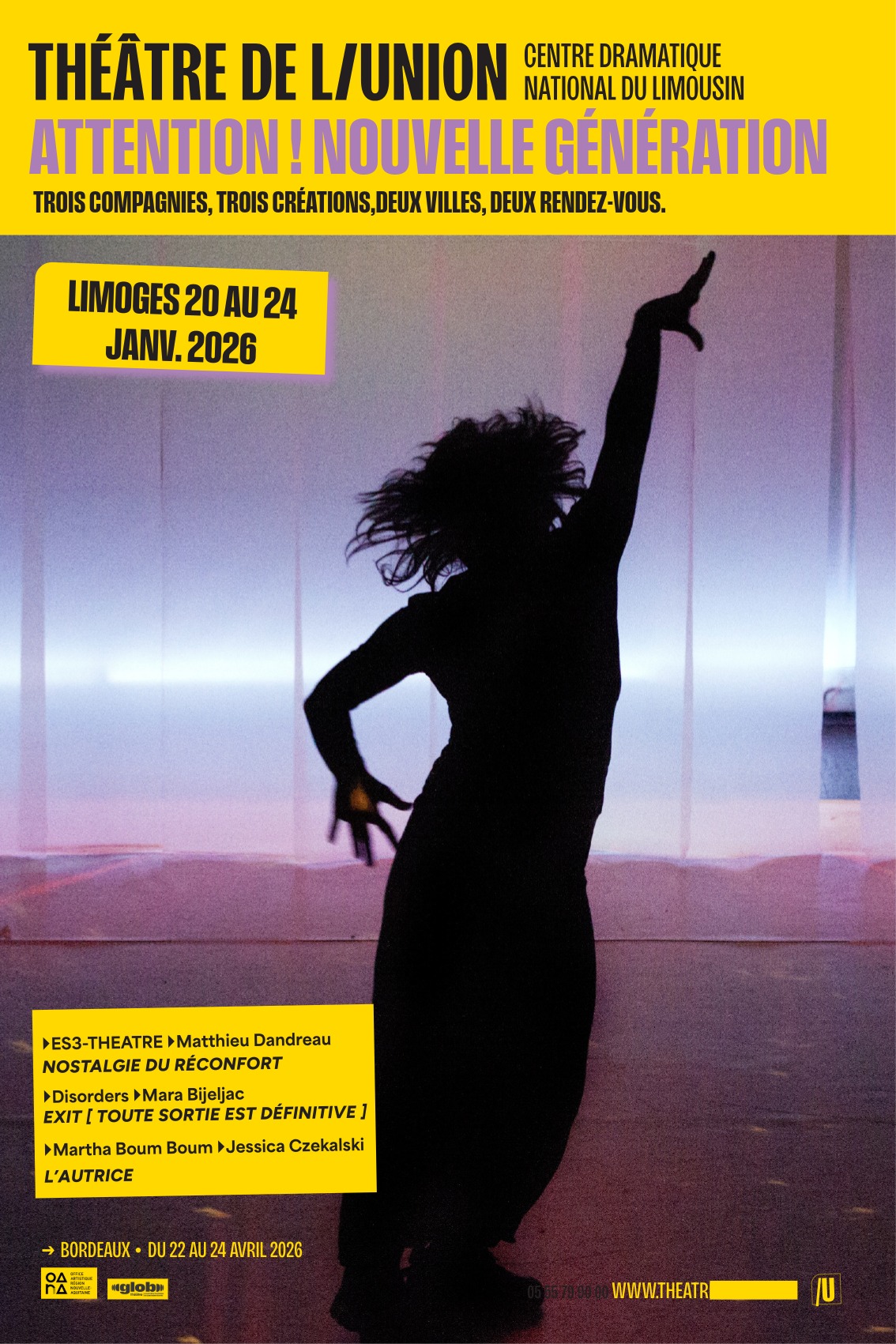Les spasmes publics
Par Stéphanie Ruffier
Les Trois Coups
Vingt minutes pour extraire le suc d’un projet artistique, c’est le temps imparti à chaque apprenti de la Formation avancée et itinérante des arts de la rue (FAI-AR). Les 17 et 18 avril à Marseille, Cucuron et Port-Saint-Louis, après vingt-deux mois au sein de cette formation supérieure d’art en espace public, ils étaient quatorze à présenter leurs étapes de travail avec pour consigne : « oser, prendre des risques, désobéir ».
Michel Crespin, piquant saltimbanque et grand combattant pour la reconnaissance des arts de la rue, avait rêvé d’une école aux prises avec le réel, nourrissant ses étudiants de voyages, de rencontres professionnelles, d’innutrition, de recherches transdisciplinaires débridées. Que reste-t-il de cet esprit frondeur qui rêvait de bousculer sans cesse l’espace public en y injectant de l’art ?
L’itinérance, tout d’abord. Les apprentis de cette septième promotion pouvaient investir le centre de création Lieux Publics à la Cité des arts de la rue, les rues autour de la porte d’Aix au centre de Marseille, mais aussi celles de Port-Saint-Louis-du-Rhône, en partenariat avec le Citron Jaune, et le village de Cucuron où se déroulait le festival, Le Grand Ménage de printemps.
Pas facile pour ces artistes tout juste tombés dans l’arène d’affronter le regard des professionnels, « le public le plus infect de la terre, une hyène prête à les dépecer » selon leur marraine Hervée de Lafond, « ni bonne, ni fée ». Pilier du Théâtre de l’Unité, elle est connue pour ruer dans les brancards des discours institutionnels.

Les tendances cette année ? Beaucoup d’illustrations de nos peurs et de belles tentatives de résistance par le lien. Lidia Cangiano tire son épingle du jeu avec Numeta. Architecture de la chute, un jeu chorégraphique en boucle dans un espace de prison, truffé de chausse-trappes. Elle métaphorise l’hôpital de la Timone, à Marseille, et nous sommes cantonnés, comme les parents des services d’enfants malades, à un rôle de voyeurs parqués. La comédienne risque la chute, se défait de sa squame verte, repart à l’assaut d’un univers de tiges métalliques qui n’est pas sans rappeler les broches chirurgicales : « tout est provisoire et perpétuel, tout est urgent et rien ne bouge ». Glaçante et cohérente dénonciation d’un service public à la dérive, sans considération pour l’humain – usagers comme personnel soignant.
Nyctalope, de Maëva Longvert, nous enferme dans le parking d’un grand hôtel. Elle joue avec nos peurs primitives des lieux souterrains et de la mauvaise rencontre dans la nuit noire. Elle tisse des organes rouges, nous fait croiser de fascinants êtres emmaillotés, des autruches qui convulsent comme dans un grand cauchemar. On croirait des monstres japonisants à la Miyazaki pour dénoncer l’envahissant plastique. Mais une phrase nous donne la clé : « C’est le plus souvent dans un lieu qu’on connaît, avec quelqu’un que tu connais ». Il s’agit bien d’une évocation du viol. L’échappée vers la sortie semble un peu artificielle : oser ressortir, réinvestir la ville. On aurait aimé un parking plus réaliste, plus sale, moins policé.
La rue comme partenaire
Beaucoup de propositions concernent l’attente, le temps dilaté, le « que faire » et les errements du corps, au risque de lasser parfois. Le sens et la beauté surviennent quand elles affrontent pleinement la matière du théâtre de rue : l’extérieur, la foule, le « public-population », comme le nommait Crespin.
Laetitia Madancos crée avec Intervalle(s) un fabuleux et prosaïque ballet du quotidien dans la rue pentue et animée des Petites Maries. Son danseur est assez peu visible dans ce grand flux, mais la voix qui égrène les histoires partagées des habitants perce les cœurs : coiffeur immigré, femme courage, vendeur de clopes à la sauvette… Ils sont là, en photo, ou en chair et en os, aux fenêtres, sur le pas des portes, plus forts que les installations plastiques. Certaines pleurent. Tous les passants deviennent des personnages. Sur le mur, des tags : « Justice pour Alexis et Adama », « C’est fou ce que la poésie peut nous amener en bateau ». Tout se lit et tous se lient. Une vraie fenêtre sur le réel. Sur une table, nous croisons les situationnistes, Georges Perec, Sophie Calle, les errances de Raymond Depardon. Nous fluons, oiseaux de passage, agents du voyage, de cette poignante école du regard.

De même, Camille Mouterde prend de vrais risques avec Crue ou le déjeuner sur l’herbe. Elle allonge sa comédienne à même le sol de la Halle Puget, sur le dos, et la recouvre de miettes. « Mangez-moi », implore cette sainte offerte en sacrifice, cette cannibale narcissique. Elle revêt toutes les postures contradictoires d’une ogresse qui joue avec les symboles de la mère nourricière et dévoratrice. Son corps christique au féminin est donné en pâture comme une prostituée. On devine les transfuges de gouaille révoltée de sa tutrice Marie-Do Fréval, autrice et comédienne choc. Toutes deux cultivent une harangue de grande prêtresse païenne, toujours vent debout contre les hypocrisies. La recherche plastique est saisissante. Mais l’orgie heurte une passante qui crie au gaspillage, comme une illustration de la grâce et de la violence du jeu dans un lieu populaire. Les pigeons s’envolent, se rapprochent un peu : cocasse quand on sait que l’apprentie a d’abord voulu travailler sur cet animal voyageur et sur les transports en commun. La comédienne insiste, déploie sa puissance, fait sienne une parole très enflée. En surcharge, mais prometteuse !
Pluie de rubis
C’est à Cucuron que ce panorama trouve enfin un écrin idéal, accueilli par le festival Le Grand Ménage de printemps. Libérés des contraintes sécuritaires, nourris par un public de badauds, d’heureux apprentis se frottent à la vieille pierre et aux habitants du village. De sécurité, pourtant, il est fort question ! La Mondiale de la Terreur de César Roynette, au pied de l’église prend à bras le corps le climat terroriste anxiogène : le public est accueilli par d’inquiétantes détonations, puis rapidement ceinturé par de larges bandes de rubalise rayée noir et jaune. Le comédien qui avait su moquer si frontalement le métalangage culturel lors de la cérémonie des présentations à la FAI-AR, fait feu de tout bois. Il use ici encore de l’autodérision. Gueule et dents goudronnées, il égrène une litanie de « monstres » mythologiques ou médiatiques… Tout y passe : la peur de Belzébuth, de l’Arabe, du Roumain, de la terrible marraine de la promo… de l’Autre ! « Vos angoisses, vos échecs, votre frustration, c’est eux ! » Il ose beaucoup, se déplace avec une certaine efficacité, propose des solutions drôlement flippantes, bénéficiant d’un jeu très sincère et d’un texte intelligent. Le salut se termine par une franche accolade avec le curé.
Autre lieu, autres mœurs ! Morgane Audoin nous accueille, en langue arabe, avec un rite d’hospitalité à base de semoule sur une placette. Flirtant avec le journal intime et la posture de conteuse, elle explore l’histoire familiale et son identité de petite-fille de harkis. Elle tente de reproduire la fameuse recette de cuisine des msemens de sa mamie, la Nenna. Le tutoriel calamiteux tourne à la leçon de géopolitique, avec participation du public. Au fil de la courte déambulation, la rue se transforme en Méditerranée, le public s’observe sur les deux rives. Le sourire toujours vissé aux lèvres, la comédienne sait jouer de l’universel et du détail intime, et le matériau sonore documentaire est traité avec délicatesse.
Apothéose finale au sens littéral, l’inénarrable Johnny Seyx fait descendre le dieu de l’Amour parmi nous. Celui qui frayait déjà dans les festivals d’arts de la rue avec Superfluu a choisi de travailler sur le sentiment amoureux, sujet casse-gueule s’il en est ! Son ambition secrète ? Concevoir un spectacle qui permette de réactiver le coup de foudre. Pour toujours pour l’instant débute ainsi par une mystification. Un type prend le micro pour décrier les barrières Vauban, des spectateurs punks embrayent sur le besoin d’amour et invitent à un grand rituel collectif pour deux cents personnes, avec « pluie de rubis biodégradables ». Le personnage providentiel est drôle, le dispositif courageux et cette célébration de l’instant présent et de la rencontre, ma foi, assez magique. Le potentiel fédérateur de la rue apparaît pleinement; son alchimie farcesque, sa vitalité sont aussi simples et régénérantes qu’une pluie de confettis. ¶
Stéphanie Ruffier
7e panorama des chantiers de la FAI-AR
Les apprentis : Morgane Audoin, Lidia Cangiano, Marie-Yvonne Capdeville, Lilli Döscher, Johnny Seyx, David Eichenberger, Sophia La Roja, Lola Legouest, Maëva Longvert, Laëtitia Madancos, Camille Mouterde, Marion Pastor, Maëlys Rebuttini, César Roynette.
Durée de chaque maquette : 20 minutes.
Partenaires :
Lieux publics • Cité des arts de la rue • Marseille
Le Citron Jaune • Centre national des arts de la rue et de l’Espace Public • Port-Saint-Louis
Festival Le Grand Ménage de printemps • Cucuron
Ces maquettes aboutiront à la création de spectacles en espace public à voir dans les festivals d’arts de la rue.
Légendes :
7e panorama des chantiers de la Fai-ar © Augustin Le Gall
Titre photo : Les apprentis de la 7e promotion Hervée de Lafond de la Fai-ar
7e panorama des chantiers de la Fai-ar © Augustin Le Gall
Titre photo : selon choix « CRUE » par Camille Mouterde, ou « Numeta, architecture de la chute » par Lidia Cangiano