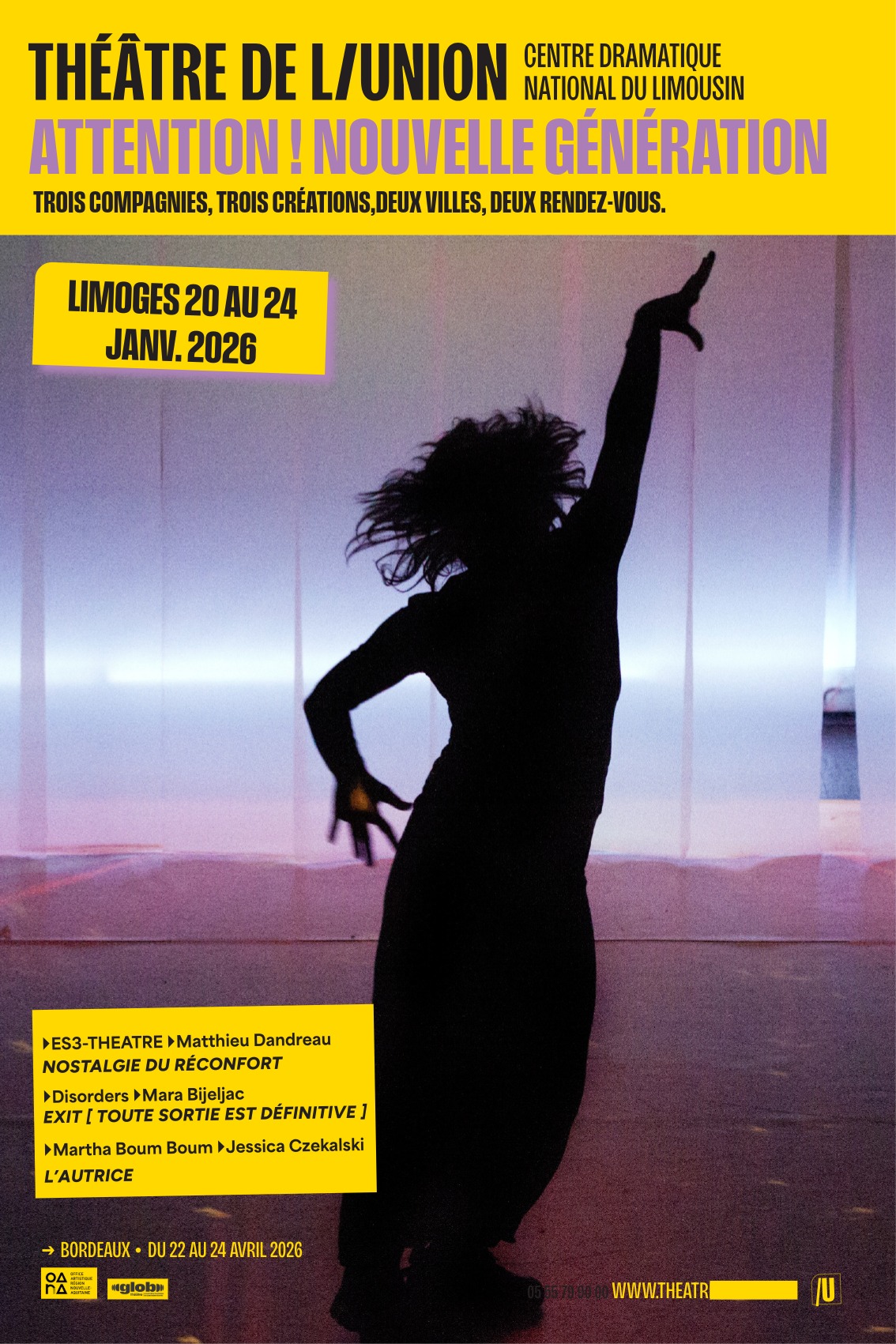L’ange jaune
Par Delphine Beaugendre
Les Trois Coups
Nouveau spectacle de Jan Fabre présenté cette année à Avignon, dans un registre plus intimiste que ceux auxquels le tumultueux et polémique metteur en scène flamand nous avait habitués (se souvenir d’Avignon 2005 et de ses choix radicaux, donc controversés, en tant qu’artiste associé), « Another Sleepy Dusty Delta Day » est un solo joué, chanté et dansé jusqu’à l’incandescence par son interprète, Ivana Jozic, une des muses de l’artiste. Un long poème d’amour et de mort, une danse macabre, qui célébrerait la liberté sur les braises de la vie.
D’abord, on ne voit qu’elle. Longue silhouette jaune, somnolente dans la lumière, s’éventant, jambes écartées. Le public s’installe, religieusement. On a presque peur de la surprendre, de la réveiller, de venir troubler la torpeur moite de cette journée d’été. Elle est pourtant moins impudique que belle, libre, offerte, dans l’abandon de la sieste et de la chaleur estivales. Autour d’elle, on distingue des cages enfermant des canaris, des circuits électriques avec des trains et des petits monticules de charbon, qui, irisés, luisent dans la pénombre. Avec infiniment de précaution et de délicatesse, elle déplie une lettre, bleue comme un télégramme, qu’elle avait, cachée à l’intérieur de son corsage, sur son sein, sur son cœur et, ne cessant de l’embrasser, elle va nous en faire la lecture. Il s’agit d’une lettre d’adieu. Et d’amour. Et de mort.
S’inspirant de la chanson Ode to Billy Joe, écrite en 1967 par la chanteuse américaine country Bob Gentry, Jan Fabre a écrit pour ce spectacle un texte très personnel sur le suicide, sur cet acte éminemment poétique parce que « digne et fier ». Cette ballade est en effet le récit d’un suicide : lors d’un dîner de famille, une mère annonce, entre deux services de plats, la mort d’un jeune homme, Billie Joe MacAllister, depuis le pont Tallahatchie, et l’adolescente attablée avec le reste de sa famille cesse de manger, de parler, de bouger… À ce mystérieux récit (encore objet de spéculations aujourd’hui) s’ajoute un drame personnel vécu par Jan Fabre : celui de la perte récente de sa mère, emportée par un cancer. Le terrifiant spectacle de sa lente agonie a laissé l’homme orphelin (« Mon éternité s’en est allée avec la mort de ma mère » *) et, paradoxalement, l’a « libéré ». En tout cas, liberté ultime de décider de sa propre mort, de déterminer en toute conscience, avant de subir les affres de la maladie et de la décrépitude, son heure, son moment, son temps. Défier la nature et ses lois arbitraires, mais aussi « réfuter cet instinct oppressant de troupeau qui définit notre existence », mourir comme on a vécu, c’est-à‑dire libre et affranchi. Vouloir « rencontrer la mort ». Pas d’héroïsme, car la peur est bien là, « immense », sclérosante, humaine, légitime. Mais « plutôt une fin dans la peur qu’une peur sans fin. »
Ce texte, vibrant hommage à résonance directement autobiographique, et peut-être le plus personnel de l’auteur jamais écrit à ce jour, prend donc la forme d’une lettre d’adieu adressée à Ivana Jozic, une (sinon son) interprète fétiche, égérie connue de son univers onirique et décadent (avec laquelle il collabore depuis de nombreuses années, et avec laquelle il a notamment créé l’Ange de la mort en 2003, présenté à Avignon l’année suivante). Cette confession crue, intime, sans fard, de l’artiste à son interprète est aussi une déchirante déclaration d’amour d’un homme à une femme, dédiée à « sa princesse », est signée « ton Lancelot ». Cette forme, volontairement intimiste et audacieuse (parce que périlleuse : en effet, en pénétrant ainsi malgré nous dans la sphère « privée » de l’artiste, ne sommes-nous pas à la lisière très ténue d’un certain voyeurisme ?) rend l’expérience du spectacle encore plus forte, et nous laisse à la fois émus et déconcertés… Que faut‑il croire ? Faut‑il y croire ? Qu’importe finalement, quand la pudeur et la beauté l’emportent.
Rythmé par la lecture de la lettre, qui égrène les heures avant le passage à l’acte, le spectacle se construit autour de cette dualité entre le couple formé par Jan Fabre et Ivana Jozic (leur réalité, leur collaboration, leur amour, réel ou supposé, présent ou passé…), et celui formé par le jeune homme et l’adolescente, autour de ces deux morts qui se superposent (celle de la mère de l’artiste, celle du jeune homme de la chanson). Et, dans cet entrelacs d’amour et de désespoir, il y a ce blues lancinant, magnifiquement interprété par Ivana Jozic. Puis elle se met à danser… Une danse de mort, une esquisse de la chute, du saut dans le vide, du plongeon vers l’inconnu. Mais aussi de l’écrasement au sol et/ou de la noyade dans la rivière. Une danse frénétique, sauvage, violente, lyrique, quasi organique. Un corps tourmenté et traversé de spasmes, qui tremble, rampe, enfle, cogne, lutte, résiste. Puis qui se raidit soudain. Se désarticule, se déshumanise, se désincarne. Et, sous nos yeux, se mécanise, devient corps-machine qui charrie avec ses mains-outils du charbon, dans la réalité suintante et crasseuse de la mine, du labeur, de l’enfer. La musique, tour à tour jazzy et langoureuse, ou carrément rock vrombissant ; les éclairages inspirés, sur les murs patinés et les vieilles pierres chargées d’histoire de cette chapelle des Pénitents-Blancs : tout concourt à faire de ce spectacle une expérience envoûtante à la beauté hallucinée.
La performance d’Ivana Jozic est immense : tour à tour violente et puissante, mutine et espiègle, majestueuse et athlétique, triviale ou déesse, elle hante littéralement le plateau, elle danse ce texte. Car il y a de l’humour chez Jan Fabre, et des relents d’enfance aussi. Que la danseuse se pose un moment et « se siffle » des bières, qu’elle éructe, braille, pisse comme un homme, qu’elle minaude, miaule, feule avec les canaris, ou qu’elle ne soit plus que bouche et sexe béants gobant des trains, jamais elle ne perd de son aura. Artiste complète s’il en est, son interprétation remue, bouleverse, frappe droit au cœur et aux tripes. Oui, c’est bien une « guerrière de la beauté », comme Jan Fabre a coutume d’appeler ses danseurs.
On ne sait finalement si ce ballet désenchanté est celui du suicidaire faisant ses adieux au monde et à l’aimée, ou bien celui de celle qui reçoit la lettre, et danse son deuil. On ne sait pas non plus s’il s’agit véritablement du « dernier texte » de Jan Fabre, comme il le dit (l’écrit) dans cette lettre, mais on veut bien croire à la véracité profonde de son propos : cet homme‑là mourra comme il a vécu, c’est-à‑dire au bord, tout au bord du précipice. ¶
Delphine Beaugendre
(*) : Propos recueillis le 14 juillet 2008 dans le cadre de « Dialogues avec le public », rencontre animée par les Ceméa, École d’art d’Avignon.
Another Sleepy Dusty Delta Day, de Jan Fabre, création 2008
Inspiré par Ode to Billie Joe (1967, Bobbie Gentry)
Conception, texte, scénographie : Jan Fabre
Chorégraphie : Jan Fabre, Ivana Jozic
Interprète : Ivana Jozic
Univers sonore : Tom Tiest, DomXh
Conception lumières : Jan Fabre, Harry Cole
Costumes : Louise Assomo
Construction du décor : Bern Van Deun, Sven Van Kuijk, Geert Van der Auwera, Alexis Devos, Mikes Poppe
Chapelle des Pénitents-Blancs • place de la Principale ● Avignon
Réservations : 04 90 14 14 14
Bureau de location, cloître Saint‑Louis • 20, rue du Portail‑Boquier ● Avignon
Du 7 au 16 juillet 2008 à 15 heures, relâche le 10 juillet
Durée : 55 minutes
25 € | 20 €