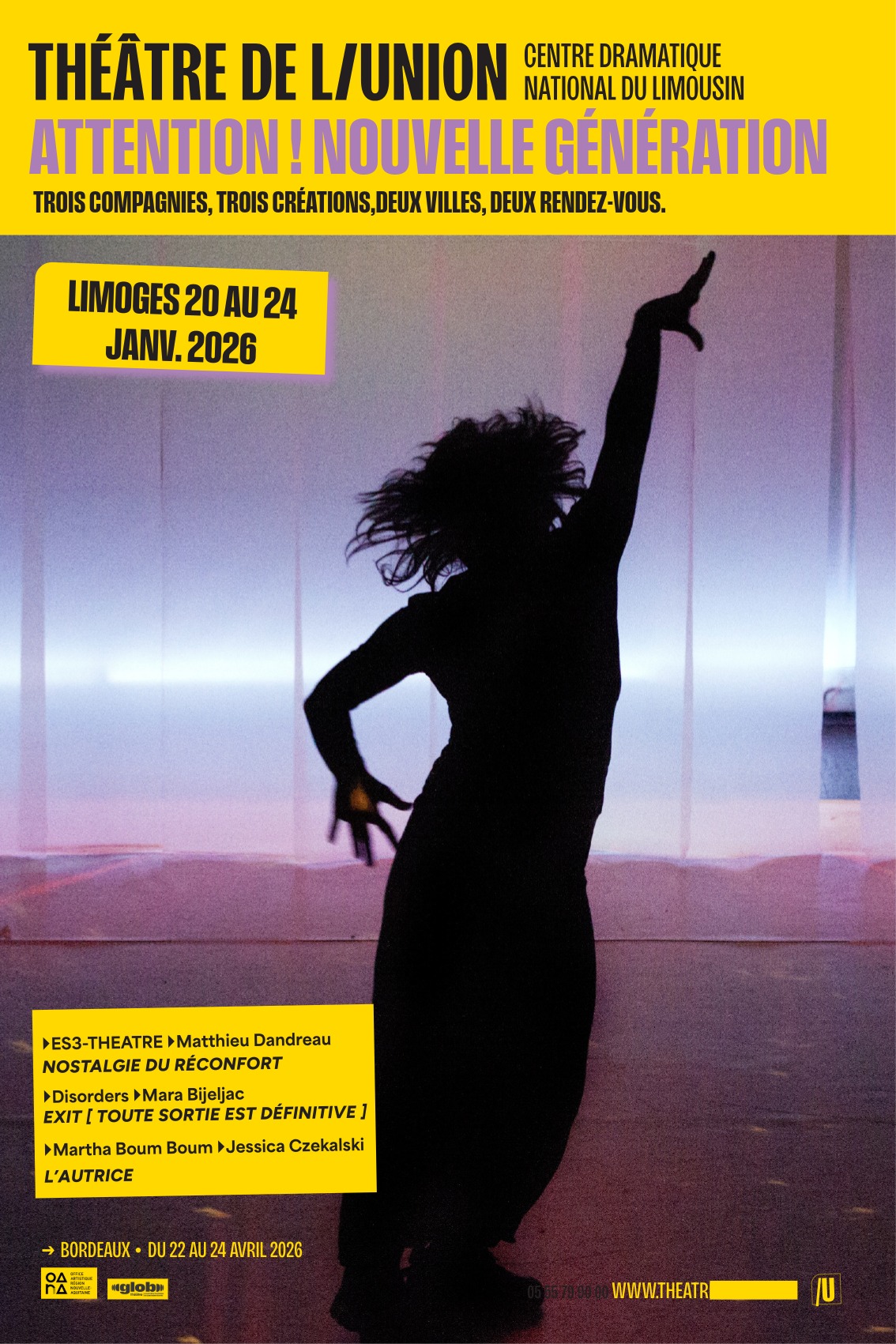Le sacrifice, à l’aube de toute démocratie
Par Lorène de Bonnay
Les Trois Coups
Liberté, égalité : des vœux pieux, des mots creux ? Que se passe-t-il donc à l’ombre de la démocratie ? En questionnant ces valeurs ô combien précieuses, Romeo Castellucci crée un horizon d’attente immense. Trop, peut-être.
Convaincu, après Malesherbes, que la démocratie est inéluctable, Alexis de Tocqueville part aux États-Unis pour l’observer, la comprendre et voir dans quelle mesure elle est applicable à la France. À son retour, il publie De la démocratie en Amérique ; le premier volume de sa thèse paraît en 1835 et le second en 1840. Il décrit notamment « l’état social » des Anglo-Américains : l’évolution des mœurs – liée à l’égalisation des conditions, à l’émergence de la presse et de l’opinion publique – conduit à la mise en place d’un régime démocratique. Le philosophe analyse le rôle de l’État, de la justice, des partis, des associations, mais aussi la religion des Pilgrim Fathers (les Puritains anglais exilés), l’art, la pensée, les langues et la société, en Amérique. Il n’oublie pas de mentionner les exclus du système, les Amérindiens et les esclaves. Certaines de ses réflexions résonnent particulièrement aujourd’hui : l’Homme a besoin de « croyances dogmatiques » pour apaiser le désordre qui l’assaille ; sa « passion » égalitaire (qui trouve un écho dans le christianisme des origines) peut le conduire à des dérives individualistes, matérialistes ou despotiques.
À son tour, Romeo Castellucci adopte une vision de loin (trop loin ?) pour observer les fondements de la démocratie, américaine et en général. L’essai de Tocqueville devient un matériau prétexte dans lequel puiser des motifs (le langage, le puritanisme, le génocide) qui s’entrelacent selon une logique poétique. Le spectacle compose ainsi une libre variation autour de la violence et du sacré qui président à l’avènement de tout régime démocratique. Mêlant danse, théâtre, créations sonores et plastiques, la scène montre la violence faite aux langues et aux cultures indiennes, puis africaines. Celle, aussi, qui s’exerce sur la femme et sur tout individu qui met trop en branle les croyances du plus grand nombre. Romeo Castellucci donne donc la parole aux boucs émissaires à l’origine de la démocratie (et de la tragédie !). Clin d’œil : ses interprètes sont toutes des femmes.

La composition du spectacle conforte la piste interprétative du sacrifice comme acte créateur ou fondateur. En effet, dès l’ouverture, un chœur féminin de danseuses-soldats (russes ou américains ?) agitent des drapeaux et préparent l’holocauste d’un agneau. Ensuite, un tableau évoque l’abandon d’un enfant sur le bord du fleuve ; on songe alors à Moïse, recueilli par la Reine d’Egypte, qui conduira ensuite son peuple vers la Terre promise. On comprend plus tard qu’il s’agit d’une mère puritaine, Elizabeth, vendant sa fillette pour acheter des outils pour le labour, en 1789. À la fin de la pièce, ce même petit corps blanc et innocent (métaphore du nouveau continent « enfant » dont parlait Montaigne ?) se trouve célébré par un dieu étrange et futuriste, qui ressemble à un araire. Comme si la démocratie américaine, ce nouveau régime plein de promesses, naissait du sacrifice symbolique d’une mère, et d’une terre fendue et ensanglantée.
Zones d’ombre de la mythologie
Sur le plateau, cette trame se trouve tissée par une série de fils et d’images. Des chœurs alternent avec des dialogues dramatiques. La scénographie épurée, stylisée – plastique blanc, sculpture antique, cylindre, étoile noire, outils de labour – nous plonge dans un univers singulièrement onirique, mêlant les références et les âges.
Tout commence par des inscriptions sur un écran semi-opaque mentionnant le phénomène de la glossolalie. Qu’elle désigne l’Esprit qui pénètre les disciples de Jésus et leur permet de parler toutes les langues, l’extase mystique d’un évangéliste ou un idiolecte inventé, ce « don des langues » questionne d’emblée l’universalité de la langue anglaise ou d’une religion, leur propension à assimiler toutes les autres. On n’est donc pas surpris d’assister alors à un dialogue entre deux Amérindiens, dont le territoire est envahi par les chasseurs blancs. Placés devant une frise de soldats romains, ils affirment leur singularité. Leur langue barbare ne renvoie pas aux mêmes réalités que la langue anglaise, bruyante et meurtrière, qu’ils doivent apprendre pour se défendre. Ils subissent la démocratie américaine qui leur colle les lèvres et leur arrache littéralement la peau.

Les actrices qui les incarnent, excellentes, revêtent bientôt l’uniforme puritain du XVIIIème siècle, dans la séquence suivante, la plus puissante du spectacle, intitulée « Je suis », en référence à l’Évangile de Saint-Jean. Cette fois, une autre victime de la société a voix au chapitre : Elizabeth, aux dents noires, meurt de faim. Elle blasphème Dieu pour mieux entrer en contact avec lui. Elle avoue à son mari avoir volé des sacs et vendu sa fillette pour des outils. Elle devient donc la victime expiatoire d’une communauté austère qui n’obéit qu’à la Loi, et non au message d’amour et de charité du Nouveau Testament. Enfermée dans un tableau terrible en noir et blanc, d’un esthétisme formel inouï, cette femme assimilée à une sorcière vomit des vocables amérindiens et dénonce le vide métaphysique. Elle se trouve alors mise à nue et placée au centre d’une série de rituels. Les danseuses qui l’encerclent, en chœur, ressemblent tour à tour à des intégristes, des déesses de la Paix et des allégories de la Liberté. Elles immolent Elizabeth et investissent cette nouvelle Marianne d’un rameau d’olivier, pendant que s’inscrivent sur le rideau les dates fondatrices et sanglantes de la République. Décidément, Romeo Castellucci s’attaque bien ici au terreau mythologique de l’Amérique.
« Un cérémonial vide »
Alors certes, de Tocqueville, il reste peu. Un mirage. Romeo Castellucci voit dans l’intérêt du philosophe français pour la jeune démocratie américaine le signe d’un déclin : son regard n’est plus tourné vers le modèle grec, vers la tragédie athénienne, mais vers un nouveau monde. Depuis, l’expérience tragique, politique, propre au théâtre antique, agonise. Aussi s’efforce-t-il de recréer une tragédie nouvelle, cathartique, célébrant « un monde sans dieu ni politique », à l’ombre de la démocratie. Son spectacle nous offre une fête des sens détonante qui célèbre « la grandeur » d’une « perte ». Un théâtre de la cruauté qui interroge les ambivalences de notre démocratie et notre hybris : entre repli individualiste et égalité, dans un monde de semblables ordonné par des croyances majoritaires, entre biens terrestres et quête spirituelle, entre destruction et création, la tension est extrême..

On peut donc se sentir exclu par le rideau semi-opaque qui forme un quatrième mur et nous coupe parfois des interprètes. On peut juger vaines les fantasmagories hermétiques qui se déroulent sur scène, et éprouver le besoin de (re)lire Tocqueville, de retrouver de la matière. Mais on peut aussi s’immerger dans les images en mouvement, les tableaux sonores sublimes. Ces derniers possèdent une telle puissance évocatoire que, rétrospectivement, ils surnagent sur l’écran mental du spectateur et déploient des ramifications vertigineuses. Que l’on songe à la séquence finale. Un dieu aussi étrange que le monolithe de L’Odyssée de l’Espace de Stanley Kubrick descend sur la fillette sacrifiée d’Elizabeth. Vient-il la bénir depuis le futur, la célébrer en agitant son corps d’araire, de tuyau ou de serpent, ses jambes de danseuse ? Rend-il hommage, tristement, dans une langue inconnue, à la victoire du labour ou labeur – symboles de la vie éprouvante et matérielle, dans nos démocraties ? Est-il le nouveau visage de l’Ange jadis envoyé par Dieu à Abraham, pour le remercier de son sacrifice ?
Romeo Castellucci joue avec son sujet, comme les anagrammes des drapeaux moquent le titre Democracy in America, au début du spectacle. On peut déplorer ce vertige du sens. Ou se laisser piéger par son envoûtante béance. ¶
Lorène de Bonnay
Democracy in America, librement inspiré d’Alexis de Tocqueville
Texte : Claudia et Romeo Castellucci
Mise en scène, décor, costumes, lumière : Romeo Castellucci
Avec : Olivia Corsini, Giulia Perelli, Gloria Dorliguzzo, Evelin Facchini, Stefania Tansini, Sophia Danae Vorvila
Et avec douze danseuses franciliennes : Sara Bertholon, Marion Peuta, Maria Danilova, Flavie Hennion, Fabiana Gabanini, Juliette Morel, Adèle Borde, Flora Rogeboz, Ambre Duband, Azusa Takeuchi, Stéphanie Bayle, Marie Tassin
Durée : 1 h 45
Photo : © Guido Mencari
MC93 – Maison de la culture de Seine-Saint-Denis • 3 boulevard Lénine • 93 000 Bobigny
Du 12 au 22 octobre 2017, du mardi au samedi à 20 h 30, le samedi à 18 h 30, le dimanche à 16 h 30
De 9 € à 29 €
Réservations : 01 41 60 72 72
À découvrir sur Les Trois Coups :
☛ Orestie, de Romeo Castellucci, par Léna Martinelli
☛ Go Down, Moses, de Claudia et Romeo Castellucci, par Léna Martinelli
☛ Sul concetto di volto nel Figlio di Dio, de Romeo Castellucci, par Laura Plas