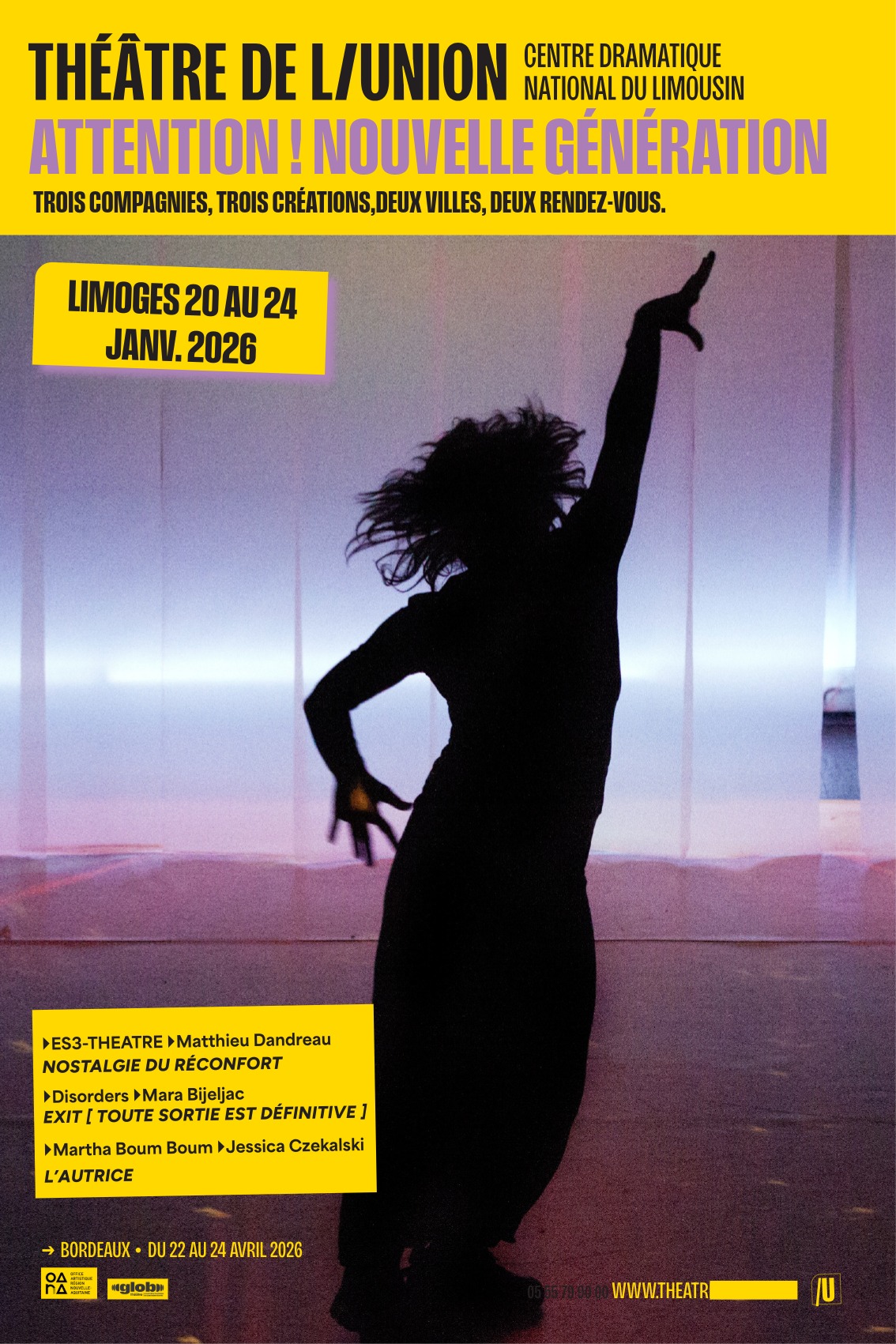De la clarté, contre l’anéantissement !
Par Lorène de Bonnay
Les Trois Coups
Claude Duparfait tresse des textes autobiographiques de Thomas Bernhard s’interrogeant sur les ruines de l’Histoire, la noirceur de l’Homme et sa quête de « clarté ». L’esthétique du spectacle rend infiniment sensibles et présents ces motifs puissants.
« Le temps des contes est terminé […] c’est pour cela qu’il est si difficile de vivre au XXe siècle », affirme Thomas Bernhard dans une allocution, en 1965. Après le désastre de la Seconde Guerre mondiale, le romancier de Gel porte un regard pénétrant sur son époque. Au cours des années suivantes, il raconte cette période effroyable dans plusieurs récits personnels. L’Origine, la Cave et Un enfant retracent notamment le parcours initiatique du jeune Thomas en Autriche, dans les années 1940.
Oscillant entre adaptation, recréation et écriture de plateau, la pièce présente des séquences créées pour les acteurs. Elles s’ajoutent au montage de « cette quantité de Je et de moi » (Stendhal) issus des romans. Bernhard est un être pluriel. Il se trouve donc incarné par quatre corps, deux hommes et deux femmes d’âges différents. Ils dialoguent constamment avec le personnage du grand-père. Dès l’ouverture, cette figure fondatrice, jouée par l’époustouflant Thierry Bosc, sort du noir. En bord de scène, proche de nous, dessiné par les lumières latérales, il rappelle à Thomas (auteur et narrateur mature interprété par Claude Duparfait) son ancien « rêve blanc », les « trouées de lumière entre les branches » lors d’une promenade commune en forêt. Tout au long du spectacle, on le voit égrener sur le plateau les feuillets du livre de « sa vie », inquiet, et évoquer son désir d’un monde inconnu, immaculé, respirable. À la fin, sa transmission semble assurée, puisque Thomas (sous les traits de la jeune Pauline Lorillard) relaie cette espérance, appelant de ses vœux l’écriture d’une société fantasmée, dans les bras de son grand-père.

Si cette aspiration dévore l’auteur et fascine Claude Duparfait, c’est que l’Europe sort « d’une nuit profonde ». Alors, raconter le chaos, le rendre tangible, faire parler les fantômes, devient nécessaire. Il faut penser, donner à voir, pour laver le sang et panser les blessures. D’où le choix de faire apparaître, cohabiter et disparaître plusieurs Thomas, de faire alterner les voix, les récits et les discours retraçant sa jeunesse. L’enfance, les échappées dans les bois avec le grand-père, qui lui enseigne « l’école du silence, de l’ironie, de l’indépendance », sont d’abord évoquées. Viennent ensuite les années malades à Salzbourg, dans l’internat national-socialiste transformé après la guerre en établissement catholique. Enfin, un moment décisif se produit : le lycéen solitaire obtient un travail d’apprenti dans la cité ghetto de Scherzhauserfeld. Il découvre les joies de la collectivité, à rebours de la philosophie du grand-père.
Dans cet enchaînement chronologique des séquences, on décèle deux parties : avant l’effondrement du nazisme et après celui-ci. Mais les commentaires constants du narrateur sur l’écriture mensongère et l’altération de la mémoire estompent la ligne de partage entre ces deux mouvements. Surtout, la dramaturgie se trouve pulvérisée par des réminiscences, des réflexions virulentes, des citations, des visions. L’abstrait s’invite toujours dans le concret, la voix personnelle trouve sa voie dans l’Histoire. La poésie brise la linéarité
Du narratif au poétique
La scénographie renvoie également à un espace à la fois mental et très concret. En effet, le plateau déstructuré (comprenant cinq côtés), légèrement incliné vers le bas, figure le monde qui s’affaisse. Les murs sont tapissés d’un velours vert évoquant l’uniforme des soldats, mais aussi les arbres. Le fond de scène se trouve percé par une fenêtre bouchée : elle représente une tâche de sang, un portrait d’Hitler. Puis, elle s’ouvre sur un hors-champ et laisse entrer des blessés. Des objets renvoient aussi à des événements réels et imaginaires : le pupitre d’écolier de Thomas fait songer au bureau de l’écrivain ; la pièce à chaussures de l’internat, où l’adolescent mélomane se réfugie et songe au suicide, a existé, mais elle ressemble à un tombeau sans corps, à une cave ou à un four ; enfin, le plancher qui couvre le sol, miné par les bombes, dévoile bientôt sa structure en acier, mettant à nu l’anéantissement du nazisme.

Le spectacle de Duparfait mêle des problématiques autobiographiques et une histoire singulière, très émouvante, prise dans une grande tragédie. Les moyens pour suggérer ce mélange de « rayons et d’ombres » sont subtils. La mise en scène est fluide, intelligente. Le décor et la lumière peignent l’affrontement entre l’horreur et le rêve de sublimation. Les acteurs, remarquables, confèrent à ce texte vibrant une ampleur inédite. Ils nous font entendre une langue simple et poétique, où résonnent les mots de Montaigne, de Shakespeare, des poèmes en allemand, des accusations ou une mascarade tristement comique.
Surtout, la pièce aborde des sujets qui résonnent avec notre actualité : la cité ghetto oubliée par les gouvernants, l’abêtissement du système éducatif et le manque de culture, les crimes commis au nom des idéologies fascistes ou religieuses, « l’humain refroidi », à une époque où, paradoxalement, la science et la raison sont à leur paroxysme.
Certes, « le froid augmente avec la clarté », l’angoisse avec la lucidité, l’effroi avec la découverte de la « vérité ». Mais la conscience ne doit pas se borner au terrifiant constat de la « banalité du mal » : elle peut susciter des élans, des révoltes, de la fraternité ! Thomas écrit justement pour aller à contre-courant, tout en gardant « les yeux fixés sur le haut ». Il a retenu les leçons de son grand-père et de sa vie en communauté. La clarté, ce souffle pur et inspiré, ce poème incandescent tant attendu qui s’élève des ruines, trouve une présence au théâtre. En prenant mystérieusement chair, ce « désir réalisé demeuré désir »[1] éblouit nos yeux et brûle nos cœurs. ¶
Lorène de Bonnay
Le Froid augmente avec la clarté, inspiré de Thomas Bernhard, un projet de Claude Duparfait
Récits l’Origine et la Cave publiés aux éditions Gallimard
Mise en scène : Claude Duparfait
Avec : Thierry Bosc, Claude Duparfait, Pauline Lorillard, Anne Mercier, Florent Pochet
Durée : 2 heures
Teaser : présentation de saison Claude Duparfait
Théâtre national la Colline • Petit Théâtre • 15 rue Malte-Brun • 75020 Paris
Du 19 mai au 18 juin 2017, du mercredi au samedi à 20 heures, le mardi à 19 heures, le dimanche à 16 heures
De 8 € à 20 €
Réservations : 01 44 62 52 52
À découvrir sur Les Trois Coups
Harmonie, par Morgan Patin
De l’irritation contre l’un des beaux-arts, par Fabrice Chêne
[1] René Char, Fureur et mystères