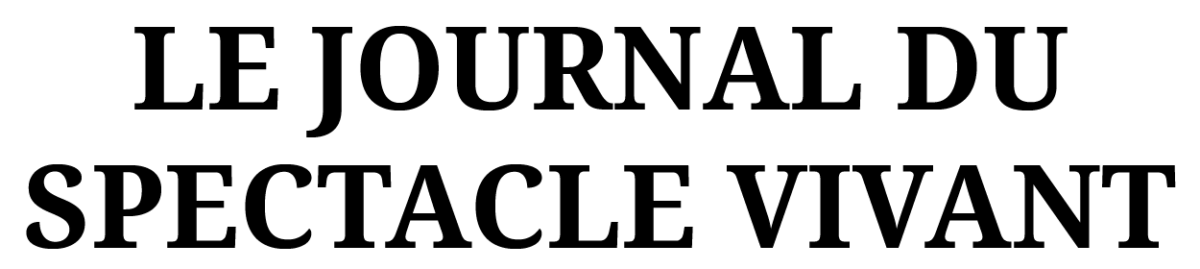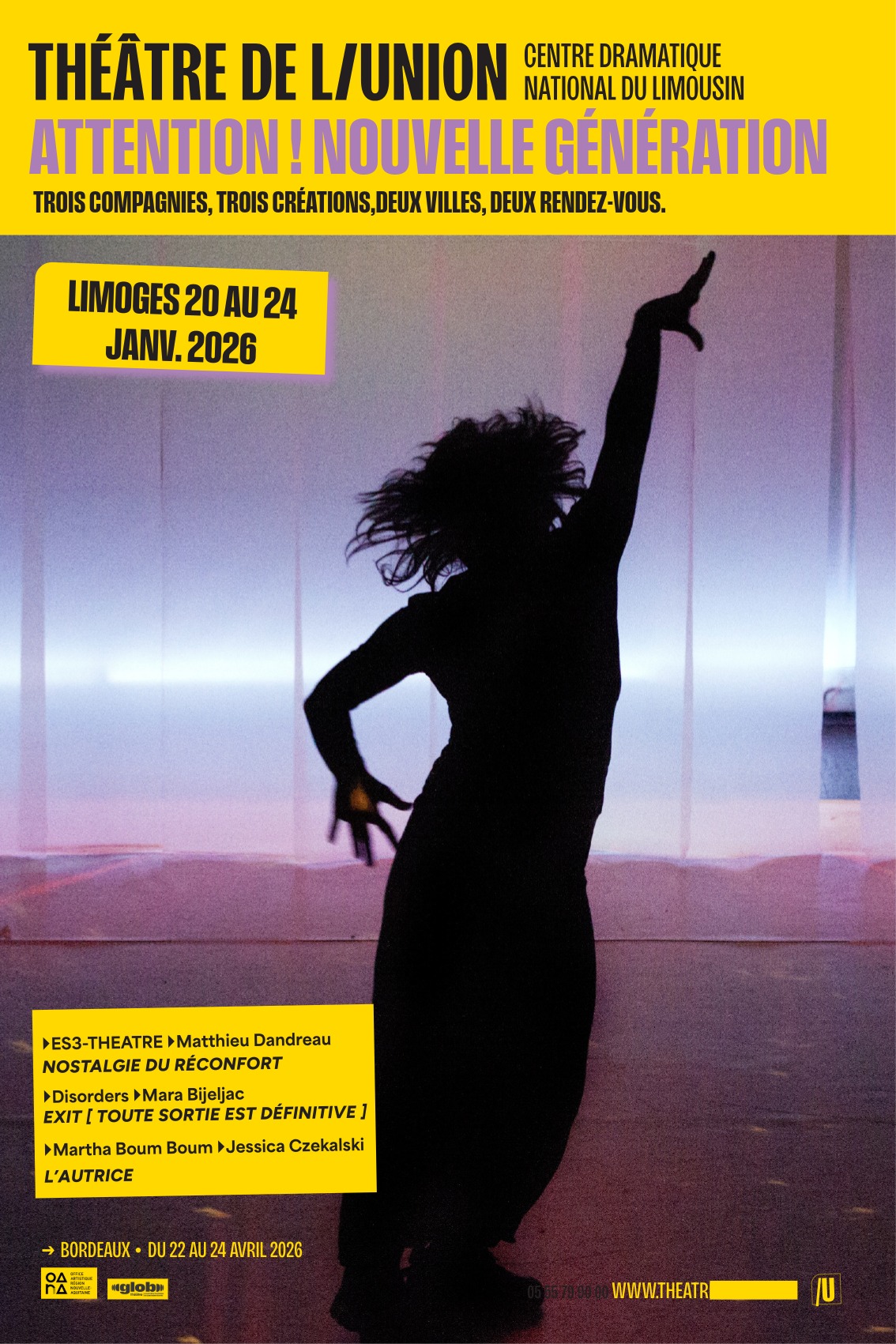Le glaive sans visage
Laura Plas
Les Trois Coups
Mascarade infernale, cathédrale des douleurs, « Léviathan « atteste à nouveau de la capacité de Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix à troubler nos représentations. Un spectacle très bien interprété, et par-delà ses failles, nécessaire.
Assis derrière-moi, une avocate, son neveu qui a déjà assisté à des comparutions immédiates, ses amis qui disent : « En France, pour se retrouver en prison, il en faut ! », ou « Quand la police arrête quelqu’un, c’est mérité. », Léviathan n’a pas commencé. 1 h 45 plus tard, les applaudissements crépitent, mes voisins échangent sur la violence de la justice. Quelque chose donc s’est passé, quelque chose a bougé en eux et sans doute dans la tête de nombreux spectateurs. Car Léviathan ne conforte pas notre foi dans le système pénal : traitant de la procédure de la comparution immédiate, la pièce en fait au contraire trembler la cathédrale.
De fait, la justice nous y apparaît expéditive, punitive. À des délits mineurs, elle applique des peines garantes de son sérieux. Elle condamne des hommes déclassés socialement la plupart du temps à une prison qui ne profite, ni aux potentiels coupables, ni aux victimes. Elle avale ces êtres pour engraisser les constructeurs de geôles et prestataires de services, des entreprises cotées en bourse. Léviathan nous met face à cette réalité. On rétorquera peut-être que la pertinence d’un spectacle, sa nécessité même ne garantissent pas sa qualité. C’est vrai, mais Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix expérimentent encore une fois une forme inédite (pour eux) mais adaptée à leur sujet.
Fantoches et pantins
On est loin des Délits Flagrants de Depardon, loin du théâtre documentaire. Si l’écriture de Guillaume Poix s’est nourrie d’entretiens, si de ce matériau (présent dans le titre de la pièce éditée aux Éditions théâtrales), reste un beau « personnage » de prologue, Léviathan nous enveloppe plutôt dans une mascarade étrange. Les visages sont déformés : les détenteurs de la loi portent des masques hyper réalistes et ont une gestuelle mécanique qui les apparente à des fantoches. Face à eux, les accusés sont couverts de bas. Devenus des chiffes, ils sont aussi des chiffons prêts à être jetés au rebut. Leurs visages étouffés préfigurent leur mort réelle ou sociale. Leurs corps se contorsionnent. Ils se rebiffent parfois, débordent des cadres souvent. Le décalage entre ces types de masques a pour résultat de nous faire choisir le camp des plus faibles. Ainsi, à rebours de l’imagerie hagiographique qui fait du policier, du juge ou du procureur le héros d’une geste, le théâtre crée ici une forme de réparation symbolique.

On a coutume de voir dans le procès un espace infiniment théâtral parce qu’il est le lieu de pavanes oratoires. Or, la force de Léviathan est de puiser dans d’autres ressources théâtrales que celles du langage. Les plus beaux moments sont peut-être muets, et les corps racontent plus que les mots. On pensera au carnaval médiéval où les puissants sont moqués, à la comédie ancienne grecque où les acteurs finissaient par se démasquer pour prendre à partie le public et le ramener à la réalité, comme le fait Khallal Baraho dans la pièce, on songera encore aux Mystères Bouffes de Dario Fo, à Brecht, aux pantins de Kantor (… et on en passe).
Les associations d’idées se bousculent, donc, comme se superposent les actions et les images projetées en fond de scène. Notre œil ne peut tout suivre alors, d’autant que les images se brouillent de nappes de fumigènes, d’anamorphoses. L’une de celles-ci, saisissante, invite peut-être à un changement de paradigme : effaçant l’image du Léviathan, elle mêle le visage du Christ à celle d’une prévenue. Visages, humains si humains. La scénographie elle-même est faite d’éléments organiques ou mouvants. Le sable de l’arène est ainsi projeté par les pieds maladroits des accusés. Une voûte de tissu change de couleurs, et s’agite. Elle fait alors penser à un poulpe géant, à une membrane, autant qu’au chapiteau d’un cirque. Belles idées évocatrices.

Certes, il y a parfois dans cette multitude de ressources spectaculaires un aspect cheap. Le chant, la vidéo peuvent ne pas totalement convaincre, mais n’est-ce pas un moyen d’éviter de nous bercer d’une consolation esthétisante ? Et puis, à une exception près, la distribution est remarquable. Le travail corporel des interprètes porte véritablement la représentation. Il nous décolle en effet du réel tout en nous tordant le cœur. On se souviendra longtemps de Mathieu Perotto, Jeanne Favre ou Felipe Fonseca Nobre. Quant à Khallaf Baraho, brisant le quatrième mur, il donne enfin un visage, un grain de voix à ceux que nous avons vu défiler. Il assure la cohérence dramaturgique du spectacle et son authenticité. Sa cour des miracles est aussi un miracle de théâtre.
Laura Plas
Léviathan, de Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan
Le texte (Léviathan-Matériau) est édité aux Éditions théâtrales
Site de la compagnie
Conception et mise en scène : Lorraine de Sagazan
Avec : Khallaf Baraho, Jeanne Favre, Felipe Fonseca Nobre, Jisca Kalvanda, Antonin Meyer-Esquerré, Mathieu Perotto, Victoria Quesnel, Eric Verdin et le cheval Oasis
Durée : 1 h 45
Dès 16 ans
Ateliers Berthier • Odéon Théâtre de L’Europe • 1, rue André Suarez • 75017 Paris
Du 2 au 23 mai 2025, du mardi au samedi à 20 heures et le dimanche à 15 heures
De 8 € à 19 €
Réservations : 01 44 85 40 40 ou en ligne
À découvrir sur Les Trois Coups :
☛ La Vie invisible, de Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan, par Laura Plas
☛ Entretien avec Lorraine de Sagazan pour L’Absence de père, d’après Platonov d’Anton Tchekhov, par Juliette Nadal
☛ L’Absence de père, d’après Platonov, par Michel Dieuaide
Photos : © Simon Gosselin