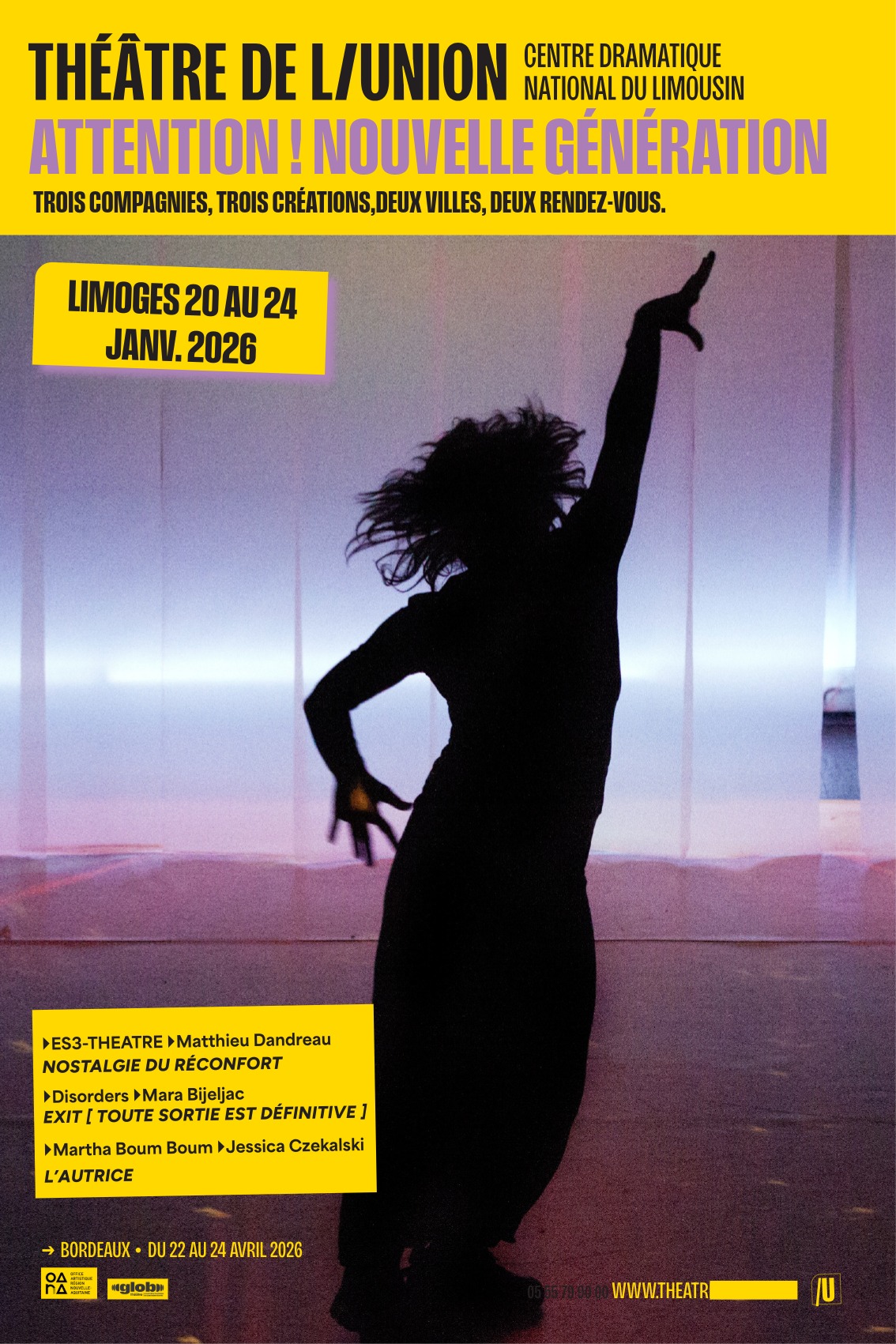Entre décantation et incantation, un monologue pour vivre encore
Par Frédéric Nau
Les Trois Coups
Paris accueille enfin l’un des spectacles mythiques de Guy Cassiers : le Théâtre de la Bastille offre un espace idéal pour ce monologue habité par une mémoire traumatisée.
Un aveu pour commencer : l’auteur de ces lignes n’a pas assisté à la première anversoise de ce spectacle, conçu par Guy Cassiers, il y a une dizaine d’années, pas plus qu’aux reprises régulières qui l’ont suivie, en Belgique comme dans d’autres pays. Il est vrai qu’il est donné pour la première fois à Paris, mais la note de programme insiste sur la grande notoriété de ce Rouge décanté, évoquant même des « fidèles » qui reviennent voir la pièce « comme on ferait un pèlerinage ». C’est donc bien avec le sentiment de pénétrer dans un espace sacré que nous entrons dans la salle du Théâtre de la Bastille.
Sur le côté cour de la scène, sans rideau, se tient assis un homme d’âge moyen, utilisant un grattoir pour se nettoyer la plante des pieds. Tandis que les lumières s’éteignent, il continue, grommelant quelques mots inaudibles, commentant visiblement sa besogne. Puis le comédien se lève et commence à dire un texte poétique sur le vent et les marques qu’il imprime dans les paysages qu’il traverse. Le spectateur a alors bel et bien le sentiment d’être convié à un rituel sans que les codes ne lui en aient été livrés. Ce mystère sollicite une attention de tous les instants au texte récité mezzo voce par l’unique comédien.
Progressivement, un centre se dégage de ce monologue hétéroclite, qui évoque, pêle-mêle, diverses réflexions du personnage sur la vie, l’amour ou l’amitié. Sans cesse, il revient à la mort de la mère, évènement qui semble avoir déclenché cette prise de parole qui n’en finit pas. Au fil de la pièce, il devient clair que cette mort, naturelle, renvoie imaginairement à la mort symbolique de la mère, quand l’enfant était prisonnier, avec elle et sa grand-mère, d’un camp de travail japonais dans le Pacifique. Torturée par l’armée japonaise, la mère a été comme « cassée » sous le regard médusé de son fils, incapable d’avancer pour la secourir. Répétant l’injonction de sa mère, qui lui ordonnait alors de ne pas s’approcher, l’adulte avoue n’avoir jamais réussi à s’arracher à cette paralysie première, et y trouve une cause importante à sa difficulté à entrer en relation avec qui que ce soit.
Ainsi la promesse du programme a-t-elle été bien tenue. La représentation se fait effectivement rite, si le rite est l’ensemble de paroles et de gestes, qui, indéfiniment, demandent à être réitérés afin d’accéder à un mystère profond, dérobé à la vie ordinaire et pourtant essentiel à nos êtres. Et même la conscience que ce texte a été répété de nombreux soirs depuis dix ans et le sera encore longtemps ajoute, justement, à l’émotion poignante que le monologue inspire, comme si la parole ne pouvait opérer son œuvre libératrice qu’à être proférée sur une scène, mais qu’entre deux dates, la mémoire travaillait et retravaillait toujours, appelant à chaque fois une nouvelle représentation.
Cette réussite impressionnante repose tout d’abord sur le jeu de l’unique comédien, Dirk Roofthooft. Laissant entendre un léger accent étranger, il trébuche sur certains mots, hésite sur telle phrase ou se reprend. Mais l’assurance qu’il manifeste par ailleurs dans la récitation donne à penser que ce sont là, plutôt que de menues difficultés, des modulations recherchées de la voix. Et, en réalité, peu importe, car cette incertitude, elle-même, exprime puissamment la fragilité du rôle et contribue au portrait d’un homme prisonnier de sa mémoire labyrinthique. Plus généralement, Dirk Roofthooft sait admirablement faire entendre une parole de la hantise, qui déborde toute maîtrise possible et s’empare même de son corps, quand ses gestes, comme ses mots, se mettent à trembler, à manquer leur banal objet. Bégaiement ou cigarette mal allumée, tous les détails les plus subtils sont sollicités pour que le personnage s’incarne devant le public.
Les lumières prennent également leur part à la cérémonie. Les éclairages, plus ou moins vifs et variant en couleur (avec, notamment, un superbe rouge), donnent à voir autant d’images fragmentées de cet être et contribuent à faire entrer le spectateur dans le monologue. À la fin des presque deux heures que dure la représentation, il sort presque physiquement imprégné de cette conscience malheureuse, comme s’il avait été lui-même projeté sur la scène.
À tout point de vue, ce Rouge décanté est une intense expérience de théâtre : par une utilisation discrète mais minutieuse de tous les moyens dramaturgiques, Guy Cassiers et Dirk Roofthooft nous font épouser un instant les violentes secousses intérieures d’un personnage fascinant, tour à tour antipathique et pitoyable, mais touchant assurément dans sa tentative désespérée de rester humain après la catastrophe. ¶
Frédéric Nau
Rouge décanté, de Jeroen Brouwers
Mise en scène : Guy Cassiers
D’après le roman de Jeroen Brouwers
Adaptation : Guy Cassiers, Dirk Roofthooft, Corien Baart
Avec : Dirk Roofthooft
Dramaturgie : Corien Baart, Erwin Jans
Décor, vidéo et lumière : Peter Missotten (de Filmfabrick)
Réalisation vidéo : Arjen Klerkx
Décor sonore : Diederik De Cock
Costumes : Katelijne Damen
Assistante à la mise en scène : Hanneke Wolthof
Accessoires : Myriam Van Gucht
Conseillère en langue française : Coraline Lamaison
Traduction du néerlandais : Patrick Grilli
Régisseur Bastille : Pascal Villmen
Photo : © Pan Sok
Production : Toneelhuis (Anvers), Ro Theatre (Rotterdam)
Théâtre de la Bastille • 76, rue de la Roquette • 75011 Paris
Billetterie : 01 43 57 42 14
Représentations : du 2 au 18 décembre 2015, à 20 heures, dimanche à 17 heures, relâche les 7 et 13 décembre
Durée : 1 h 40
Tarifs : de 16 € à 26 €