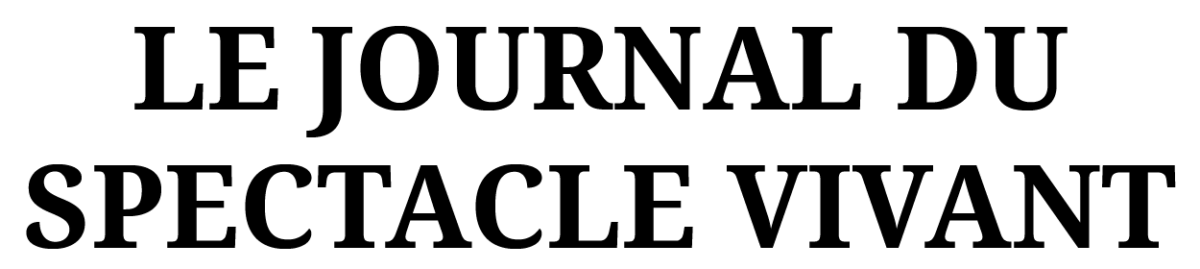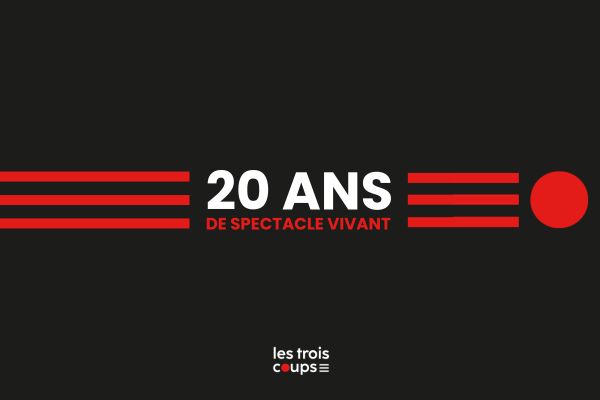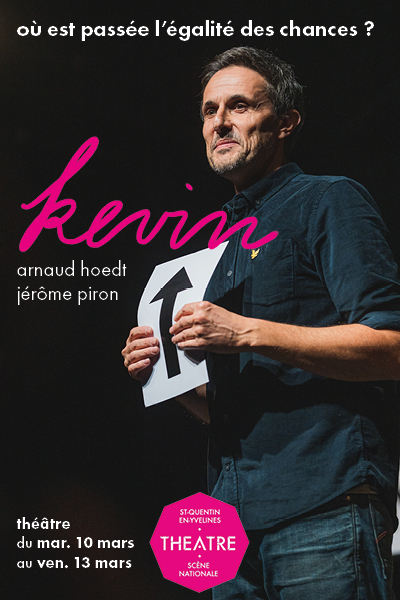Pas si simple de détruire une illusion !
Lorène de Bonnay
Les Trois Coups
En 2012, dans Un Ennemi du peuple, Thomas Ostermeier questionne le combat d’un docteur qui lutte seul contre une machine politique dirigée par « la clique du pouvoir » : le protagoniste dénonce la pollution infestant sa ville mais constate, horrifié, que la majorité, corrompue par la classe dirigeante, se retourne contre lui. Dans le Canard sauvage, le docteur Hilling prend en charge une parole opposée : l’illusion, l’imaginaire, le mensonge sont peut-être préférables à une « vérité » insupportable, radicale, idéale. L’exploration très fine du répertoire du dramaturge norvégien s’approfondit donc avec cette dernière création, parfaitement actuelle, profonde et maîtrisée.
Les adaptations d’Ibsen par Thomas Ostermeier dépeignent souvent une bourgeoisie qui se laisse aveugler, pervertir, par des intérêts économiques. Elles résonnent avec nos sociétés occidentales de moins en moins démocratiques. Le Canard sauvage (écrit en 1884 par un auteur de 56 ans) dénonce les excès du capitalisme, une forme de libertarisme qui brise le lien social, des croyances élevées au rang de vérités (masquant un déficit d’idéologies ou une perte de sens). La question de ce qui est vrai ou faux – sur les plans politique, sociétal, individuel, existentiel, philosophique – est traitée sans manichéisme par la troupe de la Schaubühne. En mettant en exergue l’ambiguïté des discours et des personnages du drame, elle impose le doute, la nuance et la réflexion, en évitant tout dogmatisme.
En effet, la mise en scène place en miroir deux fils, deux anciens amis : Gregers Werle et Hjalmar Ekdal. Le premier s’oppose de façon presque caricaturale (freudienne) à son père, un riche chef d’entreprise ayant toujours mené des affaires louches, un homme à femmes ayant trompé allègrement son épouse. Le second accueille dans son modeste appartement son père, un vieux chasseur et un employé d’usine qui a fait de la prison à la place de son patron Werle. Il laisse son paternel travailler encore pour Werle, s’occuper d’un vieux canard sauvage dans une pièce mystérieuse et vivre dans le passé. L’appartement d’Hjalmar, conçue ingénieusement par la scénographe Magda Willi, comprend des chambres et une partie boutique : Hjalmar, aidé par sa femme Gina et leur fille de 17 ans Hedvig, est photographe (ils font surtout des retouches de portraits).

Un plateau tournant permet de passer d’une pièce de la maison Werle (élégante, en noir et blanc) où se déroule le premier acte de la pièce, à l’appartement des Edkal, plus bigarré, style années 70-80, où se déploie l’essentiel de l’intrigue. D’emblée, le personnage de Gregers se découvre une « mission vitale », celle de réparer les vilénies de son père. Pour ce faire, il quitte la maison familiale, démissionne de son poste à l’usine, renonce à son héritage et s’installe dans l’immeuble des Edkal. Venant d’apprendre de la bouche de son père que ce dernier a engrossé leur ancienne gouvernante Gina et a arrangé le mariage de celle-ci avec son ami Hjalmar, 18 ans auparavant (il rentre d’une longue absence assez peu réaliste !), il entreprend donc de rétablir la vérité. Il ne souhaite pas détruire cette famille mais la « sauver ». Ouvrir les yeux de tous les aveugles ou malades ayant une vision biaisée de la réalité en raison des mensonges du passé. Répandre la lumière de la vérité « objective » et authentique, permettant de jeter les bas de relations « vraies » et « fortes ». Car chacun doit se réaliser pleinement, hors de toute convention, de tout « rôle ». Le mensonge est une prison, un poison, une maladie, une plongée dans l’obscurité (comme le chien qui a sauvé le canard en sautant dans la mare boueuse).
Oui, la vérité rend plus fort, crée une vie nouvelle ! Ostermeier force à peine le trait de son personnage comique et tragique, en s’inspirant aussi des écrits d’un psychologue américain contemporain, Brad Blanton, dont la théorie consiste à être absolument honnête avec autrui pour transformer sa vie. Un discours que l’on retrouve par exemple dans le concept de « polyamaour » des jeunes couples d’aujourd’hui qui se disent « tout » (présent en filigrane dans le dialogue entre Gregers et Hedvig) ou dans les répliques, cyniques, désenchantés, de Mme Sorby, la secrétaire qui épouse le vieux Welde : chacun s’engage librement, en pleine connaissance de cause, en fonction de son intérêt, dans cette union sans amour.
Des personnages dérisoires et poignants
Face au censeur Gregers qui s’impose dans la vie de la famille Hedkal tel Tartuffe (sauf que lui n’est pas un imposteur gueux, mais un grand bourgeois sincère), Hjalmar est tout aussi touchant et ridicule. Les cheveux gras, préférant son slip et son pull en laine au costume loué pour aller dîner chez Werle, il se prosterne avec naturel devant les deux femmes de sa vie et nous joue un petit concert grotesque : Nothing else matters de Metallica. Certes, il a vécu dans l’opprobre (quand son père a été en prison), il a failli se suicider, mais il s’appuie sur sa famille et sur le docteur Hilling qui surveille sa santé. Surtout, il s’imagine à l’aube d’une « invention » dans la domaine de la photographie (dans la pièce) ou de la musique (dans le spectacle). Il est fragile, lâche, dans le déni (il oublie d’aider sa fille à trouver un stage, laisse Gina s’occuper de la boutique, il est complice de son père qui s’enferme avec son canard estropié, ses arbres de Noël morts, ses peluches et son schnaps). Mais il n’est pas malheureux. Le sage médecin Hilling le confirme.
Lui sait que les symptômes ont une fonction, apportent un gain aux individus : « prendre à un homme son mensonge vital, c’est prendre sa vie » ; « l’Homme vit dans le délire ». Le canard estropié que garde le vieux chasseur Hedkal, par exemple, blessé par balles par Welde, sauvé par un chien de chasse, désormais enfermé et soigné par l’employé, symbolise la trajectoire d’un vieil homme piétiné par un « maître », qui survit ainsi. Gregers n’est pas en mesure de le comprendre : il lui paraît plus courageux d’éradiquer le « mal » (l’illusion, la dépendance, la maladie); selon lui, « on ne guérit que quand on ne cache plus rien ». Il assène donc toute la « vérité » à son ami, jusqu’à la catastrophe, et prend même les spectateurs à partie.


Le metteur en scène et sa dramaturge ont resserré l’intrigue en coupant des passages, se sont appuyés sur une traduction moderne, ont développé des personnages et des scènes ; ils laissent place à une improvisation cadrée – autant d’éléments qui montrent le talent d’Ostermeier, spectacle après spectacle. La performance de Gregers, vêtu de bleu marine, tel un scout chrétien, est très réussie : il demande de « la lumière » et interroge le public avignonnais (toujours friand de ces dialogues savoureux). « Avez-vous menti à votre partenaire ou à vos proches ? Le mensonge empoisonne-t-il vos relations ? Comment réparer et se faire pardonner ? Une société où tout le monde se dit la vérité, ça vous dit ? ». Le prédicateur nous laisse alors le temps de nous « confesser » et nous promet que nous quitterons ce lieu « changés ». Ensuite, il entonne L’éloge du communisme extrait de La Mère de Brecht (mis en musique), et propose de remplacer le terme désuet de « communisme » par celui de « vérité » : « elle est la fin des crimes » (contrairement à ce qu’en disent les « exploiteurs »), « elle n’est pas le chaos mais l’ordre », « elle est la simplicité si difficile à obtenir »…
Dans cette version du Canard sauvage, les personnages féminins acquièrent aussi une autre dimension. Gina la déclassée ne cherche plus à montrer qu’elle s’exprime aussi bien que son époux : c’est une femme active, aimante, à laquelle on s’identifie aisément. Le personnage de Mme Sorby est plus dense : la secrétaire fiancée vient expliquer sa relation avec Welde avec une franche lucidité. Enfin, la petite Hedvig, déjà si puissante dans la pièce d’Ibsen (parce que sacrifiée pour rien par les mensonges des uns, autant que par les vérités des autres), est une jeune femme engagée, syndiquée, féministe (« mais pas pour défendre les bourges »), cultivée, perspicace, mature.

En somme, les acteurs admirables, le choix des musiques qui ponctuent les actes, le plateau tournant dans un sens ou dans l’autre (en fonction des disputes, des chansons), suggérant le hors champ ou révélant le débarras caché, le choix de décors et costumes exhibant la dualité, enfin, la hauteur du propos, font de ce spectacle une œuvre aboutie, impeccable. Certes, on a pu être ébloui par des mises en scènes plus puissantes ou créatives du dramaturge allemand, mais nous ne boudons nullement notre plaisir ici !
La sobriété sert ce Canard sauvage si séduisant et trouble. Hjalmar et Gregers sont également « malades ». L’un survit en imaginant ce qu’il pourrait être et faire un jour. L’autre est fanatique et décrète une vérité qui constitue d’ailleurs le socle de plusieurs religions, spiritualités ou philosophies, lui fait remarquer Hedvig (laisser mourir son ego mensonger et égoïste et accepter le vrai Soi, se réaliser sans compromis, choisir l’idéalisme radical, chercher le Vrai, le Bien et le Beau, le Tout plutôt que le rien, être libre, etc.). Le problème est que Gregers cherche à imposer son point de vue de façon obsessionnelle et tyrannique. Or, de quel droit se permet-il de « décider qui reçoit la Vérité et quand » ?
Finalement, c’est quoi, être soi ? vivre authentiquement ? La vérité (scientifique), l’éthique, sont devenues des enjeux de société cruciaux – même si tout ne peut être dit, toujours, tout le temps, à tous, sans contextualisation, recul, pédagogie, vérifications. Quant à l’illusion, l’imagination, la fiction, elles demeurent un détour nécessaire pour questionner les vérités, chercher ce qui est vrai, adéquat, pour chacun : l’autre et soi. On sait gré à Ostermeier de ne pas trancher ce débat et de laisser infuser ces questionnements bien après la représentation.
Lorène de Bonnay
Le Canard sauvage, d’Henrik Ibsen
Le texte est d’Henrik Ibsen est traduit par Hinrich Schmidt-Henkel et adapté par Maja Zade et Thomas Ostermeier
Mise en scène : Thomas Ostermeier
Avec : Thomas Bading, Marie Burchard,Stephanie Eidt, Marcel Kohler, Magdalena Lermer, Falk Rockstroh, David Ruland, Stefan Stern
Durée : 3 heures
Opéra Grand Avignon • Place de l’Horloge • 84000 Avignon
Du 5 au 16 juillet 2025 (sauf le dimanche), à 17 heures
De 7 € à 45 €
Réservations : en ligne • Tel. : 04 90 27 66 50
Dans cadre du Festival d’Avignon, du 5 juin au 26 juillet 2025
Plus d’infos ici
À découvrir sur Les Trois Coups :
☛ Richard III, Shakespeare, Thomas Ostermeier, par Lorène de Bonnay
☛ Les Revenants, Henrik Ibsen, Thomas Ostermeier, par Lorène de Bonnay
☛ Portrait de Thomas Ostermeier, par Lorène de Bonnay
Photos : © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon